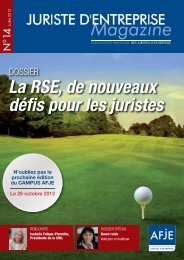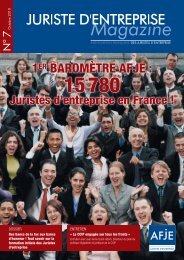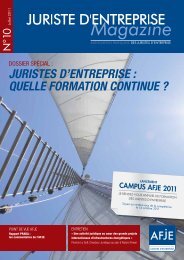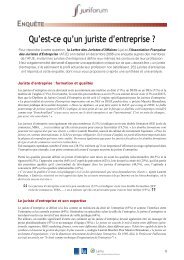LE JURISTE D'ENTREPRISE FACE AUX CONTENTIEUX - AFJE
LE JURISTE D'ENTREPRISE FACE AUX CONTENTIEUX - AFJE
LE JURISTE D'ENTREPRISE FACE AUX CONTENTIEUX - AFJE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
vrer une autorisation de mise en place<br />
des dispositifs d’alertes éthiques de<br />
manière anonyme au risque d’instituer<br />
« un système organisé de délation<br />
professionnelle », et de renforcer<br />
« le risque de dénonciation calomnieuse<br />
» (Délib. CNIL n° 2005-110, 26<br />
mai 2005), elle a, par la suite, adopté<br />
une délibération portant autorisation<br />
unique de traitement, dès réception<br />
d’une déclaration de conformité, sans<br />
autorisation préalable (Délib. CNIL n°<br />
2005-305, 8 déc. 2005, JO 4 janv.). La<br />
CNIL est ainsi parvenue à une situation<br />
de compromis, excluant tout devoir<br />
généralisé de dénonciation tout en<br />
légitimant la pratique de l’alerte professionnelle<br />
: « cette autorisation impose<br />
de ne pas inciter à des dénonciations<br />
anonymes (…), mais au contraire de<br />
susciter l’identification du donneur<br />
d’alerte en assurant sa confidentialité<br />
(…) » (Barrière F., Les dispositifs<br />
d’alertes professionnelles : le temps<br />
de l’apaisement ?, Rev. sociétés 2011,<br />
p. 276).<br />
Ainsi, l’impératif de protection des données<br />
personnelles du donneur d’ordre<br />
assorti de la protection de la vie privée<br />
de(s) personne(s) susceptible(s) d’être<br />
dénoncée(s) encadrent la pratique de<br />
la dénonciation, jusqu’à l’ériger en<br />
véritable droit.<br />
II – Vers la consécration d’un droit<br />
Les personnes dénoncées dans le<br />
cadre d’alertes professionnelles ne<br />
peuvent être mises en cause que pour<br />
des faits précis (A), et disposent de<br />
recours contre des dénonciations<br />
calomnieuses ou mensongères (B).<br />
A – circonscription de<br />
l’objet de la dénonciation<br />
La CNIL précise les dispositifs pouvant<br />
faire l’objet d’un engagement<br />
de conformité dans le cadre d’une<br />
alerte professionnelle : « [les traitements]<br />
répondant à une obligation<br />
législative ou réglementaire de droit<br />
français visant à l’établissement de<br />
procédures de contrôle interne dans<br />
les domaines financier, comptable,<br />
bancaire et de la lutte contre la corruption<br />
» (Délib. CNIL n° 2005-305,<br />
8 déc. 2005, JO 4 janv., art. 1) ; Elle<br />
précise également : « (…) Des faits qui<br />
ne se rapportent pas à ces domaines<br />
peuvent toutefois être communiqués<br />
aux personnes compétentes de l’organisme<br />
concerné lorsque l’intérêt vital<br />
de cet organisme ou l’intégrité physique<br />
ou morale de ses employés est<br />
en jeu » (Délib. CNIL n° 2005-305, 8<br />
déc. 2005, art. 2). Un syndicat a sollicité<br />
l’annulation d’un code de conduite<br />
permettant aux salariés de dénoncer<br />
POINT DE VUE<br />
des faits autres que ceux prévus à<br />
l’article 1 ; la Cour de cassation a fait<br />
droit à cette demande (Cass. soc., 8<br />
déc. 2009, n° 08-17.191 ; Desbarats<br />
I., Alertes, codes et chartes éthiques<br />
à l’épreuve du droit français, D. 2010,<br />
p. 548). La CNIL a en conséquence,<br />
supprimé toute référence à l’intérêt vital<br />
ou à l’intégrité physique ou morale des<br />
salariés dans sa décision d’autorisation<br />
unique (Délib. CNIL, 2010-369, 14 oct.<br />
2010, JO 8 déc.). Cette évolution met<br />
en évidence le contrôle de l’autorité<br />
judiciaire et de la CNIL, gardiennes des<br />
libertés, garde-fous contre les dénonciateurs<br />
abusifs tentés de s’immiscer<br />
dans la vie privée des salariés.<br />
B – la sanction de l’abus<br />
du droit de dénoncer<br />
L’autorité judiciaire prévoit des sanctions<br />
spécifiques pour le dénonciateur<br />
abusif. La dénonciation « d’un<br />
fait qui est de nature à entraîner des<br />
sanctions judiciaires, administratives<br />
ou disciplinaires et que l’on sait totalement<br />
ou partiellement inexact » est<br />
qualifiée de calomnieuse (C. pén., art.<br />
L. 226-10 et s.). A titre de récente<br />
illustration sur ce droit de recours, les<br />
plaintes déposées par les cadres de<br />
chez Renault mis en cause dans une<br />
affaire d’espionnage (AFP, La plainte<br />
pour dénonciation, Le Figaro, 19 janv.<br />
2011). Par ailleurs, la dénonciation<br />
mensongère est également incriminée<br />
(C. pén., art. 434-26).<br />
Ainsi, la dénonciation n’est pas considérée<br />
comme un devoir, ce qui n’est<br />
pas le cas, aux Etats-Unis, où les donneurs<br />
d’alerte sont érigés en « héros<br />
publics » (Bailly E., Daoud E., le whistleblowing<br />
et la protection des données<br />
à caractère personnel : le compromis<br />
américano-européen, AJ pénal 2010,<br />
p. 269). Or, avant d’engager une<br />
réflexion autour de l’opportunité de<br />
la remise en cause de la conception<br />
française, il convient de s’interroger<br />
sur l’utilité de la dénonciation. Permetelle<br />
de lutter efficacement contre les<br />
atteintes au droit des affaires ?<br />
■<br />
Juriste d’Entreprise Magazine N°11 – Novembre 2011<br />
45