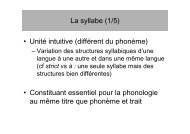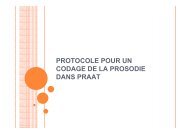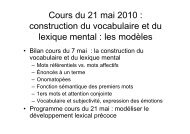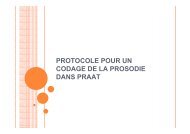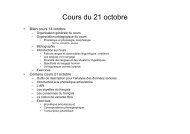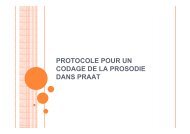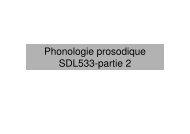Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
qu’elle voudrait dépasser vers un monde meilleur. Le chant d’opéra en est un exemple<br />
éclatant. Dans les textes de Cavell concernant la voix et l’opéra 1 , il apparaît comme un<br />
paradigme. L’histoire de l’opéra est celle du pouvoir de la musique incarné dans l’art<br />
de chanter. Cavell en souligne toute la portée existentielle : il révèle une capacité de la<br />
voix humaine située entre deux mondes. La voix qui émerge du chant, et dont le<br />
langage est la condition, met en œuvre une capacité proprement humaine à élever la<br />
voix, à faire entendre la peine de vivre, la condition d’exil qui est notre lot, et l’énigme<br />
que chacun est même pour soi.<br />
La voix est à la fois en-deçà et au-delà de la personne, comme en témoigne sa<br />
double origine, matérielle et symbolique 2 .<br />
L’origine matérielle de la voix se trouve dans la condition corporelle que partagent<br />
bien des êtres vivants, celle d’un organisme vivant respirant. Sonorisant le souffle dès<br />
le premier cri de la naissance, la voix expire lors de la mort, mais aussi dans le chant<br />
qui sonorise l’expiration. Le chant incarne donc la tension entre deux mondes, entre<br />
naissance et mort. Le souffle, articulé, se transforme en voix significative adressée à<br />
un autre virtuel. Le chant d’opéra manifeste ainsi notre condition de co-existence<br />
corporelle ou incarnée. Incarnation tragique si elle pose la question de savoir<br />
comment nous pouvons supporter d’avoir un corps 3 , peut-être même d’être seulement<br />
un corps vivant : l’opéra évoque la disparition de notre personne quand cesse le<br />
souffle du chant. Le chant, comme expiration, enveloppe la question de la mortalité<br />
d’une existence personnelle arrimée à un organisme qui est son porte-voix.<br />
L’origine symbolique du chant d’opéra se trouve d’abord dans la voix écrite d’une<br />
partition, qui n’est pas celle d’une personne déterminée, mais d’un type de voix. C’est<br />
une voix-virtualité, « à chanter », ouverte à diverses possibilités vocales au sein d’un<br />
ensemble vocal et orchestral. Elle n’a pas de corps propre sinon celui de l’écrit, et, tant<br />
qu’elle n’est pas chantée, elle n’est pas individuée. La voix de la partition s’adresse<br />
virtuellement à d’autres voix inscrites dans la partition, toutes étant conjuguées aux<br />
voix chantantes des instruments de musique. Enfin, au-delà de la partition, elle<br />
s’adresse, à un public virtuel d’auditeurs 4 .<br />
1. La voix et l’opéra<br />
C’est un des paradoxes de l’opéra : il est enraciné dans les possibilités<br />
physiologiques d’un organisme vivant, tout en donnant le sentiment d’une quasi-<br />
1 S. CAVELL, Un ton pour la philosophie, III, « L’opéra et la voix retrouvée », Paris,<br />
Bayard, 1994.<br />
2 Le cogito, comme énonciation, suppose une voix en-deçà et au delà de l’Ego, il<br />
désubstantialise l’Ego, même si Descartes le réinvestissait de substantialité en parlant de res<br />
cogitans, oublieux du filet de voix qu’est l’énonciation, qui comme la voix toujours nous<br />
échappe et va vers un Autre. À qui Descartes adressait-il Je suis J’existe ?<br />
3 S. CAVELL, « La contre-philosophie et le gage de la voix », Un ton pour la<br />
philosophie, op. cit., p. 182 sq. : « Comment peut-on supporter d’avoir une voix, une voix qui<br />
toujours nous échappe, nous est confisquée? », et plus loin : « Cela commence à ressembler à<br />
la question de l’opéra ». Voir « Opera and the Lease of Voice », in A pitch of philosophy,<br />
Cambridge, Harvard University Press, 1994, p. 134. Un ton pour la philosophie, op. cit., p.<br />
191.<br />
4 Ce qui met en œuvre de manière particulière l’axe symbolique de l’interlocution qui<br />
traverse tous nos énoncés. Dans la culture occidentale, l’exemple privilégié est celui des<br />
Confessions d’Augustin, où un questionnement incessant Qui suis-je ? invoque de manière<br />
passionnée un Tu/Vous qui ne répond jamais. Voir SAINT AUGUSTIN, Confessions, Livre X,<br />
Paris, Les Belles Lettres, (1926) 1989.<br />
51