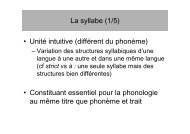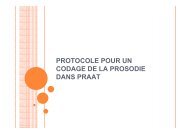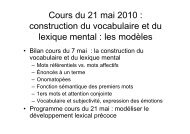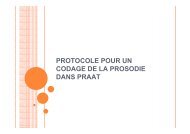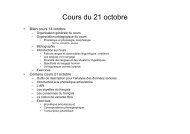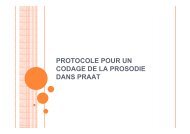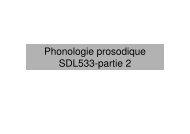Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
les uns les autres 1 . Ce pourquoi j’appelle l’opéra un dispositif de transcendance alors<br />
qu’il est aussi le lieu de l’incarnation du sens : cette tension entre immanence et<br />
transcendance est constitutive 2 .<br />
Comment comprendre que la voix soit au-delà de ce monde, au-delà du chanteur<br />
comme du spectateur-auditeur ? Revenons, dans le sillage de Freud, à une origine de<br />
la parole, et donc à un récit mythique ou à une manière mythologique de parler. On<br />
évoquera alors le cri de l’infans que seul peut entendre comme une parole un Autre<br />
inoubliable, qui deviendra pour l’enfant une sorte de demi-dieu, préhistorique et<br />
légendaire, irréductible aux parents ou à l’entourage empiriques : ce récit explique que<br />
la sonorisation infantile spontanée aille vers une signification qui lui vient, et lui<br />
viendra toujours, d’ailleurs. Cette origine destine et voue la voix à une aura de sacré,<br />
aura qui selon Lacan est un voile jeté sur un réel horrifiant : celui de ce corps viscéral<br />
qui l’engendre, humain trop humain, et même animal trop animal ; mais aussi celui de<br />
la mortalité de ce corps, ou bien de la sexualité qui a engendré le petit animal naissant<br />
voué à l’humanisation. Le psychanalyste Vives explique que les pulsions inarticulées<br />
qui animent le petit corps vivant se transforment, par la médiation de l’Autre<br />
inoubliable, en pulsion invocante susceptible d’une inscription, ce qui permettra<br />
l’écriture musicale de la partition. Selon Piera Aulagnier, des pre-représentations, ou<br />
pictogrammes, s’inscrivent chez l’enfant, et restent à jamais actives hors connaissance<br />
de tout Je. Un objet-voix se constitue ainsi pour chacun de nous à notre insu, objet à<br />
jamais perdu qui évoque le moment de grâce où nous avons été entendus, où on a<br />
répondu à notre appel 3 . S’installe alors une dynamique de retrouvailles qu’on nomme<br />
désir inconscient. Elle vise moins des personnes que l’objet insaisissable dont elles<br />
sont porteuses : une voix, un timbre, une inflexion, ou même un grain de voix, une<br />
brillance, un vernis qui nous font retrouver un sentiment béni de complétude. Telle<br />
serait la jouissance ou l’extase que nous éprouvons à l’écoute de certaines voix 4 . Nous<br />
recherchons toujours, dans une voix, quelque chose d’infra-verbal évoquant les « voix<br />
chères qui se sont tues », que nous n’entendrons plus, mais nous ne le savons pas. Cela<br />
traverse nos visées conscientes, les renforce ou les bouscule, compliquant notre vie<br />
amoureuse et la rendant incontrôlable. La voix, objet invisible, est un objet mythique.<br />
Le premier opéra de Monteverdi met justement en scène et en musique cette<br />
problématique d’une voix absente à retrouver 5 . Dans l’Orfeo, Orphée va chercher<br />
Eurydice aux enfers et l’arrache à la mort, mais il ne peut supporter qu’elle ne lui<br />
1 S. CAVELL, Un ton pour la philosophie, « L’opéra et la voix délivrée », op. cit., p.<br />
200.<br />
2 M. de GAUDEMAR, La voix des personnages, Paris, Les Belles Lettres, 2011, p. 173<br />
sq.<br />
3 Cavell l’exprime à sa manière en faisant de l’opéra une expression de la séparation.<br />
Voir S. Cavell, Un ton pour la philosophie, « L’opéra et la voix délivrée », op. cit. p. 212-213:<br />
« C’est une exposition au monde de la séparation du soi d’avec soi-même, dans lequel la<br />
division du soi dans la parole est exprimée comme la séparation d’avec quelqu’un qui<br />
représente pour ce soi la continuation du monde (…) Le caractère atroce ou absolu de cette<br />
séparation semble emprunter à la fois à la terreur de la séparation propre à l’enfance (le niveau<br />
du narcissisme primitif, où le cri que Wagner voit comme l’origine du chant est encore<br />
audible) et à la séparation des possibles, représentée par la perte de celui qui est revenu du<br />
domaine de la lumière, en qui des espoirs d’intelligibilité ont été placés, et s’effondrent ».<br />
4 Voir M. POIZAT, Le cri de l’ange-Essai sur la jouissance de l’amateur d’opéra,<br />
Paris, Métailié, 1986, 2001. Voir aussi R. BARTHES, Fragments d’un discours amoureux,<br />
Paris, Seuil, 1977, p. 131.<br />
5 S. CAVELL, Un ton pour la philosophie, « L’opéra et la voix délivrée », op. cit., p.<br />
198. M. de Gaudemar, La voix des personnages, op. cit., p. 254.<br />
53