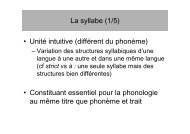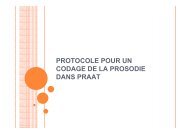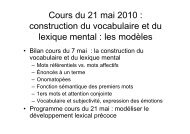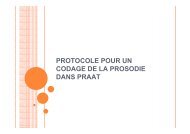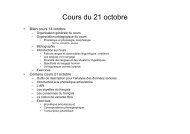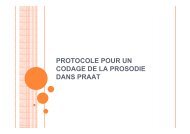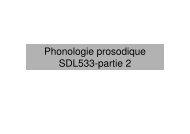Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
public, où elles ne sont tolérées que dans l’expression publique du deuil. Ce qui<br />
rapproche depuis des millénaires le féminin et le chant de déploration.<br />
L’étude de la voix tragique fait surgir le soubassement pulsionnel dont la cité<br />
ne veut rien savoir, sombre fond dont les femmes sont porteuses. Les mères en deuil<br />
passent de la douleur à la colère et à l’expression articulée. Privées de cette<br />
expression, les mères en deuil passent au crime. L’écoute et la réception du message<br />
douloureux sont pacifiantes. Hécube passe à l’acte meurtrier quand l’aide de la loi lui<br />
a été refusée par Agamemnon : elle accomplit alors un « travail de femme » (ergon), le<br />
meurtre du coupable 1 . L’opéra qui hérite de la tragédie pourrait-il conduire à une<br />
pacification de ce qui, en régime tragique, conduit au meurtre ou au sacrifice ? Le<br />
travail de Cavell sur les larmes efficaces, Contesting tears, conduit à cette question.<br />
Dans le chant lyrique de déploration, la gorge se desserre, le souffle passe. Le public<br />
qui respire au rythme du chant compatit avec la déplorante : il rend ainsi justice à celle<br />
qui n’a pas été entendue, à la victime de l’ordre social-symbolique qui s’est exprimée<br />
dans la vengeance ou le sacrifice de soi, comme Médée ou comme Desdemone.<br />
Transformées par l’expression vocale, les larmes sont efficaces dans une double<br />
mutation de la victime en héroïne, et de la douleur en jouissance libératrice. Miracle<br />
qui n’a qu’un temps : il ne dure que tant que dure le souffle du chant ! Mais la<br />
jouissance est pyromane et n’a que faire de la durée.<br />
Nous rêvons ensemble, à l’opéra, à un monde d’une absolue compréhension par-delà<br />
les contraintes de l’existence, du langage et de l’ordre social. À un monde capable<br />
d’accueillir sans rejet la part inconnue réputée féminine qui s’exprime dans le chant,<br />
mais que Freud appelait inconscient. L’excès pulsionnel est difficile à symboliser.<br />
Pourtant il passe dans le sémiotique, la part non significative et passionnée du chant,<br />
parfois à l’insu de celui/celle qui chante. Le chant fait passer au public ce qui<br />
s’oppose à l’expression : suffocation, étouffement, agonie.<br />
La voix actualise le claim virtuel, réclamation, exigence, revendication. Alors<br />
que les paroles de l’aria sont difficilement audibles, le message du claim passe<br />
clairement dans l’élément respirant de la pure vocalité et dans le rythme qui articule le<br />
souffle, par exemple dans les deux airs de la Reine de la nuit dans La flûte enchantée.<br />
L’excès de l’affect passionné devient audible pour le public dans l’air du saule de<br />
Desdemone chez Verdi, ou dans l’air de Boccherini où Médée en appelle vainement à<br />
la compassion de Jason. Le public, sans écouter les raisonnements calculateurs de<br />
Jason, compatit à la douleur de Médée. Il prend la place du grand écouteur divinisé<br />
auquel toute plainte s’adresse dans l’axe symbolique et virtuel de l’interlocution qui<br />
traverse nos énonciations. Cet axe unit l’émetteur comme sujet de l’inconscient, écrit<br />
barré car immaîtrisable, et un grand Autre comme auditeur virtuel (barré car n’existant<br />
pas). La subjectivité inconnue au sens de Cavell équivaut à un sujet inconscient qui<br />
s’adresse à l’Autre en une énonciation passionnée (passionnate utterance) 2 .<br />
Cri, appel, plainte et supplication sont autant de formes d’une expression<br />
passionnée révélant le sujet de l’énonciation. Un cri qui serait degré zéro de la<br />
symbolisation serait impossible à entendre, comme le tableau de Münch l’expose<br />
crûment. Je considère l’opéra comme une élaboration lyrique du cri. Le chant lyrique<br />
semble l’expression la plus proche du cri, dans les deux figures extrêmes de l’aigu et<br />
du grave où les <strong>mots</strong> sont inaudibles et tendent vers le silence.<br />
1 Ibid.<br />
2 Le grand Autre qui n’est plus une personne succède, selon Lacan, à l’Autre<br />
inoubliable de l’enfant chez Freud. Dans l’histoire de notre culture, il succède plutôt au Dieu<br />
des Confessions d’Augustin.<br />
56