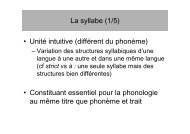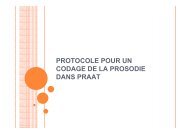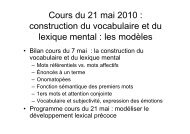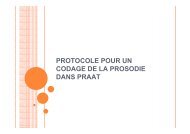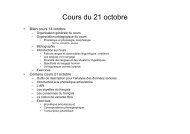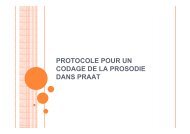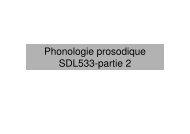Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
comme cela à souvent lieu à l’opéra), la voix cesse d’être transparente sous le sens. La<br />
musique est un de ces délicieux « parasitages » de l’énonciation qui a pour<br />
conséquence de rendre la voix perceptible et ce dans un but de jouissance esthétique. Il<br />
s’agit bien alors de jouir de la voix comme objet.<br />
Le chant, la musique, ce que l’on pourrait nommer ici le lyrisme, ne sont jamais que<br />
des parasitages de l’énonciation langagière ayant pour effet d’opacifier la voix afin de<br />
la rendre perceptible, le plus souvent dans un but esthétique pour jouir de la voix. Le<br />
même effet peut également surgir dans une situation où l’énonciation langagière est<br />
gestuelle, comme par exemple dans le cas d’un sourd qui signerait un énoncé. Grâce à<br />
une amplitude, à un enchaînement dans une continuité particulière des signifiants<br />
gestuels, le sourd « signant » arrive à produire une sorte de chant gestuel, de<br />
chorégraphie, mettant en <strong>avant</strong> la corporéité du support de son discours, au point de le<br />
rendre parfois inintelligible.<br />
Si le rapport de tension entre voix et signifiant s’applique intégralement à propos du<br />
signifiant gestuel du sourd signant, il en est de même pour ce qui concerne le<br />
signifiant écrit. La calligraphie illustre parfaitement comment, par l’introduction d’une<br />
certaine continuité, d’un mouvement, d’un rythme, bref du corps, dans une inscription<br />
signifiante, celle-ci s’en trouve transformer, devenant objet d’art et de jouissance au<br />
détriment de l’intelligibilité : il est en effet bien difficile de retrouver derrière le<br />
dessein du calligraphe le sens de l’énoncé calligraphié. Il est donc naturel de retrouver<br />
dans ces trois modalités du chant, le chant sonore le chant gestuel et le chant<br />
graphique les mêmes effets : présentification de l’enjeu du corps et rapport paradoxal<br />
au signifiant dans la mesure où ce qui en est le support, la voix dans sa modalité<br />
acoustique, gestuelle ou graphique, vient distordre le signifiant jusqu’à en évacuer la<br />
dimension du sens. C’est dans ce processus paradoxal que résident les fondements de<br />
l’effet de jouissance produit et, par voie de conséquence, les fondements de l’art, qui,<br />
dans chacune de ces modalités, sonore, visuelle et graphique, vise tout à la fois à<br />
susciter et à réguler, par les règles de l’art, la jouissance liée à l’objet en jeu sous ses<br />
diverses modalités.<br />
À partir de là, deux éléments peuvent être avancés qui nous permettront de cerner en<br />
quoi la voix, telle que la psychanalyse l’appréhende, excède les enjeux de<br />
signification.<br />
Le premier c’est qu’il est impropre de dire que l’oiseau chante. On peut dire, à la<br />
limite, qu’il parle, mais pas qu’il chante. Les modulations, la mélodie de son<br />
énonciation sonore font en effet partie intégrante de son énoncé signifiant, qu’il soit<br />
signal d’alerte, appel à la femelle ou marque territoriale. Jamais il ne va moduler sa<br />
propre énonciation pour la distordre dans un but autre que celui qui correspond son<br />
émission naturelle. Il y a chez l’oiseau adéquation entre l’émission et le message. La<br />
voix n’est pas ici en excès et il y a fort à parier que l’on rencontre pas chez l’oiseau,<br />
même lorsqu’il s’égosille ou chante à tue tête toute une journée pour appeler la<br />
femelle, de phénomène d’aphonie. C’est bien parce que la voix est chez l’être humain<br />
un objet de jouissance qu’il peut être le lieu de constructions de symptômes.<br />
Le second, c’est que dans la logique définie ci-dessus, la danse, la chorégraphie et la<br />
calligraphie relèvent en fait de l’art de la voix sous sa modalité gestuelle ou écrite.<br />
Pour montrer que cette énoncé ne relève pas seulement du goût du paradoxe, il<br />
suffirait de rappeler que toute relation de communication langagière s’effectue sous les<br />
deux modalités : acoustique et gestuelle. Dans le cas d’un échange de paroles, où le<br />
signifiant s’énonce dans le registre vocal sonore donc, toute parole dans toute culture<br />
77