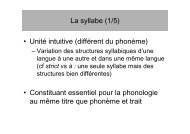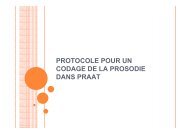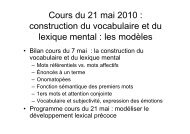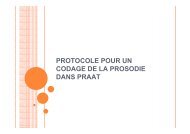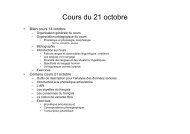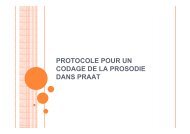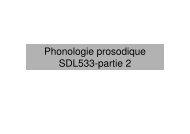You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
supposer qu’il y entend une réponse possible à la quête désirante enclenchée par la<br />
pulsion invocante. L’amateur y perçoit son objet et tente alors de s’en approcher, voire<br />
de s’en emparer 1 ...<br />
C’est ce point de réel qui excède la parole qui paradoxalement en rendra<br />
l’investissement possible par l’infans. En effet, la parole est transmise à l’infans en<br />
tant qu’ hantée par le timbre de la voix maternelle. Timbre d’ailleurs que l’infans<br />
reconnaît très tôt, comme on pu le montrer les expériences des psychologues<br />
généticiens menées chez des nourrissons âgés de quelques heures. Le timbre est pour<br />
la voix du sujet l’équivalent des empreintes digitales, on parle d’ailleurs d’empreinte<br />
vocale. Le timbre est à percevoir ici au-delà du simple paramètre vocale dans sa<br />
dimension de pure continuité. La voix en tant que timbre, Aristote la nomme, dans son<br />
traité De l’âme, phônè 2 . Elle n’est pas articulée. Elle ne se réfère pas à un objet dont<br />
elle transmettrait la signification à un destinataire de la part d’un destinateur. Elle est<br />
inarticulée, elle se différencie pour autant du bruit en ce qu’elle fait sens. Elle n’est pas<br />
le signe arbitraire mis à la place d’une chose, le signe étant ce qui représente quelque<br />
chose pour quelqu’un. C’est du continu, elle n’est pas décomposable en unités<br />
discrètes. Elle travaille la parole et parfois l’assourdit comme le montre la clinique de<br />
l’aphonie. Le timbre hante la voix articulée, et parfois vient occuper le devant de la<br />
scène. Avec la parole, les sujets communiquent, débattent, décident, racontent... avec<br />
la voix, dans sa dimension de timbre, le sujet (se) manifeste. Lacan esquisse une voie<br />
dans l’analyse des relations entre le sujet et cette dimension réelle de la voix qu’est le<br />
timbre : « Le sujet produit la voix. Et je dirai plus, nous aurons à faire intervenir cette<br />
fonction de la voix, pour autant que faisant intervenir le poids du sujet, le poids réel du<br />
sujet dans le discours » 3 . Parfois le dire vient griffer le dit comme le montre le cas de<br />
Dora rapporté par Freud où l’on peut repérer cette manifestation du sujet à l’occasion<br />
« de ses attaques de toux avec perte de la voix » (Stimmlosigkeit) 4 . La toux est ce qui<br />
permet de donner de la voix sans que rien ne soit articulé. Cela vient marquer une<br />
butée de l’acte de parole sur sa propre jouissance corporelle : quand le larynx<br />
dysfonctionne comme organe phonatoire c’est comme zone érogène qu’il<br />
surfonctionne. Or, dans ce cas, donner de la voix c’est en faire émerger le timbre.<br />
Infans, cela a de la voix, mais n’articule pas. À partir de là, nous pouvons dire que<br />
cette dimension de la voix, comme l’inconscient ne connaît pas le temps et donc n’a<br />
pas à proprement parler d’histoire. La fameuse rupture de la mue situant dans un<br />
registre différent la voix du garçon concerne essentiellement la tessiture, il y a dans ce<br />
cas, rupture et donc historicisation. Si le timbre effectivement se trouve modifié au<br />
cours de ce processus c’est moins dans le sens d’un <strong>avant</strong> et après (l’aigu passant au<br />
grave, transformation génétique et « catastrophique » au sens que lui a donné le<br />
mathématicien René Thom) que dans celui topologique où les espaces traitant le son<br />
laryngé se trouvant modifiés, le timbre s’en trouve changé. Pour autant, il n’y a pas,<br />
comme dans le cas de la hauteur de la voix, rupture. Le timbre adulte est une<br />
modification du timbre de l’enfant et celui-ci comprend déjà celui de l’adulte dans<br />
lequel résonne pour toujours celui de l’enfant. Le timbre, tel que nous essayons de<br />
1 C’est le cas du Baron de Gortz dans le Château des Carpathes de Jules Verne.<br />
2 ARISTOTE, De l’âme, II, 8. Voir trad. fr. par P. Thillet, Paris, Gallimard, 2005, note<br />
290, p. 362.<br />
3 J. LACAN, Le désir et son interprétation, séminaire inédit, 1958-1959.<br />
4 S. FREUD, Fragment d’une analyse d’hystérie (1905), trad fr., Œuvres Complètes,<br />
Tome VI, Paris, P.U.F., 2006, p. 183-301.<br />
79