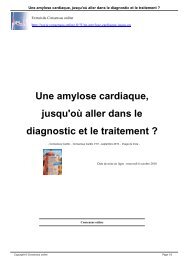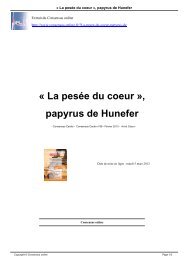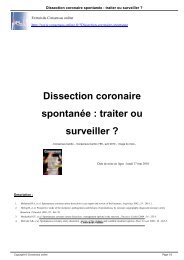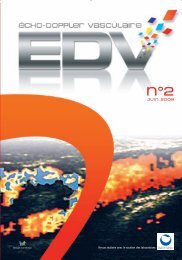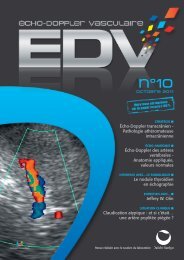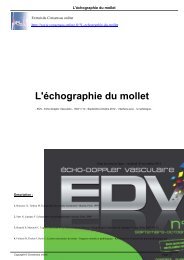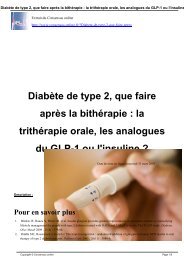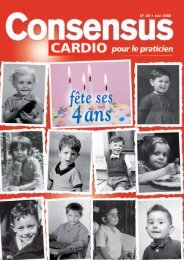Télécharger la revue (PDF) - Consensus Online
Télécharger la revue (PDF) - Consensus Online
Télécharger la revue (PDF) - Consensus Online
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
éponse immune (le privilège immunologique de ces cellules<br />
mésenchymateuses est, en effet, très discuté) n’est pas nécessairement<br />
un inconvénient dès lors que les cellules ont survécu<br />
assez longtemps pour exercer cet effet paracrine, et<br />
sur ce p<strong>la</strong>n, les cellules mésenchymateuses (de <strong>la</strong> moelle sanguine<br />
ou du tissu adipeux) sont, en effet, de bons candidats,<br />
compte tenu de leur forte activité sécrétoire.<br />
A côté de <strong>la</strong> fonction des cellules, un autre facteur prédictif<br />
du résultat a été identifié : le degré de leur rétention dans<br />
le myocarde cible. Malheureusement, les observations<br />
concordent pour montrer que cette rétention est très faible.<br />
Plusieurs approches sont donc en cours d’évaluation<br />
pour tenter d’augmenter le nombre de cellules persistant<br />
dans le tissu receveur. Sans doute <strong>la</strong> plus simple est-elle fondée<br />
sur de nouveaux cathéters permettant une extravasation<br />
extravascu<strong>la</strong>ire des cellules et diminuant donc d’autant<br />
leur fuite vers les poumons ou <strong>la</strong> rate. Une stratégie plus é<strong>la</strong>borée,<br />
dont les premiers résultats cliniques ont été jugés<br />
encourageants, consiste à recourir à des moyens physiques<br />
(chocs par ultrasons) pour stimuler <strong>la</strong> production par le myocarde<br />
de facteurs susceptibles d’« attirer » les cellules circu<strong>la</strong>ntes<br />
et donc de les « figer » dans <strong>la</strong> zone cible. C’est toutefois<br />
une approche c<strong>la</strong>ssique (injection intracoronaire<br />
précoce après l’infarctus de cellules médul<strong>la</strong>ires mononucléées<br />
autologues chez des patients dont <strong>la</strong> fraction d’éjection<br />
est ≤ 45%) qui a été retenue pour être évaluée dans un<br />
vaste essai européen randomisé dont <strong>la</strong> taille (3 000 patients)<br />
devrait permettre de c<strong>la</strong>rifier <strong>la</strong> question.<br />
Résultats dans l’insuffisance cardiaque<br />
chronique<br />
Dans le cadre de l’insuffisance cardiaque chronique, les résultats<br />
publiés à ce jour n’emportent pas davantage <strong>la</strong> conviction.<br />
Qu’il s’agisse de cellules médul<strong>la</strong>ires ou de myob<strong>la</strong>stes<br />
(cellules souches squelettiques), que ces cellules soient injectées<br />
par voie épicardique lors de pontages coronaires ou par<br />
cathétérisme intracoronaire ou endocardique, aucune amélioration<br />
cliniquement pertinente n’a pu être démontrée<br />
dans les re<strong>la</strong>tivement rares études randomisées, contrôlées<br />
et en double insu. Quelques essais ont néanmoins rapporté<br />
des résultats encourageants qui concernent habituellement<br />
<strong>la</strong> fonction régionale ou <strong>la</strong> perfusion et suggèrent qu’un certain<br />
effet thérapeutique, même modeste, est néanmoins<br />
possible.<br />
Sur <strong>la</strong> base de données expérimentales concordantes, il est<br />
c<strong>la</strong>ir cependant que ce bénéfice n’est pas dû, à ce jour, à une<br />
véritable régénération du myocarde. En effet, l’espoir d’une<br />
p<strong>la</strong>sticité des cellules adultes se transdifférenciant en cardiomyocytes<br />
sous l’influence de leur nouvel environnement<br />
myocardique semble utopique. Le bénéfice inconstamment<br />
observé des injections de cellules muscu<strong>la</strong>ires ou médul<strong>la</strong>ires<br />
s’explique donc ici encore par l’effet des facteurs sécrétés<br />
par les cellules. La vraie question, non tranchée, est de savoir<br />
si ces effets paracrines de cellules transp<strong>la</strong>ntées dans des<br />
cicatrises fibreuses sont suffisamment puissants pour avoir<br />
un impact thérapeutique ou s’il ne faut pas plutôt poursuivre<br />
l’objectif initial d’un remp<strong>la</strong>cement physique des cellules<br />
myocardiques détruites, par <strong>la</strong> transp<strong>la</strong>ntation de cellules<br />
CONSENSUS CARDIO pour le praticien - N° 82 • Octobre 2012<br />
intrinsèquement douées d’un véritable potentiel de différenciation<br />
cardiomyogénique, susceptibles de s’intégrer sur<br />
le p<strong>la</strong>n électromécanique dans le myocarde receveur et pouvant<br />
ainsi contribuer à améliorer sa fonction contractile.<br />
SCIPIO et CADUCEUS : deux essais cliniques<br />
utilisant des cellules cardiaques<br />
C’est dans ce contexte qu’une forte publicité, liée à l’excellence<br />
scientifique du journal qui a publié ces résultats et<br />
re<strong>la</strong>yée par les médias, a été donnée à deux essais cliniques<br />
qui ont utilisé des cellules cardiaques. Identifiées même comme<br />
des cellules souches cardiaques dans le premier (SCIPIO), elles<br />
ont été isolées (sur <strong>la</strong> base d’un marqueur spécifique) et cultivées<br />
in vitro à partir d’une biopsie de l’auricule droit réalisée<br />
lors d’une intervention de chirurgie cardiaque, avant<br />
d’être réinjectées par voie intracoronaire quelques semaines<br />
plus tard (2) . Les spécialistes s’accordent aujourd’hui à reconnaître<br />
que <strong>la</strong> multitude de failles méthodologiques entachant<br />
cet essai ne permet pas de conclure que ces cellules<br />
ont réellement exercé un effet « régénérateur » et jette<br />
même un doute sur le bénéfice fonctionnel rapporté. Au<br />
demeurant, l’existence même de cellules souches cardiaques<br />
dans le cœur humain adulte et a fortiori pathologique, qui<br />
seraient susceptibles d’être mobilisées et de se substituer<br />
aux cardiomyocytes détruits, est fortement discutée.<br />
Plus modeste dans ses ambitions (on y parle de cellules cardiaques<br />
sans préjuger de leur caractère de cellules souches),<br />
le second essai (CADUCEUS) a consisté à prélever un fragment<br />
de muscle ventricu<strong>la</strong>ire droit par biopsie transjugu<strong>la</strong>ire,<br />
à en isoler des cellules qui semblent assez hétérogènes,<br />
avec une forte composante mésenchymateuse et à les réinjecter,<br />
comme dans l’étude précédente, par voie intracoronaire<br />
(3) . Ici encore, les résultats sont jugés positifs par les<br />
auteurs, même si certains s’interrogent sur le fait que le<br />
bénéfice, établi par l’IRM sous forme d’une réduction de <strong>la</strong><br />
zone nécrosée, ne s’accompagne pas d’une amélioration de<br />
<strong>la</strong> fonction cardiaque. L’évaluation de cette stratégie va<br />
néanmoins se poursuivre sous <strong>la</strong> forme d’un plus vaste essai<br />
randomisé (ALLSTAR) qui utilisera le même type de cellules,<br />
mais d’origine allogénique. Le fait que les auteurs assument<br />
l’hypothèse de <strong>la</strong> disparition, par rejet, de ces cellules traduit<br />
bien que dans leur esprit, elles agissent plus ici encore<br />
par des effets paracrines que par <strong>la</strong> formation d’un tissu<br />
contractile.<br />
Cette génération d’un nouveau myocarde ne semble en fait<br />
pouvoir être obtenue que par des cellules souches pluripotentes,<br />
prédifférenciées in vitro vers un phénotype cardiaque<br />
ou plus généralement mésodermique (avec alors possibilité<br />
d’une différenciation à <strong>la</strong> fois cardiaque et vascu<strong>la</strong>ire) avant<br />
d’être transp<strong>la</strong>ntées. C’est cette approche qui explique l’intérêt<br />
porté aux cellules souches embryonnaires dérivées<br />
d’embryons très précoces (4-6 jours après <strong>la</strong> fécondation)<br />
conçus dans le cadre d’une aide à <strong>la</strong> procréation et ne faisant<br />
plus l’objet d’un projet parental. Leur utilisation clinique<br />
n’est plus un mythe puisque deux essais sont en cours :<br />
- l’un a utilisé ces cellules prédifférenciées en oligodendrocytes<br />
pour réparer des lésions traumatiques de <strong>la</strong> moelle<br />
épinière (il a été interrompu pour des raisons financières) ;<br />
15