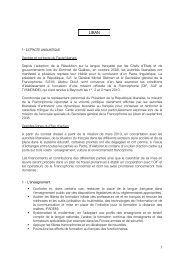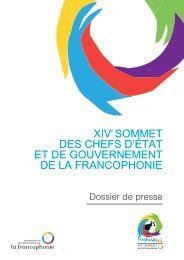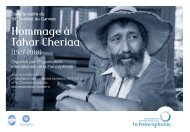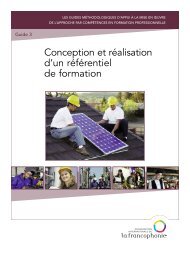Etats généraux de l'enseignement du français en Afrique ...
Etats généraux de l'enseignement du français en Afrique ...
Etats généraux de l'enseignement du français en Afrique ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE FRANCOPHONEla langue mais plutôt comme un facteur d’<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t et d’adaptabilité d’une langue<strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue copropriété d’un espace <strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus vaste et <strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus différ<strong>en</strong>tculturellem<strong>en</strong>t et où le multilinguisme est la règle d’or. Le français vi<strong>en</strong>t pour cohabiteravec les langues <strong>de</strong> souches nationales et non plus pour exiger le droit à l’unicitélinguistique. L’érosion <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> la langue que dénonc<strong>en</strong>t les puristes classiquesdoit être analysée <strong>en</strong> termes <strong>de</strong> variation car la langue n’est pas touchée dans son noyau<strong>du</strong>r. La syntaxe utilisée est puisée dans les possibilités offertes par la langue alors que lelexique se diversifie <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> l’espace d’accueil et cela, parce que le français estobligé <strong>de</strong> r<strong>en</strong>dre compte d’autres cultures. Ce qui remet un peu <strong>en</strong> cause l’hypothèse <strong>de</strong>certains anthropologues linguistes qui affirm<strong>en</strong>t qu’une langue est le reflet d’une cultureet partant <strong>de</strong> la p<strong>en</strong>sée. Le français <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce se trouve et se justifie dans l’usage etnon plus dans une langue idéalisée dont la parole voire le discours se doit d’être le refletfidèle. De la performance linguistique on doit pouvoir remonter pour apprécier voirereconstituer la compét<strong>en</strong>ce. L’opposition linguistique langue/discours se trouveinversée dans le champ <strong>de</strong>s pratiques sociales <strong>de</strong> la langue. Rechercher le français <strong>de</strong>référ<strong>en</strong>ce con<strong>du</strong>it donc à la <strong>de</strong>scription d’ un usage social <strong>du</strong> français.Définir un français <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce c’est alors pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte la réalitésociolinguistique <strong>de</strong> l’espace francophone considéré. L’Hexagone n’est plus le seulespace <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce mais plutôt un espace parmi tant d’autres ayant <strong>en</strong> commun le sanget la chair français et différ<strong>en</strong>ts par la couleur, reflet <strong>de</strong> l’influ<strong>en</strong>ce socio-culturelle etgéographique <strong>de</strong> la zone d’accueil <strong>de</strong> cette langue <strong>de</strong> partage qui doit aujourd’hui sabeauté et son ét<strong>en</strong><strong>du</strong>e d’usage aux différ<strong>en</strong>ces et à la pluriculturalité dont elle se nourrit.Francophonie et français <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce rest<strong>en</strong>t une belle problématique à la foislinguistique, sociolinguistique et didactique pour le XXI e siècle. Après l’ère <strong>de</strong> laFrancophonie politique, linguistique et économique sonne l’ère <strong>de</strong> la Francophoniedidactique qui doit répondre forcém<strong>en</strong>t à la question « quel français <strong>en</strong>seigner etcomm<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>seigner ? ». À cette question lancinante, la France a proposé à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>sdiffér<strong>en</strong>tes les réponses stratégiques suivantes :– 1954, réalisation commanditée par les autorités ministérielles françaises d’une étu<strong>de</strong><strong>de</strong> statistique lexicale et grammaticale <strong>en</strong> vue <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong> place un fondspermettant d’<strong>en</strong>seigner un français élém<strong>en</strong>taire ;– le français fondam<strong>en</strong>tal coordonné par Georges Goug<strong>en</strong>heim était né <strong>en</strong>tre 1970 et1972 avec la publication <strong>du</strong> premier et <strong>du</strong> second <strong>de</strong>gré ;– 1976, verra la mise <strong>en</strong> place <strong>du</strong> niveau seuil ;– 1996, réalisation d’un cadre europé<strong>en</strong> commun <strong>de</strong> référ<strong>en</strong>ce pour l’appr<strong>en</strong>tissage etl’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s langues.Quant à l’<strong>Afrique</strong> noire francophone, <strong>de</strong>vant le constat <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>jeu majeur <strong>de</strong> la maîtrise<strong>de</strong> la langue d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t dès le début <strong>du</strong> cycle primaire, elle a apporté une premièreréponse par l’élaboration <strong>de</strong> la Métho<strong>de</strong> pour Parler Français (MPF) qui s’est fortem<strong>en</strong>tinspirée <strong>du</strong> français fondam<strong>en</strong>tal dans son lexique et sa grammaire implicite. Cetteexpérim<strong>en</strong>tation didactique a été interrompue dans les années 80.Depuis lors le sil<strong>en</strong>ce didactique <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus pesant et difficile à supporterdans nos salles <strong>de</strong> classes. Nos prés<strong>en</strong>tes réflexions doiv<strong>en</strong>t être l’occasion <strong>de</strong> faireLIBREVILLE (GABON), 17 AU 20 MARS 200363