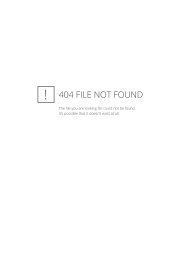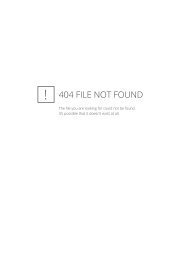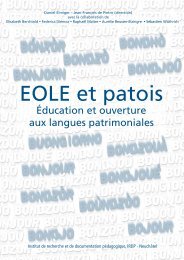L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE DANS LES CLASSES ... - IRDP
L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE DANS LES CLASSES ... - IRDP
L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE DANS LES CLASSES ... - IRDP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L'enseignement de la musique dans les classes primaires de première année de Suisse romande__________________________________________________________________________________________Deux causes paraissent être à l’origine de cette transposition. Les représentations desenseignants au sujet de la musique, comme nous l’avons relevé précédemment, influencentle praticien dans le choix des domaines à enseigner et sont à leur tour influencées par leniveau musical du généraliste. La formation (initiale ou continue), ensuite, préparel’enseignant à la pratique de la musique dans sa classe en adéquation avec les textes etmoyens officiels. Nous constatons, en effet, qu’il ne suffit pas de munir le praticien d’uneméthode pour que ce dernier puisse l’utiliser et enseigner correctement la musique.Y a-t-il un (des) domaine(s) favorisé(s) dans l’enseignement de la musique en 1P ?Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la majorité des enseignants ont des domainesfavoris. Nous constatons que, comme pour les représentations, trois domaines se dégagentde manière importante. L’écoute dirigée, dans un premier lieu, est le domaine le plusenseigné pour 47 % de notre échantillon. Le rythme reste un domaine apprécié par 54 % desgénéralistes et le chant est le préféré pour 73 % des praticiens romands de première annéeprimaire.Comme pour le paragraphe précédent, nous constatons que les généralistes préfèrent desnotions faciles à enseigner, ne demandant qu’un bas niveau d’expertise pédagogique etmusicale.Force est de constater que nous sommes à nouveau confronté à un cas de transpositiondidactique de type senso latu. En effet, nous observons un certain nombre de décalagesentre la matière proposée par les discours officiels et l’enseignement dans les classes. Lesactivités les plus structurées, celles demandant le moins de préparation, sont privilégiées. Cetagissement a pour conséquence une transposition didactique entre ce qu’est la musique etce que les généralistes en enseignent. Comme nous l’avons déjà vu, la musique, pourbeaucoup d’enseignants, ne consiste qu’à chanter en rythme. Outre l’importance nonnégligeable du chant pour les petits enfants (motivation, plaisir, socialisation…), cettereprésentation influence grandement les choix d’exercices et de domaines à travailler.Comment les enseignants utilisent-ils les moyens romands (choix du répertoire,exercices…) ?Pour les domaines spécifiques de l’écoute dirigée, de l’audition et du rythme, lesenseignants ont tendance à respecter les propositions des auteurs. La richesse desexercices et des fiches didactiques de la méthodologie ont leur raison d’être. Il n’en est pasforcément de même pour le choix du répertoire de chants.Nous avons déjà constaté que les praticiens prenaient beaucoup plus de liberté dansl’élaboration du répertoire de chants. En fait, seulement 1 % des enseignants interrogésavoue puiser ses sources uniquement dans le large index proposé par Bertholet et Petignat.D’où provient cette opposition entre le chant et les autres domaines constituant l’éducationmusicale ? Alors que les enseignants respectent les exercices et propositions des auteurs pourla majorité des domaines, une grande partie d’entre eux adoptent une position libertaire, voirelaxiste, lorsqu’il s’agit d’élaborer un répertoire de chants. Cette dualité s’explique par le faitqu’un praticien, par manque de maîtrise, désintérêt vis-à-vis d’un domaine… se référera auxpropositions des auteur du support de manière à enseigner convenablement la matière.48