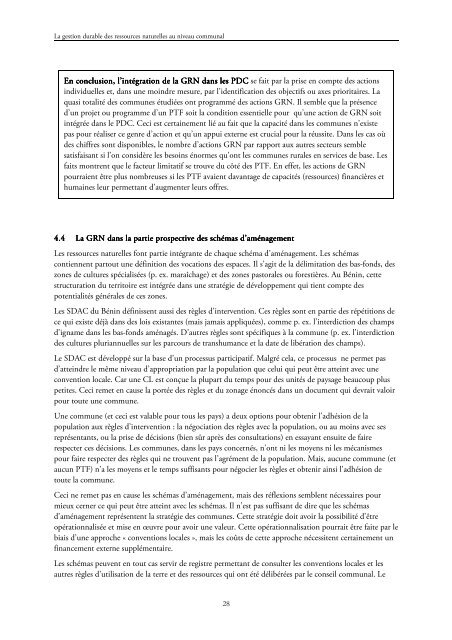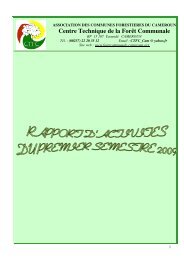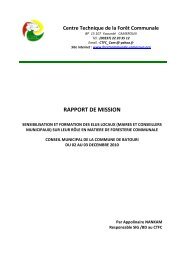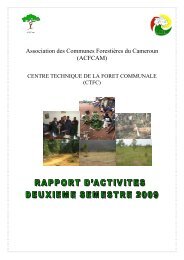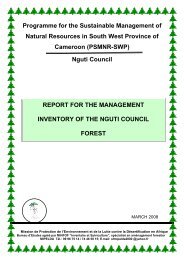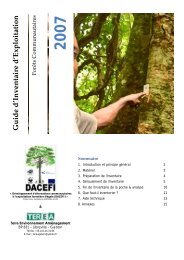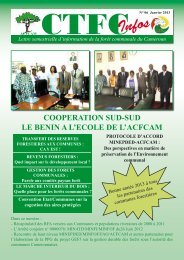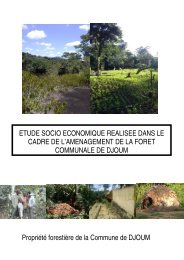<strong>La</strong> <strong>gestion</strong> <strong>durable</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>naturelles</strong> <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>communal</strong>Dans le nord du Bénin, les problèmes <strong>au</strong>tour <strong>des</strong> RN agricoles sont très inquiétants mais les hommespolitiques loc<strong>au</strong>x n’ont pas cette perception. Cependant, on ne peut pas dire qu’il y ait moins d’actions deGRN du fait de cette perception minimisée de la gravité <strong>des</strong> problèmes.Il est malheureusement impossible de dire si l’outil d’analyse systémique <strong>des</strong> RN élaboré <strong>au</strong> Bénin a eu unimpact. En ce qui concerne l’intégration de la GRN dans les PDC, il n’y a pas de différence par rapport<strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres pays.Comment interpréter ces chiffres et comprendre pourquoi les programmes ont le sentiment que laGRN n’est pas suffisamment prise en compte ?Est-ce qu’il f<strong>au</strong>t tirer la conclusion que si le programme ou d’<strong>au</strong>tres PTF œuvrant dans la GRN n’étaientpas sur place, <strong>au</strong>cune action GRN ne se trouverait dans les PDC ?Certains indices prouvent que cette conclusion n’est pas valable. En général, s’il y a une priorisation de laGRN, il s’agit d’une réponse à <strong>des</strong> problèmes réels de la population. Mais il est <strong>au</strong>ssi vrai que, sans lessolutions apportées par les PTF, les populations <strong>au</strong>raient du mal à définir <strong>des</strong> actions de GRN ?Les offres limitées <strong>des</strong> PTF en GRN s’expliquent moins par une demande insuffisante <strong>des</strong> populations(surtout si les actions de GRN peuvent leur apporter <strong>des</strong> bénéfices substantiels) que par <strong>des</strong> facteurstouchant les PTF eux-mêmes, tels que le manque de moyens financiers, le manque de personnel ou lemanque de solutions disponibles à proposer. L’expérience de tous les programmes montre <strong>au</strong>ssi que lessolutions offertes par les programmes n’étaient pas bien connues <strong>des</strong> populations. Mais dès que <strong>des</strong> succèssont communiqués <strong>au</strong>x communes voisines, la demande dépasse la capacité du programme. <strong>La</strong> question du« scaling up » 3 se pose. Il semble que très peu de PTF offrent un appui approprié pour mener <strong>des</strong> actionsde GRN et les communes pensent qu’elles ne pourront pas réussir sans appui externe.<strong>La</strong> dominance apparente <strong>des</strong> investissements soci<strong>au</strong>x (éducation, santé et e<strong>au</strong>) dans les PDC s’expliquefacilement et doit être analysée dans son contexte. Les communes ont une obligation de fournir <strong>des</strong>services de base à la population, ce qui n’existe pas pour <strong>des</strong> actions de GRN. En plus, les hommespolitiques commun<strong>au</strong>x doivent répondre <strong>au</strong>x besoins de la population et montrer qu’ils ont pris <strong>au</strong> sérieuxles doléances exprimées. Il est clair que la population attend en tous cas <strong>des</strong> activités de la commune dansles secteurs e<strong>au</strong>, santé et éducation. Mais il est moins évident que la population attende <strong>des</strong> actions deGRN de la commune.Une comparaison <strong>des</strong> coûts inscrits dans les PDC entre les actions concernant les infrastructures et lesactions de GRN, on a l’impression que la GRN est négligée. En réalité, il s’agit tout simplement d’une<strong>au</strong>tre façon de planifier dans ces deux domaines. 4 Mais si l’on mesure plus tard les t<strong>au</strong>x de réalisation parrapport <strong>au</strong>x prévisions, les actions de GRN atteignent un meilleur t<strong>au</strong>x de réalisation que celles concernantles infrastructures sociales. Cette situation s’explique parce que les PTF sont sur place.Vu ces réflexions, les constats faits à Ségou que 23% <strong>des</strong> actions dans les secteurs concernés par l’étu<strong>des</strong>ont de la catégorie GRN et que 26% de l’ensemble <strong>des</strong> axes dans les PDC <strong>au</strong> Niger sont liés à la GRNsemblent plutôt encourageants et montrent un fort intérêt de la population et <strong>des</strong> conseils commun<strong>au</strong>x.Dans la situation de manque que la majorité <strong>des</strong> populations connaissent, on ne peut pas s’attendre à ceque la GRN figure en meilleure position. Quelle population qui n’a pas accès <strong>au</strong>x soins de santédemandera en priorité un aménagement <strong>des</strong> RN ?3 Extension <strong>des</strong> activités <strong>au</strong>-delà <strong>des</strong> sites pilotes pour couvrir la zone d'intervention sur une plus grande échelle.4 Be<strong>au</strong>coup de communes ont inclus une très longue liste d’infrastructures de base. Cette pratique n’est pas différentede celle <strong>des</strong> « programmes paniers sectoriels » qui ne sont jamais sûrs du montant disponible chaque année pour lefinancement <strong>des</strong> infrastructures. Néanmoins, ces programmes mettent toutes les infrastructures souhaitées (dans cecas, filtrées par <strong>des</strong> normes nationales) sur une liste. Cette liste est répartie sur une dizaine d’années avec peut-être 20infrastructures par an. Le financement annuel suffit parfois pour trois, parfois pour dix infrastructures et les <strong>au</strong>tressont repoussées à l’année suivante. Il n’y a pas de différence substantielle par rapport <strong>au</strong>x listes <strong>des</strong> communes.27
<strong>La</strong> <strong>gestion</strong> <strong>durable</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>naturelles</strong> <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>communal</strong>En conclusion, l’intégration de la GRN dans les PDC se fait par la prise en compte <strong>des</strong> actionsindividuelles et, dans une moindre mesure, par l’identification <strong>des</strong> objectifs ou axes prioritaires. <strong>La</strong>quasi totalité <strong>des</strong> communes étudiées ont programmé <strong>des</strong> actions GRN. Il semble que la présenced’un projet ou programme d’un PTF soit la condition essentielle pour qu’une action de GRN soitintégrée dans le PDC. Ceci est certainement lié <strong>au</strong> fait que la capacité dans les communes n’existepas pour réaliser ce genre d’action et qu’un appui externe est crucial pour la réussite. Dans les cas où<strong>des</strong> chiffres sont disponibles, le nombre d’actions GRN par rapport <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres secteurs semblesatisfaisant si l’on considère les besoins énormes qu’ont les communes rurales en services de base. Lesfaits montrent que le facteur limitatif se trouve du côté <strong>des</strong> PTF. En effet, les actions de GRNpourraient être plus nombreuses si les PTF avaient davantage de capacités (<strong>ressources</strong>) financières ethumaines leur permettant d’<strong>au</strong>gmenter leurs offres.4.4 <strong>La</strong> GRN dans la partie prospective <strong>des</strong> schémas d’aménagementLes <strong>ressources</strong> <strong>naturelles</strong> font partie intégrante de chaque schéma d’aménagement. Les schémascontiennent partout une définition <strong>des</strong> vocations <strong>des</strong> espaces. Il s’agit de la délimitation <strong>des</strong> bas-fonds, <strong>des</strong>zones de cultures spécialisées (p. ex. maraîchage) et <strong>des</strong> zones pastorales ou forestières. Au Bénin, cettestructuration du territoire est intégrée dans une stratégie de développement qui tient compte <strong>des</strong>potentialités générales de ces zones.Les SDAC du Bénin définissent <strong>au</strong>ssi <strong>des</strong> règles d’intervention. Ces règles sont en partie <strong>des</strong> répétitions dece qui existe déjà dans <strong>des</strong> lois existantes (mais jamais appliquées), comme p. ex. l’interdiction <strong>des</strong> champsd’igname dans les bas-fonds aménagés. D’<strong>au</strong>tres règles sont spécifiques à la commune (p. ex. l’interdiction<strong>des</strong> cultures pluriannuelles sur les parcours de transhumance et la date de libération <strong>des</strong> champs).Le SDAC est développé sur la base d’un processus participatif. Malgré cela, ce processus ne permet pasd’atteindre le même nive<strong>au</strong> d’appropriation par la population que celui qui peut être atteint avec uneconvention locale. Car une CL est conçue la plupart du temps pour <strong>des</strong> unités de paysage be<strong>au</strong>coup pluspetites. Ceci remet en c<strong>au</strong>se la portée <strong>des</strong> règles et du zonage énoncés dans un document qui devrait valoirpour toute une commune.Une commune (et ceci est valable pour tous les pays) a deux options pour obtenir l’adhésion de lapopulation <strong>au</strong>x règles d’intervention : la négociation <strong>des</strong> règles avec la population, ou <strong>au</strong> moins avec sesreprésentants, ou la prise de décisions (bien sûr après <strong>des</strong> consultations) en essayant ensuite de fairerespecter ces décisions. Les communes, dans les pays concernés, n’ont ni les moyens ni les mécanismespour faire respecter <strong>des</strong> règles qui ne trouvent pas l’agrément de la population. Mais, <strong>au</strong>cune commune (et<strong>au</strong>cun PTF) n’a les moyens et le temps suffisants pour négocier les règles et obtenir ainsi l’adhésion detoute la commune.Ceci ne remet pas en c<strong>au</strong>se les schémas d’aménagement, mais <strong>des</strong> réflexions semblent nécessaires pourmieux cerner ce qui peut être atteint avec les schémas. Il n’est pas suffisant de dire que les schémasd’aménagement représentent la stratégie <strong>des</strong> communes. Cette stratégie doit avoir la possibilité d’êtreopérationnalisée et mise en œuvre pour avoir une valeur. Cette opérationnalisation pourrait être faite par lebiais d’une approche « conventions locales », mais les coûts de cette approche nécessitent certainement unfinancement externe supplémentaire.Les schémas peuvent en tout cas servir de registre permettant de consulter les conventions locales et les<strong>au</strong>tres règles d’utilisation de la terre et <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> qui ont été délibérées par le conseil <strong>communal</strong>. Le28