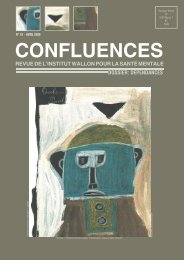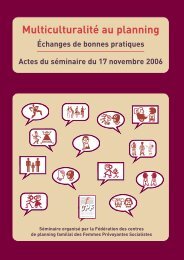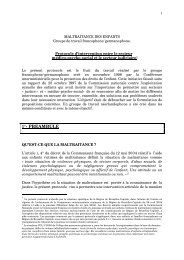Urgences psychiatriques et interventions de crise - Institut wallon ...
Urgences psychiatriques et interventions de crise - Institut wallon ...
Urgences psychiatriques et interventions de crise - Institut wallon ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
caractérise l’aller-mal », que ses causes, sondiagnostic, son remè<strong>de</strong> <strong>et</strong> les signes <strong>de</strong> la« guérison ». C<strong>et</strong>te incertitu<strong>de</strong> ne peut quese refléter sur les conditions <strong>de</strong> la prise encharge. Déci<strong>de</strong>r ce qui « fait urgence » dansces cas dépend éminemment du contexted’interprétation mobilisé.Ces <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s obligent néanmoins à reconsidérerles missions <strong>de</strong>s services d’urgence.Il s’agit ici, non pas d’éviter l’irrémédiable,mais <strong>de</strong> prodiguer <strong>de</strong>s soins qui, à l’évi<strong>de</strong>nce,n’ont pu être sollicités ailleurs. Du point <strong>de</strong>vue <strong>de</strong>s usagers, les services d’urgence n<strong>et</strong>rouvent pas leur place dans une logique <strong>de</strong>gradation <strong>de</strong>s soins mais plus simplementd’accès aux soins. Le caractère anonyme <strong>de</strong>l’institution pouvant même précisément constituerune <strong>de</strong>s raisons essentielles du recoursà ces services 7 .Urgence pour qui ?Il faut reconnaître que ce qui « fait urgence »peut largement différer selon que l’on envisageune mé<strong>de</strong>cine centrée sur le corps ououverte au « mental », que l’on considèrel’architecture <strong>de</strong> l’ensemble du système <strong>de</strong>soins ou les conditions réelles d’accès auxsoins, que l’on soit placé en situation <strong>de</strong>gérer le flux <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s ou que l’on soità l’origine <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. La réduction <strong>de</strong>l’urgence à ce qui m<strong>et</strong> la vie en danger, tentation<strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine somatique, ne perm<strong>et</strong>pas d’envisager c<strong>et</strong>te pluralité <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>sd’existence <strong>de</strong> l’urgence. La notion ne peutrecevoir un contenu unique.A notre sens, l’urgence doit plutôt être envisagéeen terme <strong>de</strong> situation. L’urgence n’estpas une caractéristique qui serait re<strong>de</strong>vabledu seul regard médical. Elle est le fait d’unemise en situation qui engage une pluralité <strong>de</strong>facteurs. « Il y a urgence » dans une multitu<strong>de</strong><strong>de</strong> cas <strong>et</strong> pour <strong>de</strong> nombreuses raisons.L’impossibilité <strong>de</strong> programmer son recoursaux soins, d’inscrire sa démarche dans unréseau d’intervenants, <strong>de</strong> gérer les diversesréorientations ; le fait <strong>de</strong> reculer sans fin lemoment <strong>de</strong> la consultation ou <strong>de</strong> connaître<strong>de</strong>s difficultés financières, mais aussi larecherche désespérée <strong>de</strong> prise en charge<strong>de</strong>s « problèmes sociaux » expliquent <strong>de</strong>nombreux recours aux services d’urgences.Ceux-ci peuvent paraître inadéquats d’unpoint <strong>de</strong> vue strictement médical ; il n’en restepas moins qu’ils sont l’aboutissement <strong>de</strong>dynamiques sociales <strong>et</strong> individuelles qui ontproduit <strong>de</strong> réelles situations d’urgence, à toutle moins pour l’usager. Il ne s’agit donc pasd’essentialiser l’urgence mais <strong>de</strong> comprendrecomment se m<strong>et</strong> en place un système <strong>de</strong>relations entre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> soins, unestructure d’offre <strong>et</strong> <strong>de</strong>s outils conceptuels <strong>de</strong>qualification <strong>de</strong>s situations.L’augmentation drastique du recours auxurgences, notamment en santé mentale, nepeut donc se réduire à un mauvais usage<strong>de</strong>s services hospitaliers. Il faut plutôt la considérercomme le refl<strong>et</strong> <strong>de</strong> transformationsplus profon<strong>de</strong>s du rapport aux soins, maisaussi du rapport à soi <strong>et</strong> aux autres. L’hôpital<strong>de</strong>vient un lieu privilégié d’accueil <strong>de</strong> ladétresse psycho-sociale, tout autant pour lespersonnes prises dans les conséquences <strong>de</strong>la précarisation croissante <strong>de</strong> nos conditions<strong>de</strong> vie, que pour une série d’intervenants (justice,police, travailleurs sociaux, autres structures<strong>de</strong> soins) qui y voient une ressourcedans la gestion <strong>de</strong>s situations problématiquesqui échappent à leurs possibilités d’action 8 .Dans ce contexte, les notions <strong>de</strong> <strong>crise</strong> oud’urgence ne sont pas à renvoyer uniquementà la personne concernée par la priseen charge mais à une série <strong>de</strong> conditions quifont du recours aux services d’urgence, l’actionqui s’impose. Le recours aux urgencesdoit s’analyser d’une part, au niveau <strong>de</strong>s personnesrequérantes, en tenant compte d’undifférentiel au niveau <strong>de</strong>s protections existantes(soutien, régulation, capacité à surmonterles épreuves) <strong>et</strong> <strong>de</strong> capacité d’accès auxsoins en santé mentale. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>soins via les services d’urgences concernantmajoritairement les personnes en conditiond’insécurité relationnelle autant que socioéconomique9 . D’autre part, il faut égalementconsidérer le rôle que tiennent les institutions<strong>de</strong> soins <strong>et</strong> <strong>de</strong> contrôle. Lorsque les seuils d<strong>et</strong>olérance intra-institutionnels ou sociaux sontdépassés, le recours aux « troubles psychiques» <strong>et</strong> à la notion <strong>de</strong> <strong>crise</strong> perm<strong>et</strong>te d’ouvrirla porte <strong>de</strong> l’hôpital qui reste, pour une série<strong>de</strong> populations « problématiques », le <strong>de</strong>rnierlieu où recevoir <strong>de</strong> l’attention. L’idée <strong>de</strong> <strong>crise</strong>renvoie alors autant à l’équilibre interne <strong>de</strong> lapersonne qu’à l’organisation <strong>de</strong> notre société<strong>et</strong> aux façons contemporaines <strong>de</strong> traiter leslaissés-pour-compte.L’augmentation <strong>de</strong> l’usage <strong>de</strong>s services d’urgence,soit l’augmentation <strong>de</strong> la production<strong>de</strong>s situations d’urgence, est peut-être lesigne d’une explosion <strong>de</strong>s « troubles », maiscelle-ci est alors à m<strong>et</strong>tre en relation avec ladiminution <strong>de</strong>s ressources collectives qui perm<strong>et</strong>tent<strong>de</strong> faire face aux aléas <strong>de</strong> l’existence.La naissance d’un modèle <strong>de</strong> l’urgence pourla gestion <strong>de</strong> la détresse psycho-sociale n’estqu’un signe <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> la déglingue <strong>de</strong> l’Etatsocial. Là où le recours à une interprétationen termes <strong>de</strong> santé mentale perm<strong>et</strong> <strong>de</strong>« naturaliser » <strong>de</strong>s dynamiques socio-politiques,il est bon <strong>de</strong> rappeler que les mo<strong>de</strong>s<strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la souffrance restent les conséquences<strong>de</strong> choix collectifs. 1 Jacques Moriau a récemment produit une rechercheportant sur les difficultés <strong>de</strong> prise en charge <strong>de</strong>s adolescentsà la frontière du secteur psychiatrique <strong>et</strong> judiciaire.Il travaille actuellement sur les dynamiques <strong>de</strong> « psychiatrisation» <strong>de</strong>s problèmes sociaux. Voir réf. biblio. 322 Carbonelle S., réf. bibliographique 23 Il s’agit <strong>de</strong> l’Arrêté Royal qui autorise les hôpitaux à réclameraux patients qui se ren<strong>de</strong>nt aux urgences sansraison « fondée » un tick<strong>et</strong> modérateur <strong>de</strong> 12,5 €.4 Dodier N., Camus A., réf. bibliographique 155 Le fait que le patient répon<strong>de</strong> aux injonctions du personnelsoignant , fasse ce qu’on lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> faire.6 Vassy C., réf. bibliographique 437 Frisch S., Bronchart C., ref. bibliographique 168 Une série <strong>de</strong> catégories spécifiques – adolescents violents,SDF, vieillards séniles – se voient ainsi rej<strong>et</strong>ées<strong>de</strong> toutes les institutions spécialisées. Perpétuellementà la frontière, sans places assignées, elles constituentun public récurrent pour les services d’urgence. Pourla problématique <strong>de</strong>s adolescents « psychiatrisés », voirMoriau J., réf. bibliographique 329 Castel R., réf. bibliographique 544 Confluences n°11 septembre 2005