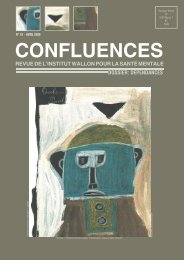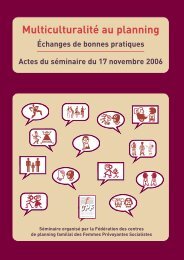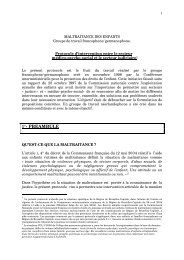« Groupes thérapeutiques en réseau »Depuis février 2003, le proj<strong>et</strong> « Groupes Thérapeutiques en Réseau »(GTR) rassemble <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> quatre services <strong>de</strong> santé mentale1 dans un groupe <strong>de</strong> travail qui a pour objectifs <strong>de</strong> penser, m<strong>et</strong>tre surpied <strong>et</strong> superviser <strong>de</strong>s dispositifs thérapeutiques <strong>de</strong> groupe.Le proj<strong>et</strong> a germé, voici cinq ans, dans le cadre du Service <strong>de</strong>Santé Mentale (SSM) « L’Accueil » à Huy, suite à <strong>de</strong>s difficultésrencontrées avec les prises en charge thérapeutiques classiques<strong>et</strong> suite au désir d’explorer <strong>et</strong> <strong>de</strong> développer d’autres modalités<strong>de</strong> soin. Il se réfère à <strong>de</strong>s expériences menées ailleurs, enservice public, à Bruxelles <strong>et</strong> à l’étranger, parfois <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> vingtans, comme c’est le cas en France dans <strong>de</strong>s CMP <strong>et</strong> CMPP (l’équivalent<strong>de</strong> nos SSM). Il se fon<strong>de</strong> sur la possibilité <strong>de</strong> réaliser à plusieurs ce quiserait hors <strong>de</strong> la portée d’un seul.Benoît Bourguignon,Coordinateur du proj<strong>et</strong> « Groupes Thérapeutiques en Réseau » 2Ce constat ne surprendra personne :par leurs compétences <strong>et</strong> leurs différences,quatre SSM peuvent générerensemble une dynamique inaccessibleà un seul d’entre eux. Concrètement,le partenariat transversal entre ces quatreservices a d’abord pris la forme d’un groupe<strong>de</strong> huit professionnels – <strong>de</strong>ux par SSM – intéressés<strong>et</strong> plus ou moins formés au travail <strong>de</strong>groupe. Ce groupe nommé “cellule” s’est réunipour la première fois le 4 février 2003, dans leslocaux du Ministère <strong>de</strong> la Région Wallonne àJambes, en présence <strong>de</strong> l’inspectrice du secteur.Il s’est choisi un nom – proj<strong>et</strong> « GroupesThérapeutiques en Réseau » – , s’est structuré<strong>et</strong> a défini ses objectifs, ses moyens <strong>et</strong> sespriorités pour le travail à développer au fil <strong>de</strong>ses réunions mensuelles.Pourquoi créer <strong>de</strong>sdispositifs <strong>de</strong> groupes ?Parce que, mis dans une situation <strong>de</strong> p<strong>et</strong>itgroupe (<strong>de</strong> 5 à 10 personnes), nous ne sommespas les mêmes que dans une interactionà <strong>de</strong>ux. Nous sommes toujours nous, bien sûr,mais les registres que nous mobilisons <strong>et</strong> lesmodalités <strong>de</strong> leur mise en jeu dans le groupese présentent <strong>de</strong> façon très différente. Dans ungroupe il se passe toujours quelque chose, <strong>et</strong>certaines personnes ne supportent pas quandil ne se passe rien, ça les bloque. Comme on yest à plusieurs, l’attention <strong>de</strong> l’un peut toujoursse détourner vers quelqu’un d’autre, on peuts’y sentir moins exposé.Se r<strong>et</strong>rouver en relation avec d’autres, pour duvrai, renvoie autant à soi-même – sa problématique,sa similitu<strong>de</strong>, sa différence – qu’à sarelation aux autres – peur, rivalité, agressivité,inhibition, intolérance… Mais, direz-vous, cerenvoi à soi-même se m<strong>et</strong> aussi en jeu dansune relation à <strong>de</strong>ux ! Bien entendu sauf pour<strong>de</strong>s personnes – enfants, adolescents, adultes– qui, pour rencontrer ce qu’ils ressentent,vivent, éprouvent ; ont besoin que quelquechose <strong>de</strong> concr<strong>et</strong> se passe, dans une réalitéplurielle qui les m<strong>et</strong> dans un palais <strong>de</strong>s glacessans les rendre chiens <strong>de</strong> faïence. Après <strong>de</strong>uxentr<strong>et</strong>iens, certains adultes se taisent parcequ’ils pensent avoir tout dit. Au bout <strong>de</strong> troisséances un enfant reste impassible au milieu<strong>de</strong> tous ces jeux qui l’entourent.Ainsi, dans leur travail, les cliniciens buttentparfois sur une inadéquation entre l’offre <strong>et</strong> la<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> soins. Or, comme nous venons<strong>de</strong> l’évoquer, toute une série <strong>de</strong> paramètresjouent <strong>et</strong> se modulent différemment dans unface à face individuel ou dans une situation <strong>de</strong>groupe : l’inhibition, la gestion <strong>de</strong> l’excitation, leregard, le silence, la parole <strong>de</strong> l’autre, la miseen scène, la prise <strong>de</strong> distance. Les cliniciensqui ont une pratique <strong>de</strong> groupe sentent parfoisd’emblée qu’une proposition <strong>de</strong> groupe seraitbien indiquée pour tel enfant, tel adulte oupour tel adolescent.Quels groupes <strong>et</strong> pour qui ?‘Il suffit <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>de</strong>s gens ensemble pourque quelque chose se passe’, c’est vrai, <strong>et</strong>c<strong>et</strong> aphorisme dénote bien l’une <strong>de</strong>s bases<strong>de</strong>s T-Group qui étaient en vogue il y a plus<strong>de</strong> trente ans. Notre visée est différente, elles’éloigne <strong>de</strong> l’expérimentation. Elle part <strong>de</strong>ce constat : dans un groupe, chaque individuvit une rencontre privilégiée avec lui-même<strong>et</strong> avec les autres, avec son mon<strong>de</strong> interne,son mon<strong>de</strong> externe, <strong>et</strong> leurs intrications. Mais,selon ses caractéristiques propres, chaquegroupe va m<strong>et</strong>tre en avant, va m<strong>et</strong>tre autravail, certains aspects <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te rencontreplutôt que d’autres : l’imaginaire <strong>de</strong> chacun,sa capacité <strong>de</strong> collaboration à une tâche, sacapacité <strong>de</strong> penser <strong>et</strong> vivre la différence, seséruptions émotionnelles, ses impulsions à agir,son inhibition, ses craintes, son agressivité,son contrôle <strong>de</strong> lui-même, sa jalousie, saconstellation familiale, son lien à son corps,sa tolérance à la régression, sa capacité <strong>et</strong>ses niveaux <strong>de</strong> symbolisation, son rapport àla règle, <strong>et</strong>c.Depuis une trentaine d’années se sont créés<strong>et</strong> développés <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> groupe qu’onpeut différencier <strong>et</strong> regrouper selon <strong>de</strong>uxaxes :- Celui <strong>de</strong> la théorie qui les sous-tend : psychanalyse(groupe analytique, psychodrame,…), systémique (groupe <strong>de</strong> généalogie, <strong>de</strong>système familial, …), bio-énergie, gestalt, pourn’en citer que quelques-uns.- Celui <strong>de</strong> la visée poursuivie : thérapeutique(groupe <strong>de</strong> développement personnel,émotionnel, <strong>de</strong> diagnostic, …) ou <strong>de</strong> formation(groupe <strong>de</strong> sensibilisation, <strong>de</strong> supervision,…).6Confluences n°11 septembre 2005
Si un groupe <strong>de</strong> formation peut utiliser lemême support (le psychodrame par ex.) <strong>et</strong>avoir <strong>de</strong>s eff<strong>et</strong>s proches <strong>de</strong> ceux d’un group<strong>et</strong>hérapeutique, m<strong>et</strong>tre sur pied l’un ou l’autre<strong>de</strong> ces groupes implique <strong>de</strong>s objectifs <strong>et</strong> <strong>de</strong>spréalables fort différents.Nous n’avons pas voulu organiser danschacun <strong>de</strong>s quatre SSM une <strong>de</strong>s formes<strong>de</strong> groupe thérapeutique “clé sur porte”.Au contraire, nous sommes partis <strong>de</strong> la situationpropre à chaque centre, <strong>de</strong>s patients <strong>et</strong><strong>de</strong>s problématiques qui, là-bas préoccupantes,étaient susceptibles d’un abord groupal<strong>et</strong>, bien entendu, du niveau <strong>de</strong> réalisationpossible, utile <strong>et</strong> souhaitable pour chacune<strong>de</strong>s équipes. C’est à huit personnes, puisà dix, que nous avons pu ainsi penser cinqformes <strong>de</strong> travail thérapeutique <strong>de</strong> groupe,réalisant par notre propre travail <strong>de</strong> groupece qui n’aurait pu venir d’un seul centre.Par ailleurs, la diversité <strong>de</strong> nos formations apermis qu’approches analytique, systémique<strong>et</strong> corporelle s’enrichissent mutuellement.Pour Viol<strong>et</strong>te par exemple…Viol<strong>et</strong>te a 13 ans quand ses parents consultentune pédopsychiatre au Centre <strong>de</strong> Guidance.En septembre, elle est entrée dans le secondaire.Récemment, elle a caché ses résultatsà ses parents. « Elle m’a menti ! » dit samaman fâchée. D’habitu<strong>de</strong>, elle est très sage,très obéissante <strong>et</strong> fait tout ce qu’on attendd’elle. Ses « dissimulations » les étonnentdonc très fort. Dans l’entr<strong>et</strong>ien, la pédopsychiatreapprend également qu’avec Viol<strong>et</strong>te« on ne sait jamais ce qu’elle pense : elle neveut plus aller au patro mais on ne sait paspourquoi ! ». Ils ajoutent que, d’une manièregénérale, leur fille éprouve <strong>de</strong>s difficultés àexprimer son agressivité. Ils signalent égalementque Viol<strong>et</strong>te ne sait pas bien se défendrepar rapport à ses sœurs plus jeunes, fortenvahissantes, qui sont décrites comme <strong>de</strong>vrais « démons ». Les parents souhaitent ai<strong>de</strong>rleur fille à surmonter ses difficultés.Un bilan instrumental est réalisé afin <strong>de</strong> vérifierqu’il n’y ait pas <strong>de</strong> problème à ce niveau.Les résultats sont rassurants.La pédopsychiatre déci<strong>de</strong> alors <strong>de</strong> l’orientervers le groupe <strong>de</strong> psychodrame pour adolescentsqui existe au Centre <strong>de</strong> Guidance.Bien que très timi<strong>de</strong>, Viol<strong>et</strong>te se montre d’embléeintéressée par ce dispositif. En séance,elle participe bien. Entraînée par le climatémotionnel <strong>et</strong> le jeu du groupe, elle amènelors d’une séance un fantasme très agressifqui la surprend, l’effraie <strong>et</strong> dont, au départ,elle se défend. Tout ce matériel est contenupar le dispositif du psychodrame <strong>de</strong> groupe<strong>et</strong> est élaboré ensuite dans le transfert parrapport aux animateurs dans les séances.Viol<strong>et</strong>te participe également à d’autres jeuxqui sont sous-tendus par <strong>de</strong>s mouvementsémotionnels très forts. Le groupe <strong>de</strong> psychodramea constitué, pour Viol<strong>et</strong>te, un espacemédiateur i<strong>de</strong>ntificatoire <strong>et</strong> un étayage narcissiquesur lequel elle a pu s’appuyer pours’exprimer <strong>et</strong> se faire davantage confiance.Le cycle <strong>de</strong> séances terminé, la maman<strong>de</strong> Viol<strong>et</strong>te confirme les progrès <strong>de</strong> sa fille.En eff<strong>et</strong>, celle-ci peut beaucoup mieux s’affirmerdans ses choix personnels, les expliciterdavantage, voire parfois s’opposer à sesparents <strong>et</strong> à d’autres adultes, m<strong>et</strong>tre <strong>de</strong>s limitesà ses soeurs <strong>et</strong> réussir à l’école.Ou pour Kévin…Bien droit sur sa chaise à la première séance<strong>de</strong> groupe, Kévin observe les cinq autres <strong>et</strong>ne dit rien. Il scrute aussi ce monsieur <strong>et</strong> c<strong>et</strong>temadame qu’il a rencontrés trois semaines plustôt avec sa maman.Sa mère nous avait parlé <strong>de</strong> ce qui la préoccupait.Son fils est toujours seul, il ne jouepas avec les autres dans la cour <strong>de</strong> l’école, ilne veut jamais inviter un copain à la maison.Il a toujours la tête ailleurs <strong>et</strong> la réussite <strong>de</strong> satroisième primaire est compromise. Derrièreson regard craintif, très attentif pourtant, Kévinn’a pas <strong>de</strong>sserré les <strong>de</strong>nts.Conduit par ses <strong>de</strong>ux parents, il arrive complètementcrispé pour la première <strong>de</strong>s dix séances.Sous la poussée <strong>de</strong>s encouragements<strong>de</strong> sa mère, il nous dit en quelques motsbredouillés qu’il ne voulait pas venir. Nousavons accusé réception. Il n’a pas ouvert labouche c<strong>et</strong>te fois-là.Etre dans un groupe avec <strong>de</strong>ux adultes ; c’estd’abord comme si on était à l’école. Puis, au<strong>de</strong>là<strong>de</strong>s consignes <strong>de</strong> départ – créer un jeuensemble –, la mise en groupe fait son œuvre.Des liens se tissent <strong>et</strong> les personnes se m<strong>et</strong>tentà bouger, à parler, à vouloir courir, sauter,grimper sur leur siège, <strong>et</strong> les <strong>de</strong>ux thérapeutestentent, pas toujours avec succès, <strong>de</strong> maintenirc<strong>et</strong>te vitalité débordante en intervenant surl’acte, la parole <strong>et</strong> le sens.A la <strong>de</strong>uxième séance, lors du rituel <strong>de</strong> présentationen cercle, Kévin arrive à bégayerson prénom malgré son corps parcouru d<strong>et</strong>remblements. Il redit <strong>de</strong>vant tous qu’il n’avaitpas envie <strong>de</strong> venir. Après quelques fois, il sort<strong>de</strong> sa réserve, pris dans les sollicitations <strong>de</strong>sautres <strong>et</strong> du groupe. Avait-il le choix ? Il auraitpu ne plus venir sans doute. Le voilà qui,lui aussi, se risque à tenter <strong>de</strong> dépasser leslimites, à lancer une injure ou à crier commeun putois au cour d’un jeu. Très attentif à nosréactions, il embraye pourtant dans le mouvementd’ensemble qui cherche <strong>de</strong> plus en plusà m<strong>et</strong>tre les limites du groupe – les nôtresaussi – à l’épreuve. Sollicité par les autres <strong>et</strong>le jeu i<strong>de</strong>ntificatoire interne au groupe, Kévinrencontre peu à peu l’agressivité paralyséedans tout son corps. Il lui faut un espace transitionnelsuffisamment exposé <strong>et</strong> protégé à lafois. « Et quoi, vous n’allez pas raconter toutcela à ma mère ? » « Non, mais on parlera d<strong>et</strong>oi avec tes parents quand on se verra aprèsla fin du groupe. »L’entr<strong>et</strong>ien bilan fait partie du processus.En j<strong>et</strong>ant <strong>de</strong>s ponts entre le quotidien <strong>et</strong> legroupe, sans en faire le rapport mais en ayantpour visée ce que l’enfant a pu y montrer <strong>de</strong>lui, il constitue un temps essentiel d’échangeélaboratif dans l’après-coup.Après notre entr<strong>et</strong>ien, Kévin se rendait augoûter d’anniversaire d’un copain.Et à présent ?Cinq groupes ont été construits : trois pour <strong>de</strong>senfants (l’un s’organisant autour <strong>de</strong> la créationd’une œuvre commune, l’autre axé sur le jeu<strong>et</strong> le travail <strong>de</strong> l’inhibition, le troisième sur lasymbolisation médiatisée <strong>et</strong> l’individuation),un pour <strong>de</strong>s adolescents (psychodrame <strong>de</strong>groupe), un pour adultes (expression verbale).Actuellement tous ces groupes sont en coursou ont terminé leur premier cycle. Il est doncà ce sta<strong>de</strong> encore prématuré <strong>de</strong> dresserun bilan définitif <strong>de</strong> la situation mais quelqueséléments d’évaluation laissent à penserqu’il serait intéressant <strong>de</strong> poursuivre l’actionentamée, <strong>de</strong> créer <strong>de</strong> nouveaux groupesthérapeutiques voire, pourquoi pas, d’intégrerultérieurement d’autres SSM au proj<strong>et</strong>. 1 Les SSM <strong>de</strong> Charleroi ( rue L. Bernus), Ottignies (rue<strong>de</strong>s Fusillés), Huy (rue <strong>de</strong> la Fortune) <strong>et</strong> le CSMU <strong>de</strong>Liège (rue Lambert-le-bègue).2 Article co-signé par D. Huon, J-M. Warich<strong>et</strong>, L.Balthazar, X. Mulkens, A. d’Haeyère, M. Blust, V. Liesens,F. Bouchat, F. Dispas.Confluences n°11 septembre 2005 7
- Page 1 and 2: sommaire La santé mentale, une mat
- Page 4 and 5: Pierre Scholtissen, Atelier du CRF,
- Page 8 and 9: La prise en charge des mineurs en d
- Page 10 and 11: La loi de Défense Sociale : 75 ans
- Page 12 and 13: A vos agendas !Exposés, rencontres
- Page 14 and 15: Urgences psychiatriques etintervent
- Page 16 and 17: Si, en Belgique, les données sur l
- Page 18 and 19: D’une urgence à l’autreTémoig
- Page 20 and 21: Urgences psychiatriques :des proche
- Page 22 and 23: La solitude du médecin généralis
- Page 24 and 25: Profession : urgentisteLes situatio
- Page 26 and 27: crée des situations anarchiques é
- Page 28 and 29: Penser l’urgenceLa plupart des se
- Page 30 and 31: Quasiment pas. Nous travaillons ave
- Page 32 and 33: De la clinique de la souffranceà l
- Page 34 and 35: Les urgences en hôpital psychiatri
- Page 36 and 37: Illustration : 6Madame X, 91 ans, v
- Page 38 and 39: peute, le patient et son entourage
- Page 40 and 41: un travail de fond, que chaque part
- Page 42 and 43: à la demande de la police, d’un
- Page 44 and 45: caractérise l’aller-mal », que
- Page 46 and 47: Cathy Stein Greenblatc’est d’ab
- Page 48: Repères et références bibliograp