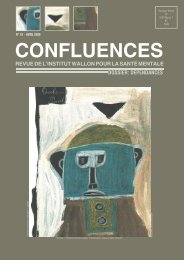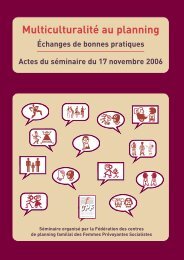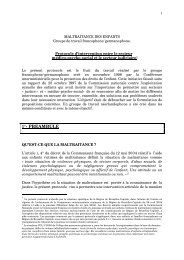Cathy Stein Greenblatc’est d’abord <strong>de</strong>s sentiments <strong>de</strong> ce genre,un état <strong>de</strong> panique, <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> contrôle, laconviction irraisonnée mais sûre d’elle-mêmeque la situation est grave <strong>et</strong> qu’elle exige <strong>de</strong>smoyens extraordinaires. Il n’est pas rare <strong>de</strong>voir les mé<strong>de</strong>cins eux-mêmes recourir à d<strong>et</strong>els services parce qu’ils sont débordés, <strong>et</strong>non point parce que l’état (objectif) <strong>de</strong> leurpatient l’exige 3 .On perçoit le glissement <strong>de</strong> point <strong>de</strong> vueopéré : il s’agit à présent <strong>de</strong> comprendreles urgences non plus à partir <strong>de</strong> la théorie(textes officiels, définitions médicales ou<strong>psychiatriques</strong>) mais à partir du vécu concr<strong>et</strong><strong>de</strong> chacun d’entre nous. Pourquoicelui-ci serait-il moins important (tant surle plan épistémologique que éthique) ?Incontestablement, dans c<strong>et</strong>te nouvelle perspective,les missions <strong>de</strong> ces services doiventnon seulement être élargies mais hiérarchiséesautrement. Les urgences interviennentdans notre univers d’abord <strong>et</strong> avant toutpour nous perm<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> dire qu’on se vit ensituation <strong>de</strong> <strong>crise</strong>. Comment ne pas voir, eneff<strong>et</strong>, qu’appeler les urgences ou s’y rendre,c’est une première manière pour chacund’entre nous <strong>de</strong> ne pas se laisser submergerpar la souffrance, la peur, le stress,l’angoisse (réels ou imaginaires selon lascience médicale ou psychiatrique, mais tou-jours réellement vécus), <strong>et</strong> bien au contraired’en faire quelque chose, en m<strong>et</strong>tant cesaffects en scène, en leur donnant une visibilitésociale, en quête d’une reconnaissance,pour une prise en charge 4 ? Le sentimentsubjectif <strong>de</strong> l’urgence ne peut trouver à sedire, à se concrétiser <strong>et</strong> à se confirmer (ounon) – <strong>et</strong> donc à se vivre – qu’en s’exposantdans ce qui incarne par excellence l’urgence,à savoir les services qui en portent le nom.Il s’agit en quelque sorte <strong>de</strong> joindre le bongeste à la parole, pour libérer c<strong>et</strong>te parole.De ce point <strong>de</strong> vue, <strong>de</strong>ux conclusions s’imposent: tout d’abord, un patient qui se rendaux urgences ou y fait appel a toujours raison<strong>de</strong> le faire. Le traiter d’abuseur, le faireattendre, <strong>et</strong>c. sont autant <strong>de</strong> comportementsincompréhensibles au regard <strong>de</strong> son vécu.Pour lui, il y a réellement urgence ! D’un point<strong>de</strong> vue éthique, c’est ce vécu qui doit d’abordpouvoir être entendu, là où précisément il al’impression <strong>de</strong> pouvoir l’être. Ce travail està part entière celui <strong>de</strong>s urgentistes, du moinsquand ce sont eux qui sont interpellés.Ensuite, si pour diverses raisons, les urgencesne peuvent plus remplir c<strong>et</strong>te fonction, sielles ne sont plus là pour dire l’urgence maisseulement pour soigner les « beaux cas » – ceque l’on peut aussi comprendre – , alors on aencore le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r quel autrelangage crédible, socialement investi comm<strong>et</strong>el, on m<strong>et</strong> à la disposition <strong>de</strong>s patients pourdire qu’ils se vivent, là, maintenant, en situation<strong>de</strong> <strong>crise</strong>. A défaut <strong>de</strong> c<strong>et</strong> autre langage,au lieu <strong>de</strong> fuir, il nous reste à assumer laresponsabilité d’abandonner les patients auchaos <strong>de</strong> leurs souffrances. 1 Par conception arbitraire, nous entendons non pas uneconception inventée <strong>de</strong> toute pièce, sans aucun fon<strong>de</strong>ment,mais une conception qui relève d’un consensusreflétant le plus souvent <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> force entreindividus, un consensus par définition historique, doncrelatif : dans tous les cas, il s’agit d’une représentationsociale ou (inter-) professionnelle <strong>de</strong> la réalité, non <strong>de</strong> laréalité elle-même.2 Le sentiment subjectif peut également induire en erreurdans l’autre sens : il est <strong>de</strong>s situations non dramatiquesen apparence qui se révèlent pourtant fatales. Onn’aura pas recouru aux urgences puisqu’aucun symptômegrave n’était ressenti. Comment le reprocher auxpatients ou à leur famille ?3 C<strong>et</strong>te situation, lorsqu’elle se produit par exemple àl’hôpital, laisse d’ailleurs le sentiment aux urgentistes (enpsychiatrie) d’être la poubelle <strong>de</strong> l’hôpital.4 Il conviendrait <strong>de</strong> déployer ici – ce que nous ne pouvonsfaire – une phénoménologie du psychisme humain,pour montrer comment sa nature purement affective sem<strong>et</strong> en scène (ou s’élabore) à travers <strong>de</strong>s « mythes »,<strong>de</strong>s conceptions tenues pour vraies à juste titre par unesociété donnée, telle la mé<strong>de</strong>cine. Faute <strong>de</strong> quoi, il n’estque chaos. Pour l’expliquer en un mot, songeons auxgénéralistes qui reconnaissent que <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong> leursconsultations ne sont pas médicales au sens strict : <strong>de</strong>spersonnes en souffrance en appellent à eux pour dire ouélaborer leur mal-être <strong>et</strong> être reconnues <strong>de</strong> fait « en souffrance» : comme si le langage médical était le seul quileur perm<strong>et</strong>te <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre <strong>de</strong>s mots sur ce qu’elles vivent.46 Confluences n°11 septembre 2005
Le Bill<strong>et</strong> <strong>de</strong> l’<strong>Institut</strong>Du temps <strong>de</strong> l’urgence au temps du suj<strong>et</strong>Chaque trimestre, dans les pages <strong>de</strong> Confluences, un thème avec son lot<strong>de</strong> questions, <strong>de</strong> théories, d’illustrations, <strong>de</strong> réflexions, … pour y puiser<strong>de</strong>s idées ou y nourrir <strong>de</strong>s pensées… mais aussi pour alimenter, au sein<strong>de</strong> l’<strong>Institut</strong> Wallon pour la Santé Mentale, un savoir collectif lié à l’expertise<strong>de</strong> terrain.Chaque trimestre, le bill<strong>et</strong> <strong>de</strong> l’<strong>Institut</strong> relève quelques idées <strong>et</strong> lancequelques pistes dans ce sens….Partons <strong>de</strong> l’exemple <strong>de</strong>s disputesintrafamiliales. Que penser <strong>de</strong> cescouples qui quelquefois en arriventà terminer leurs disputes conjugalesdans le cadre d’un service d’urgences hospitalier? Faut-il le déplorer ? Faut-il s’en réjouir ?Comment réagir à <strong>de</strong> telles situations ?Une première réaction est bien sûr <strong>de</strong> direcombien <strong>de</strong> telles <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s risquent d’encombrer<strong>et</strong> <strong>de</strong> nuire sensiblement aux <strong>interventions</strong>sereines <strong>et</strong> efficaces pour <strong>de</strong>s urgencesréelles sur le plan médical. Un tel abord <strong>de</strong>la question m<strong>et</strong> l’accent sur ce que l’on qualifiehabituellement – <strong>et</strong> peut-être hâtivement - <strong>de</strong>fausses urgences. Cependant, il n’est pasinintéressant <strong>de</strong> relever que, dans ce type<strong>de</strong> situation, le service d’urgence est apparucomme une sorte <strong>de</strong> refuge pour <strong>de</strong>s êtres enrupture d’équilibre.Par ailleurs, la violence conjugalene relève pas en soi d’une urgencepsychiatrique mais elle peut l’être, bien sûr,dans certains cas.Cela nous amènerait à dire que l’urgence estun concept loin d’être univoque <strong>et</strong> qu’il secompose <strong>de</strong> trois vol<strong>et</strong>s : l’urgence somatique,l’urgence psychiatrique <strong>et</strong> l’urgence du « désarroidu suj<strong>et</strong> » (pour reprendre une expressionr<strong>et</strong>enue par Jean-Pierre Lebrun comm<strong>et</strong>itre d’un <strong>de</strong> ses ouvrages). Ces trois typesd’urgence peuvent ou non se conjuguer dansunemême situation comme ils peuvent seprésenter séparément.Francis TurinePrési<strong>de</strong>nt IWSMPar ailleurs, il faut gar<strong>de</strong>r à l’esprit qu’il ya d’une part ceux qui reçoivent la situationd’urgence <strong>et</strong> d’autre part, ceux qui la présentent<strong>et</strong> qui la vivent.Jean-Michel Longneaux, dans un articleparu dans Ethica Clinica 1 , notait justementque « les urgences, c’est aussi <strong>et</strong> surtout<strong>de</strong>s cas sociaux, <strong>de</strong>s gens paniqués, <strong>de</strong>sp<strong>et</strong>its « bobos », <strong>de</strong>s familles à rassurer, <strong>et</strong>c.Le métier d’urgentiste, c’est-à-dire celui qu’ilssont contraints d’assumer à un rythme effréné,c’est donc tout autant un travail d’écoute,<strong>de</strong> soins plus ou moins légers, d’aiguillagevers d’autres services plus adéquats ou versle mé<strong>de</strong>cin généraliste. (...) On a donc l’impressionque la réalité que les soignants <strong>et</strong>les patients doivent supporter aux urgencescreuse entre eux un fossé : les premiers sontsurmenés <strong>et</strong> le plus souvent pour <strong>de</strong>s casqu’ils jugent finalement peu urgents, tandisque les seconds ne voient pas le tempspasser, surtout s’ils sont convaincus d’être endanger <strong>de</strong> mort. ».La complexité <strong>de</strong> l’urgence est donc gran<strong>de</strong>,<strong>et</strong> délicate est la façon dont il faut l’entendre<strong>et</strong> la traiter. Une <strong>de</strong>s difficultés, probablementpas la moindre, c’est que la société aurait tendanceà vouloir accueillir <strong>et</strong> répondre à toutes lesurgences à partir <strong>de</strong> la même structure, le serviced’urgence <strong>de</strong> l’hôpital général alors qu’il yaurait peut-être tout avantage à diversifier leslieux <strong>et</strong> les modalités d’accueil. Certaines initiativesheureuses vont déjà dans ce sens.Les différents articles <strong>et</strong> témoignages du dossierfont bien apparaître c<strong>et</strong>te complexité ainsique les multiples tentatives pour offrir à la situation<strong>de</strong> <strong>crise</strong> un juste accueil. Un <strong>de</strong>s apports<strong>de</strong> ces écrits est d’insister sur le fait que, sil’urgence, en tant que telle, est ponctuelle <strong>et</strong>circonstancielle, la réponse qui lui est donnéedoit être mise dans une perspective, dans unprocessus. Celui-ci doit, à la fois, prendre encompte la dimension subjective <strong>de</strong> celui quise trouve en situation d’urgence <strong>et</strong> se situerrésolument en référence au réseau relationneldu patient <strong>et</strong> à celui <strong>de</strong>s services existants<strong>et</strong> <strong>de</strong>s intervenants. Ceci est d’autant plusimportant qu’un certain nombre <strong>de</strong> personness’adressent au service d’urgence parce qu’ilne leur viendrait pas à l’idée ou parce qu’ilsne souhaitent pas s’adresser directement à unpsychiatre, à un psychologue ou à une consultationdans un service <strong>de</strong> psychiatrie.La problématique du réseau <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’organisation<strong>de</strong> soins ont été le premier thème surlequel l’<strong>Institut</strong> s’est penché. La réflexion s’estpoursuivie par les nombreuses préoccupationsrelatives aux droits du patient 2 . Aujourd’hui,l’attention se porte sur l’accessibilité aux soinsen santé mentale, <strong>et</strong> notamment, sur le recoursaux urgences comme « porte d’entrée » auxsoins en santé mentale. C<strong>et</strong>te question meparaît essentielle à traiter au sein <strong>de</strong> l’<strong>Institut</strong>pour faire la jonction entre les réflexionsthéoriques <strong>et</strong> les réalités <strong>de</strong> terrain.La diversité <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l’IWSM, <strong>de</strong> leursmissions, <strong>de</strong> leurs mo<strong>de</strong>s d’<strong>interventions</strong> <strong>et</strong><strong>de</strong>s réalités auxquelles ils sont confrontésfont <strong>de</strong> l’<strong>Institut</strong> un lieu particulièrement appropriénon seulement pour réfléchir <strong>et</strong> débattre<strong>de</strong> ces questions <strong>de</strong> santé mentale maiségalement pour élaborer <strong>de</strong>s ébauches <strong>de</strong>réponses possibles sur le plan global <strong>et</strong> surle plan local. La question abordée par le biais<strong>de</strong>s situations d’urgence <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>crise</strong> fait apparaîtreparticulièrement la non évi<strong>de</strong>nce d’uneréponse pratique <strong>et</strong> effective tout en tenantcompte du temps du suj<strong>et</strong>, du vécu du suj<strong>et</strong>,<strong>de</strong> l’angoisse, bref en ne négligeant pas toutce qui ne peut être objectivé. 1 Voir réf. bibliographique 192 Ces thèmes ont fait l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers colloquesannuels <strong>de</strong> l’IWSM en 2003 <strong>et</strong> 2004.DOSSIERConfluences n°11 septembre 2005 47
- Page 1 and 2: sommaire La santé mentale, une mat
- Page 4 and 5: Pierre Scholtissen, Atelier du CRF,
- Page 6 and 7: « Groupes thérapeutiques en rése
- Page 8 and 9: La prise en charge des mineurs en d
- Page 10 and 11: La loi de Défense Sociale : 75 ans
- Page 12 and 13: A vos agendas !Exposés, rencontres
- Page 14 and 15: Urgences psychiatriques etintervent
- Page 16 and 17: Si, en Belgique, les données sur l
- Page 18 and 19: D’une urgence à l’autreTémoig
- Page 20 and 21: Urgences psychiatriques :des proche
- Page 22 and 23: La solitude du médecin généralis
- Page 24 and 25: Profession : urgentisteLes situatio
- Page 26 and 27: crée des situations anarchiques é
- Page 28 and 29: Penser l’urgenceLa plupart des se
- Page 30 and 31: Quasiment pas. Nous travaillons ave
- Page 32 and 33: De la clinique de la souffranceà l
- Page 34 and 35: Les urgences en hôpital psychiatri
- Page 36 and 37: Illustration : 6Madame X, 91 ans, v
- Page 38 and 39: peute, le patient et son entourage
- Page 40 and 41: un travail de fond, que chaque part
- Page 42 and 43: à la demande de la police, d’un
- Page 44 and 45: caractérise l’aller-mal », que
- Page 48: Repères et références bibliograp