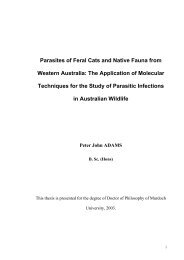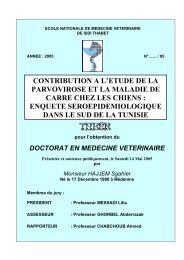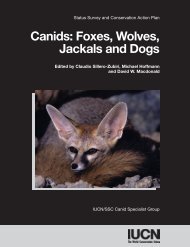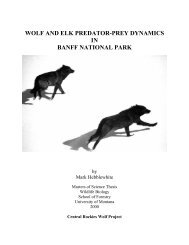etude des facteurs potentiellement limitant de la repartition
etude des facteurs potentiellement limitant de la repartition
etude des facteurs potentiellement limitant de la repartition
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VII.2.2. Désertification <strong>de</strong> l’habitat<br />
La surexploitation du milieu est leur principale menace (Ginsberg et Macdonald,<br />
1990). Les fennecs sont victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> désertification qui s’accroît autour <strong><strong>de</strong>s</strong> vil<strong>la</strong>ges, en<br />
raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> valeurs <strong><strong>de</strong>s</strong> milieux avoisinants les habitations (Cuzin, 1996).<br />
VII.2.2.1. Evolution <strong><strong>de</strong>s</strong> comportements énergétiques dans le sud tunisien<br />
La politique volontariste <strong>de</strong> création <strong>de</strong> périmètres irrigués et <strong>de</strong> sé<strong>de</strong>ntarisation<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> noma<strong><strong>de</strong>s</strong> a eu pour conséquence d’aggraver <strong>la</strong> désertification.<br />
Chez les noma<strong><strong>de</strong>s</strong>, <strong>la</strong> femme pourvoyait <strong>la</strong> tente en combustible par prélèvement<br />
direct sur <strong>la</strong> végétation environnante, usant d’une connaissance intime <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>la</strong>ntes et <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
ressources végétales au gré <strong><strong>de</strong>s</strong> saisons et <strong><strong>de</strong>s</strong> itinéraires <strong>de</strong> transhumance. Le comportement<br />
énergétique <strong><strong>de</strong>s</strong> noma<strong><strong>de</strong>s</strong> apparaîssait d’une gran<strong>de</strong> rusticité, adapté à <strong>la</strong> sobriété <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
habitu<strong><strong>de</strong>s</strong> alimentaires et étroitement dépendant <strong>de</strong> l’environnement saharien. Les espaces <strong>de</strong><br />
prélèvements du bois étaient plus <strong>la</strong>rges car les prélèvements s’effectuaient petit à petit sur les<br />
parcours saisonniers <strong>de</strong> transhumance réalisés du Nord au Sud du Nefzaoua. La pression <strong>de</strong><br />
coupe réalisée sur ces zones était donc plus faible et saisonnière. Le four à pain était absent et<br />
<strong>la</strong> consommation <strong>de</strong> gaz et <strong>de</strong> pétrole était très faible, compte-tenu notamment <strong><strong>de</strong>s</strong> difficultés<br />
d’approvisionnement (Auc<strong>la</strong>ir et Zaafoui, 1996 ; Sahnoun, 1998).<br />
Aujourd’hui, <strong>la</strong> quasi-totalité <strong><strong>de</strong>s</strong> familles disposent d’un réchaud ou d’une<br />
cuisinière mo<strong>de</strong>rne à gaz ; le bois n’est plus guère utilisé que pour <strong>la</strong> cuisson quotidienne <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
galettes <strong>de</strong> pain (ftaira, marfousa, metloua…), ainsi que pour <strong>la</strong> préparation hebdomadaire (le<br />
vendredi) du traditionnel khobs mel<strong>la</strong>, le pain <strong>de</strong> sable cuit sous <strong>la</strong> braise. Et, si <strong>la</strong><br />
consommation <strong>de</strong> bois apparaît re<strong>la</strong>tivement mo<strong><strong>de</strong>s</strong>te (), il n’en est pas <strong>de</strong> même pour celle <strong>de</strong><br />
charbon <strong>de</strong> bois - pour les ménages utilisateurs (55 % <strong>de</strong> l’ensemble), 350 kg par an. Le<br />
charbon est utilisé dans les braseros traditionnels pour <strong>la</strong> préparation quotidienne du thé et<br />
surtout pour le chauffage en hiver. La consommation d’El Faouar est <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 250 tonnes<br />
<strong>de</strong> charbon par an, correspondant à l’exploitation annuelle d’un millier <strong>de</strong> tonnes <strong>de</strong> bois.<br />
Mais le plus étonnant est <strong>de</strong> constater qu’El Faouar et les oasis voisines « exportent » du<br />
charbon <strong>de</strong> bois en direction <strong><strong>de</strong>s</strong> localités du Nefzaoua, <strong>de</strong> Douz à Jemma, Kébili et Souk El<br />
Had. Le désert pourvoit le Nefzaoua en combustible. Il s’agit <strong>de</strong> filières c<strong>la</strong>n<strong><strong>de</strong>s</strong>tines car le<br />
charbonnage au Sahara est une activité illicite et sévèrement réprimée par le service forestier.<br />
La biomasse agricole et les palmes <strong>de</strong> dattier ne sont guère utilisées que pour l’allumage du<br />
feu. La quasi-totalité du bois <strong>de</strong> feu et du charbon consommés à El Faouar provient <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
steppe désertique. Concernant l’approvisionnement, l’évolution <strong><strong>de</strong>s</strong> comportements est aussi<br />
notable. La récolte est désormais confiée aux hommes et aux jeunes garçons, évolution qui<br />
traduit <strong>la</strong> raréfaction du combustible et le surcroît <strong>de</strong> distance à parcourir. Le charbonnage<br />
constitue aussi toujours une activité saisonnière et rémunératrice <strong><strong>de</strong>s</strong> plus importantes pour <strong>la</strong><br />
frange oasienne <strong>la</strong> plus défavorisée. On coupe ça et là <strong><strong>de</strong>s</strong> brins vifs à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> serpes ou <strong>de</strong><br />
hachettes sans pratiquer <strong>de</strong> coupe à b<strong>la</strong>nc sur <strong>la</strong> végétation (Auc<strong>la</strong>ir et Zaafouri, 1996).<br />
VII.2.2.2. Conséquence, <strong>la</strong> désertification, évolution <strong>de</strong> l’écosystème saharien<br />
La région d’étu<strong>de</strong>, située dans le Sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tunisie est sujette à une désertification<br />
intense, avec <strong><strong>de</strong>s</strong> conséquences sur le milieu physique et humain. Dès 1972, en effet, à<br />
l’occasion du séminaire <strong>de</strong> Gabès (LeFloch’ et Floret, 1972), les étu<strong><strong>de</strong>s</strong> concernant ce<br />
phénomène dressent un constat a<strong>la</strong>rmant, et Dregne (1977 cité par Talbi, 2004), dans sa carte<br />
<strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> désertification dans le mon<strong>de</strong>, considère <strong>la</strong> région ari<strong>de</strong> tunisienne comme<br />
- 44 -