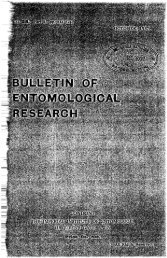Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
34 LES PHLÉBOTOMES DE LA RÉGION ÉTHIOPIENNE<br />
Poursuivant leurs travaux avec <strong>de</strong> nouveaux col<strong>la</strong>borateurs, ces auteurs montraient, en 1930, et<br />
conkmaient en 1931, que P. perniciosus s’infecte facilement, dans les conditions naturelles, sur <strong>de</strong>s chiens<br />
atteints <strong>de</strong> leishmaniose viscérale et que l’agent <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die se comporte, dans le tube digestif <strong>de</strong> l’insecte,<br />
tout comme les autres agents leishmaniens (L. donovani et L. tropica) ; il tend manifestement à envahir<br />
les premiers segments <strong>de</strong> ce tube digestif et à s’écarter <strong>de</strong> l’intestin postérieur, c’est-à-dire à se p<strong>la</strong>cer<br />
dans une situation favorable à <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong> l’infection.<br />
Par <strong>la</strong> suite, Adler & Theodor (1930-1931) obtenaient l’infection <strong>de</strong> P. perniciosus avec Leishmania<br />
infantum, agent du Ka<strong>la</strong>-Azar méditerranéen. Ils pouvaient considérer cette espèce comme l’agent principal<br />
<strong>de</strong> transmission <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose viscérale en Sicile.<br />
Aux In<strong>de</strong>s et en Chine, une série <strong>de</strong> chercheurs : Knowles, Napier & Smith (1924), Christophers,<br />
Shortt & Barraud (1925-1926), Hindle & Patton (1927-1928-1931) démontraient le rôle <strong>de</strong> P. argentipes<br />
et <strong>de</strong> P. chinensis dans <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong> L. donovani agent du Ka<strong>la</strong>-Azar asiatique.<br />
En 1941, Parrot et coll. observaient l’infection naturelle <strong>de</strong> P.perniciosus et <strong>de</strong> P. longicuspis capturés<br />
dans un chenil abritant <strong>de</strong>s chiens atteints <strong>de</strong> leishmaniose généralisée. Ils considéraient P. Zongicuspis<br />
comme un agent propagateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose méditerranéenne en Afrique du Nord.<br />
En Amérique du Sud où sévit <strong>la</strong> leishmaniose forestière américaine, <strong>de</strong>s recherches entreprises<br />
par Coutinho, Pessoa, Pestana (1940-1941), Forattini (1953-1954), Forattini & Santos (1952-1955),<br />
permirent à ces auteurs <strong>de</strong> conclure au rôle probable que doivent jouer P. pessoai, P. migonei, P. whitmani<br />
et P. intermedius dans <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong> cette affection..<br />
De même, Deane & Deane (1954-1955) considèrent P. Zongipalpis comme vecteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose<br />
viscérale dans certaines zones endémiques <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> Céara et P. whitmani et P. migonei comme vecteur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose cutanéo-muqueuse.<br />
A Panama, Johnson, McConnell & Hertig (1963) reconnaissent l’infection naturelle <strong>de</strong> P. gomezi,<br />
P. panamensis, P. sanguinarius, P. shannoni, P. trapidoi, P. ylephyletor et P. longipalpis, par <strong>de</strong>s formes<br />
Leptomanas. Ces espèces piquent l’homme et les individus infectés proviennent <strong>de</strong>s <strong>région</strong>s où <strong>la</strong> leishmaniose<br />
est endémique.<br />
Parrot & Gougis (1943) trouvant une espèce anthropophile : P. duboscqi, dans une zone d’endémie<br />
du Bouton d’Orient, accusent cette espèce <strong>de</strong> transmettre cette leishmaniose au Niger. Plus tard, Larivière<br />
& coll. (1961), se basant sur <strong>de</strong>s faits épidémiologiques, pensent également que cette espèce est,<br />
en Afrique Occi<strong>de</strong>ntale, le vecteur principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose cutanée.<br />
Au Kénya, Heisch & coll. (1956) signalent un nouveau Phlébotome : P. garnhami, susceptible <strong>de</strong><br />
s’infecter sur <strong>de</strong>s lésions contenant d’abondantes leishmanies. Plus récemment Minter & Wijers (1963)<br />
pensent que P. martini est le principal vecteur du Ka<strong>la</strong>-Azar dans cette <strong>région</strong> avec P. celiae et P. vansomerenae.<br />
Hoogstraal & Heyneman (1969), après <strong>de</strong> nombreuses recherches et expériences <strong>de</strong> transmission,<br />
considèrent P. orientalis comme vecteur du Ka<strong>la</strong>-Azar dans le Soudan occi<strong>de</strong>ntal.<br />
Si l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong>s leishmanioses par les Phlébotomes a fait l’objet <strong>de</strong> nombreux<br />
travaux, <strong>la</strong> liste, déjà longue, <strong>de</strong>s espèces jouant un rôle certain ou probable n’est pas encore close. En<br />
Afrique Occi<strong>de</strong>ntale le rôle <strong>de</strong> P. duboscqi reste à démontrer. En Guyane française, P. anduzei et P. guyanensis<br />
sont soupconnés <strong>de</strong> transmettre <strong>la</strong> leishmaniose forestière ; ils piquent l’homme et abon<strong>de</strong>nt dans<br />
l’intérieur du territoire où l’on rencontre <strong>de</strong> nombreux cas <strong>de</strong> leishmaniose. Leur rôle reste également<br />
à démontrer.<br />
3.4.3. « LA VERRUGA » PÉRWIENNE<br />
La « verruga » péruvienne ou sa forme grave, <strong>la</strong> fièvre <strong>de</strong> Oroya, ou ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Carrion, est une<br />
affection qui sévit dans les vallées <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s péruviennes, à diverses altitu<strong>de</strong>s al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> 800 à 3 000 m.<br />
Son agent étiologique Bartonel<strong>la</strong> bacilliformis peut être inoculé par P. verrucarum, P. peruensis et<br />
P. noguchii.<br />
Townsend (1913) fut le premier à incriminer les Phlébotomes comme vecteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die et<br />
plus tard, en 1929, Noguchi & coll. réussirent à transmettre cette affection au singe en inocu<strong>la</strong>nt un broyat<br />
<strong>de</strong> Phlébotomes. Par <strong>la</strong> suite, Hertig (1937-1939-1942) put transmettre à son tour <strong>la</strong> verruga péruvienne à<br />
<strong>de</strong>s singes par piqûre <strong>de</strong> plusieurs P. verrucarum, naturellement et expérimentalement infectés.