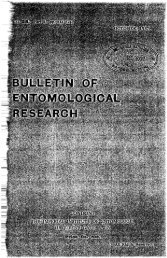Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
100 LES PHLÉBOTOMES DE LA RÉGION ÉTHIOPIENNE<br />
= Flebotomus papatasii <strong>de</strong> Rondani, 1840.<br />
= Hebotomus papatasii <strong>de</strong> Rondani, 1843.<br />
= Cynipes molestus Costa, 1843.<br />
= Haemasson minutus Loew, 1844.<br />
= Phiebotomus papatasii <strong>de</strong> Agassiz, 1846.<br />
= Phlebotomus angustipennis Meijere, 1909.<br />
= Phlebotomuspapatasi <strong>de</strong> Annandale, 1909.<br />
Matériel examiné :<br />
4 mâles et 4 femelles <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s localités suivantes : Rama (Galilée), Maram-Abab (Tran),<br />
Ben&Abbès (Algérie).<br />
Mâle (fig. 36 A-B-C-H).<br />
TuiZZe = 2,46-2,55 mm, Patte postérieure, longueur totale = 3,89 mm. Antenne, longueur du segment III =<br />
0,27 mm. Rapport AIII/E = 1.. III < IV + V ; formule antennaire : 2/111-XV. La longueur <strong>de</strong>s épines géniculées peut<br />
varier selon <strong>la</strong> provenance <strong>de</strong>s échantillons, rapport c/b = 1,2-3,4. Labre-épipharynx = 0,25 mm. Palpe, formule:<br />
l-2-4-3-5 ; longueur re<strong>la</strong>tive <strong>de</strong> chaque segment, du 1 e* au 5e, 1 - 2,8 - 4 - 3,l - 7,5. Cibarium avec quelques minuscules<br />
<strong>de</strong>nticules au centre et, sur les bords <strong>la</strong>téraux, un très fin réseau <strong>de</strong> <strong>de</strong>nticules filiformes difficilement visibles. Pharynx<br />
postérieur présentant dans sa partie postérieure un réseau <strong>de</strong> fortes <strong>de</strong>nts écailleuses, très irrégulières. Aile, longueur =<br />
2,18-2,25 mm ; <strong>la</strong>rgeur = 0,53 mm ; rapport longueur/<strong>la</strong>rgeur : 4,1-4,2 ; indice a<strong>la</strong>ire : 1,5 ; <strong>de</strong>lta = f 0,07 mm.<br />
Génitalia très <strong>de</strong>veloppés ; <strong>la</strong> longueur du coxite (0,60 mm) et du style (0,40 mm) réunies surpasse <strong>la</strong> longueur du<br />
thorax. Coxite présentant à sa base un petit lobe portant quelques soies courtes et, prés <strong>de</strong> son apex, une douzaine <strong>de</strong> soies<br />
longues bien différenciées. Paramère trilobé ; le processus supérieur dépasse longuement l’extrémité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux autres<br />
lobes. Lobe <strong>la</strong>téral = 0,37 mm ; il porte à son extrémité libre 2 épines spatulées. Fourreau pénien conique et mousse à<br />
l’extrémité. Rapport FG/PG = 1,3.<br />
Femelle (fig. 36 D-E-F-G-I-J).<br />
Taille, 2,20-2,60 mm (moyemie 2,43 mm). Antenne, segment III = 0,24 mm > IV + V; rapport AIII/E = 0,6 ;<br />
formule antennaire: 2/111-XV; épines géniculees variant <strong>de</strong> longueur selon <strong>la</strong> localité; sur 12 exemp<strong>la</strong>ires d’Algérie le<br />
rapport c/b variait <strong>de</strong> 1,20 à 1,46 ; pour 6 exemp<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> Galilee, il al<strong>la</strong>it <strong>de</strong> 1,39 à 2,18. Labre-épipharynx = 0,33-0,49 mm.<br />
Palpe, longueur totale = 0,82 mm ; formule l-3-2-4-5. <strong>Les</strong> segments sont entre eux comme 1 - 2,8 - 4 - 2,6 - 6. Cibarium<br />
inerme; on distingue à un fort grossissement, quelques <strong>de</strong>nticules punctiformes centraux et, sur les côtés, un réseau <strong>de</strong><br />
pointes filiformes refringentes difficilement visibles. Pharynx postérieur armé dans sa partie postérieure d’un réseau <strong>de</strong><br />
fortes <strong>de</strong>nts écailleuses trés irrégulières et irrégulièrement disposées. Aile, longueur = 2,19 mm ; <strong>la</strong>rgeur = 0,60 mm ;<br />
indice a<strong>la</strong>ire : 1,4 ; <strong>de</strong>lta = + 0,09 mm. Spermathéques annelées avec 6-9 anneaux (moyenne 7,2) ; longueur <strong>de</strong> l’ampoule =<br />
O,ll-0,12 mm.<br />
Répartition géographique (p. 255) :<br />
P. papatasi est réparti sur tout le bassin méditerranéen, dans l’Ouest <strong>de</strong> l’Asie et dans l’In<strong>de</strong>. En<br />
Région Ethiopienne, il atteint le Soudan, <strong>la</strong> Somalie et l’Arabie Saoudite par <strong>la</strong> vallée du Nil et les rives<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Rouge.<br />
Biologie :<br />
P. papatasi est l’un <strong>de</strong>s Phlébotomes les plus répandus et les mieux connus (<strong>la</strong> première <strong>de</strong>scription<br />
#date <strong>de</strong> 1786) ; son abondance en certaines <strong>région</strong>s, ses gran<strong>de</strong>s dimensions, son agressivité et sa présence<br />
au voisinage immédiat <strong>de</strong> l’homme, l’ont fait choisir comme objet d’observations, <strong>de</strong> recherches et<br />
#d’expérimentations.<br />
Léon (1910) observe son comportement comme buveur <strong>de</strong> sang, en Roumanie. ArmandaIe (1911)<br />
le signale aux In<strong>de</strong>s ; Newstead (1912) à Malte, au Soudan, en Egypte. Ed. Sergent (1914) dit qu’il est<br />
très commun <strong>de</strong> juillet à septembre dans toutes les villes <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte algérienne, sur les Hauts P<strong>la</strong>teaux,<br />
jusqu’à 1 000 m d’altitu<strong>de</strong>, et au Sahara où ses piqûres incommo<strong>de</strong>nt sérieusement les nouveaux venus.<br />
Ed. & Et. Sergent & col<strong>la</strong>borateurs (1921) démontrent expérimentalement <strong>la</strong> transmission du Bouton<br />
d’Orient par P. papatasi.<br />
La biologie <strong>de</strong> cette espèce ,est une <strong>de</strong>s mieux connues parmi les Phlébotomes et son élevage, re<strong>la</strong>tivement<br />
facile, a été tenté, en premier lieu, avec plus ou moins <strong>de</strong> succès, par Grassi (1907), Newstead<br />
(1911), Howlett, Marett, Ring (1913), Waterston (1922) et plus tard, avec <strong>de</strong> meilleurs résultats, par<br />
Wittingham & Rook (1923), McCombie & col<strong>la</strong>borateurs (1926), Roubaud & Co<strong>la</strong>s Belcour (1927),<br />
Sacca (1945), Safyanova (1964), Schmidt et col<strong>la</strong>borateurs (1965), etc.<br />
Parrot (1922) fait <strong>de</strong>s observations sur le comportement, <strong>la</strong> fréquence saisonnière, l’habitat, <strong>la</strong><br />
nourriture <strong>de</strong>s <strong>la</strong>rves, le vol, <strong>la</strong> piqûre, le repas <strong>de</strong>s femelles et l’accouplement <strong>de</strong> P.papatasi.<br />
Adler & Theodor (1925-26) obtiennent <strong>la</strong> transmission expérimentale <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose cutanée<br />
.à l’homme par P. papatasi. Roubaud (1928) observe le ralentissement temporaire du développement <strong>la</strong>rvaire<br />
(asthénobiose pseudohivemale), phénomène <strong>de</strong> torpeur spontanée qui ne doit pas être confondu