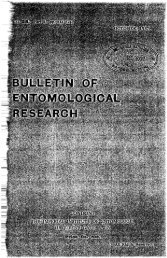Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MORPHOLOGIE ET ANATOMIE GÉNÉRALES 45<br />
Ba<strong>la</strong>nciers ou haltères.<br />
<strong>Les</strong> ba<strong>la</strong>nciers ou haltères sont <strong>de</strong>s appendices très mobiles, en forme <strong>de</strong> massue, qui s’articulent<br />
à <strong>la</strong> partie supérieure du métasternopleure. Ils représentent les vestiges <strong>de</strong> <strong>la</strong> paire d’aile postérieure <strong>de</strong>s<br />
Diptères (fig. 16 H).<br />
On distingue une partie basale massive, le scabellum, d’où s’élève un pédicelle portant une expansion<br />
en forme <strong>de</strong> massue. <strong>Les</strong> ba<strong>la</strong>nciers sont susceptibles <strong>de</strong> vibrations rapi<strong>de</strong>s et plus ou moins étendues.<br />
<strong>Les</strong> structures sensorielles du ba<strong>la</strong>ncier se situent à <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l’organe, dans le scabellum (fig. 15 H-s).<br />
4.1.1.3. Abdomen<br />
L’abdomen, cylindrique dans sa plus gran<strong>de</strong> partie, se termine par un cône. Il est composé <strong>de</strong><br />
10 segments dont les <strong>de</strong>rniers sont transformés en segments génitaux (fig. 17). <strong>Les</strong> 7 segments non modifXs<br />
portent chacun une paire <strong>de</strong> stigmates respiratoires. L’ouverture <strong>de</strong> ces stigmates, en forme <strong>de</strong> virgule, se<br />
situe en général vers le bord antérieur du segment, sur <strong>la</strong> membrane pleurale, plus près du tergite que du<br />
sternite.<br />
Le premier tergite est très court et il porte à son bord postérieur une touffe <strong>de</strong> longues soies dressées.<br />
<strong>Les</strong> 6 autres tergites portent, soit <strong>de</strong>s soies dressées (fig. 34) comme ceux du premier tergite, soit <strong>de</strong>s soies<br />
couchées (fig. 17) ou encore un mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux. <strong>Les</strong> sternites sont moins développés que les tergites ;<br />
ils sont séparés <strong>la</strong>téralement par une surface membraneuse pouvant se di<strong>la</strong>ter lorsque l’insecte se nourrit.<br />
<strong>Les</strong> sternites portent également <strong>de</strong>s fortes soies.<br />
Femelle. - Le 7e segment diffère peu <strong>de</strong>s autres ; il est un peu plus petit. Le tergite consiste en une<br />
ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> chitine assez développée s’étendant sur les côtés du corps. Le sternite est également réduit.<br />
Le 8e segment est profondément modifié ; <strong>la</strong>rgement membraneux dorsalement, il permet sa rétraction<br />
totale à l’intérieur du 7e segment. La chitinisation du tergite s’étend à <strong>la</strong> base, <strong>de</strong> chaque côté, sur une <strong>la</strong>rge<br />
ban<strong>de</strong> qui se rétrécit sur le dos. Ventralement, cette chitinisation vient en diminuant rejoindre son homologue<br />
sous <strong>la</strong> forme d’un épaississement traversant <strong>la</strong> ligne médiane. Le ge sternite est, lui aussi, fortement<br />
modifié ; son bord postérieur est si profondément encoché, que le segment est divisé en <strong>de</strong>ux lobes ovoï<strong>de</strong>s,<br />
ap<strong>la</strong>tis <strong>la</strong>téralement et se projetant librement en arrière. Ce sont les « gonapophyses ventrales » ou « inferior<br />
c<strong>la</strong>spers » <strong>de</strong>s Ang<strong>la</strong>is. <strong>Les</strong> surfaces supérieure et inférieure <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux lobes sont couvertes <strong>de</strong> soies<br />
nombreuses. Ils se continuent en une surface membraneuse sous forme <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux p<strong>la</strong>ques triangu<strong>la</strong>ires dont<br />
l’apex <strong>de</strong> chacune d’elles, dirigé vers l’arrière, porte une forte soie épineuse. Dans l’intervalle, entre les<br />
<strong>de</strong>uxlobes du gesternite, il y a une petite p<strong>la</strong>que semi-lunaire couverte <strong>de</strong> cils fins. Cette p<strong>la</strong>que correspond<br />
à l’insu<strong>la</strong> <strong>de</strong> l’hypopygium femelle <strong>de</strong>s moustiques (fig. 18 E-F In).<br />
Entre le 8e et le 9e tergite, sur <strong>la</strong> surface membraneuse <strong>la</strong>térale inter-segmentaire, s’ouvre, chez<br />
3 espèces cavernicoles africaines, <strong>de</strong>ux dépressions ciliées correspondant vraisemb<strong>la</strong>blement à <strong>de</strong>s organes<br />
sensoriels (fig. 52 B, 56 C).<br />
Le 9@ segment a un tergite très développé qui s’étend comme une <strong>la</strong>rge ban<strong>de</strong> sur les bords <strong>la</strong>téraux<br />
du corps. Le tiers antérieur du tergite est nu, le reste est couvert <strong>de</strong> longues soies. La surface ventrale<br />
opposée au tergite est couverte d’une fine membrane où viennent s’ouvrir les orifices du conduit commun<br />
<strong>de</strong>s spermathèques et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux g<strong>la</strong>n<strong>de</strong>s annexes, c’est <strong>la</strong> « genital area » <strong>de</strong> Sinton (1925).<br />
Le 10e (segment anal) consiste en une surface membraneuse occupée en partie par <strong>de</strong>ux p<strong>la</strong>ques<br />
chitineuses tergales en forme d’aman<strong>de</strong>, séparées sur <strong>la</strong> ligne médiane dorsale et se dirigeant <strong>de</strong> part et<br />
d’autre vers <strong>la</strong> face ventrale oh elles sont à peine apparentes (fig. 18 E). L’espace ventral <strong>de</strong> ce segment<br />
est séparé <strong>de</strong> l’aire génitale par une profon<strong>de</strong> r#mre, en arrière <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle une p<strong>la</strong>que <strong>de</strong> chitine mince<br />
(fig. 18 E PI) peut être divisée en <strong>de</strong>ux, chez certaines espèces. Cette p<strong>la</strong>que qui forme <strong>la</strong> paroi ventrale du<br />
lOe segment représente <strong>la</strong>post-genitalp<strong>la</strong>te <strong>de</strong> Christophers, Shortt & Barraud (1923). Son bord postérieur<br />
est couvert <strong>de</strong> fines soies, c’est lepost-genital ridge <strong>de</strong> Sinton (1925). Chez certaines espèces, il y a, en plus<br />
<strong>de</strong>s soies, quelques longs poils.<br />
Postérieurement au 10e tergite s’élève <strong>de</strong> chaque côté, une structure massive en forme <strong>de</strong> bonnet,<br />
ap<strong>la</strong>tie <strong>la</strong>téralement, dont <strong>la</strong> face dorsale se termine en pointe, face à son homologue, sur <strong>la</strong> ligne médiane<br />
entre les p<strong>la</strong>ques du 10e tergite. Ces structures qui ont été appelées « gonapophyses dorsales » ou « superior<br />
c<strong>la</strong>spers » représentent les « cerci » ou cerques.<br />
L’intervalle entre les cerques est couvert d’une tic membrane où s’ouvre dorsalement l’orifice<br />
anal (fig. 18 E).<br />
4