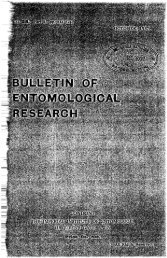Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera, Psychodidae)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MORPHOLOGIE ET ANATOMIE GÉNÉRALES 39<br />
du <strong>la</strong>bre à <strong>la</strong>quelle il est relié et où viennent se fixer les mandibules. Intérieurement il existe à ce niveau un<br />
point d’attache important <strong>de</strong> plusieurs faisceaux <strong>de</strong> muscles di<strong>la</strong>tateurs <strong>de</strong> l’appareil suceur. <strong>Les</strong> parties<br />
internes préocu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s joues sont également l’origine d’attache <strong>de</strong> grands muscles maxil<strong>la</strong>ires.<br />
La partie postérieure <strong>de</strong> <strong>la</strong> capsule céphalique (fig. 9) est reliée au corps par un cou membraneux<br />
et <strong>la</strong> face ventrale <strong>de</strong> <strong>la</strong> tête est également membraneuse. A l’origine <strong>de</strong>s palpes maxil<strong>la</strong>ires et entre ces<br />
<strong>de</strong>rniers existe un épaississement chitineux qui représente le submentum. Ce <strong>de</strong>rnier est séparé du mentum<br />
par un sillon transversal profond qui donne naissance au Zabium. Latéralement, ce sillon entoure <strong>la</strong> base<br />
du <strong>la</strong>bium au niveau <strong>de</strong>s articu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s <strong>la</strong>mes maxil<strong>la</strong>ires.<br />
La tête porte les appendices suivants : les antennes, le proboscis comprenant 6 pièces enfermées<br />
dans le <strong>la</strong>bium qui forme gaine. Ces six pièces sont : le <strong>la</strong>bre-épipharynx, l’hypopharynx, <strong>de</strong>ux mandibules,<br />
<strong>de</strong>ux mâchoires ou maxilles à <strong>la</strong> base <strong>de</strong>squelles se détachent les palpes maxil<strong>la</strong>ires.<br />
Chaque antenne est formée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux segments basaux, pas plus longs que <strong>la</strong>rges et <strong>de</strong> 14 segments,<br />
beaucoup plus longs et minces, constituant lejagellum. Le premier segment appelé « scape » est <strong>de</strong> forme<br />
irrégulière ; le <strong>de</strong>uxième nommé «pédicelle » ou « ~OIZS » est régulièrement ovoï<strong>de</strong> et contient chez le mâle<br />
et chez <strong>la</strong> femelle un organe chordotonal. Le 3e segment est toujours le plus long. On rencontre, en général<br />
du 3e au 15e segment outre quelques écailles et <strong>de</strong> fines soies dont ils sont abondamment pourvus, <strong>de</strong>s<br />
structures réfringentes, coudées à leur base, que Newstead a nommées « genicu<strong>la</strong>tedspines » (épinesgéniculées)<br />
OU « ascoids » (ascoï<strong>de</strong>s) (fig. 12 G-H-I-J). Ces structures seraient, d’après Feuerborn, <strong>de</strong>s organes<br />
sensoriels. On en compte <strong>de</strong>ux par segment chez <strong>la</strong> femelle et habituellement une par segment chez le<br />
mâle <strong>de</strong>s espèces paléarctiques et <strong>éthiopienne</strong>s. <strong>Les</strong> espèces du sous-genre Phlebotomus et les Phlébotomes<br />
américains présentent <strong>de</strong>ux épines géniculées par segment, dans les <strong>de</strong>ux sexes et, exceptionnellement<br />
quatre. Ces formations peuvent avoir <strong>de</strong>s prolongements postérieurs plus ou moins étendus (Eg. 12 I-J).<br />
Newstead a reconnu également sur les trois <strong>de</strong>rniers segments <strong>de</strong>s antennes <strong>de</strong>s <strong>phlébotomes</strong> <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ux sexes, l’existence d’organes particuliers qu’il a appelé « hirsut g<strong>la</strong>nds ». Parrot (1953) a montré<br />
par <strong>la</strong> suite l’existence <strong>de</strong> ces organes sur d’autres segments que les trois <strong>de</strong>rniers et propose <strong>de</strong> les nommer<br />
“papilles sensorielles » (fig. 12 G).<br />
Labre-épipharynx. - Il est fortement chitinisé et a <strong>la</strong> forme d’une <strong>la</strong>me <strong>de</strong> dague. On distingue un<br />
épaississement dorsal, median chitinisation of the <strong>la</strong>brum <strong>de</strong> Christophers, <strong>de</strong>ux bras chitineux et un épaississement<br />
ventral (épipharynx) ; ces quatre pièces sont basalement distinctes car elles ont chacune leur<br />
propre point d’attache mais dans <strong>la</strong> majeure partie <strong>de</strong> leur longueur elles sont soudées. Ventralement le<br />
<strong>la</strong>bre-épipharynx est concave et forme une gouttière longitudinale assez profon<strong>de</strong> qui se termine dans<br />
<strong>la</strong> cavité buccale. Par intervalle, le long <strong>de</strong> l’épipharynx il y a, <strong>de</strong> chaque côté, <strong>de</strong> petites fossettes sensorielles<br />
(Sg. 13 A-C).<br />
Mandibules. - Chaque mandibule est formée d’une <strong>la</strong>me <strong>la</strong>rge et pointue. A l’apex le bord interne<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>me est tiement <strong>de</strong>nticulé (fig. 12 A et 14 B). Vers <strong>la</strong> base <strong>la</strong> mandibule se rétrécit en un col assez<br />
long qui se termine par <strong>de</strong>s tubérosités. On distingue une protubérance interne qui s’articule avec le côté<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> cavité buccale et sur <strong>la</strong>quelle prend naissance le tendon du muscle adducteur; une protubérance<br />
externe recevant I’insertion du muscle abducteur et une médiane agissant comme surface articu<strong>la</strong>ire avec<br />
le condyle mandibu<strong>la</strong>ire.<br />
Maxilles. - De chaque côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> base du mentum, à l’extrémité antérieure <strong>de</strong> <strong>la</strong> joue membraneuse<br />
et continuant <strong>la</strong> ligne <strong>de</strong> <strong>la</strong> chitinisation maxil<strong>la</strong>ire, se trouve <strong>la</strong> <strong>la</strong>me maxil<strong>la</strong>ire (galea). Chaque <strong>la</strong>me, forte<br />
à <strong>la</strong> base, se rétrécit beaucoup en al<strong>la</strong>nt vers l’apex qui est arrondi mais souvent peut paraître aigu. Le<br />
bord externe est <strong>de</strong>nticulé à l’apex sur une courte distance tandis que <strong>la</strong> <strong>de</strong>nticu<strong>la</strong>tion du bord interne est<br />
plus importante mais disparaît le plus souvent avant l’extrémité (fig. 12 A et 14 A).<br />
Hypopharynx. - Faisant suite au p<strong>la</strong>ncher <strong>de</strong> <strong>la</strong> cavité buccale (fig.13 P-b) l’hypopharynx est une<br />
sorte <strong>de</strong> <strong>la</strong>me aussi longue et aussi <strong>la</strong>rge que l’épipharynx sur lequel elle s’étend. L’extrémité <strong>de</strong> cet organe<br />
a ses bords régulièrement <strong>de</strong>ntés ; ces <strong>de</strong>nts sont très minces et flexibles et pour cette raison, Christophers,<br />
Shortt & Barraud pensent que l’hypopharynx n’a pas <strong>de</strong> fonctions perforatrices. Sur <strong>la</strong> majeure partie<br />
<strong>de</strong> sa longueur l’hypopharynx est percé d’un canal qui débouche sur un long sillon vers l’extrémité libre.<br />
L’hypopharynx est ventral par rapport au <strong>la</strong>bre-épipharynx et son extrémité découpée en <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> scie,<br />
sur les bords, est en contact direct avec les épines sensorielles apicales du <strong>la</strong>bre formant ainsi une sorte<br />
<strong>de</strong> filtre.<br />
Labium. - Le <strong>la</strong>bium est fortement chitinisé et forme <strong>la</strong> pièce <strong>la</strong> plus volumineuse du proboscis.<br />
La partie basale est constituée par une p<strong>la</strong>que grossièrement triangu<strong>la</strong>ire (mentum). A l’apex <strong>de</strong> cette pièce<br />
basale se situent les <strong>la</strong>belles, appendices mobiles composés <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux segments ; chacun d’eux porte une<br />
p<strong>la</strong>que ventrale chitineuse sur <strong>la</strong>quelle s’insèrent <strong>de</strong>s soies. <strong>Les</strong> bords <strong>la</strong>téraux <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux segments débor<strong>de</strong>nt