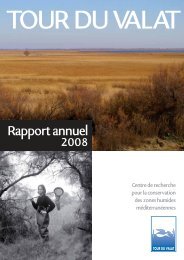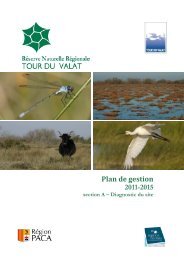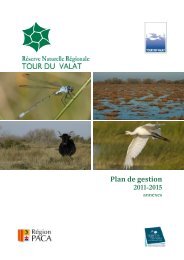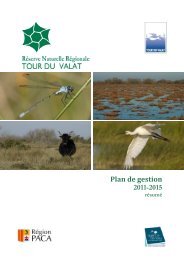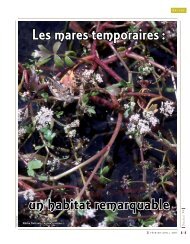Les mares temporaires méditerranéennes Volume 1
Les mares temporaires méditerranéennes Volume 1
Les mares temporaires méditerranéennes Volume 1
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4. Menaces sur les <strong>mares</strong> <strong>temporaires</strong> méditerranéennesPlusieurs expériences en laboratoire ont montré que les larvesd’amphibiens s’alimentent moins, se déplacent moins vite, présententdes déséquilibres, des malformations et un taux de mortalitéaccru quand des faibles niveaux de nitrates et de nitrites sontadditionnés à l’eau249, 409(Encadré 36). En Espagne, 3 espècesd’amphibiens se sont révélées très sensibles au nitrate d’ammonium: la Rainette arboricole, le Discoglosse de Galganoi et leCrapaud commun 287 . Chez la Rainette, une mortalité de 30 % a étéconstatée pour des concentrations de 50 mgL -1 (concentrationlégale admise pour la consommation humaine). <strong>Les</strong> autres espèces,moins sensibles, montraient néanmoins une croissance ralentie etdes anomalies de développement.<strong>Les</strong> amendements en phosphore et en potassium peuvent aussieutrophiser les <strong>mares</strong>, induire des proliférations algales et favoriserles espèces végétales compétitives au détriment des espècesrares et caractéristiques. Béja et Alcazar 29 soupçonnent ainsi quela prolifération des massettes (Typha sp.), dans des <strong>mares</strong> au Portugal,résulte d’une concentration croissante en éléments nutritifs.La pollution peut aussi être d’origine urbaine : au centre de l’Espagne146 et au Maroc (Rhazi, Thiéry, com. pers.), on a pu observer desdéversements d’eaux usées urbaines dans les zones humides <strong>temporaires</strong>.La mare d’Opoul (Pyrénées-Orientales, France) a été utilisée,dans le passé, comme exutoire de la station d’épuration des eauxdomestiques 210, 284 , sans que l’on sache si ces apports ont eu desconséquences fâcheuses sur les batraciens ou sur la flore.Polluants toxiques et déchargesDans le cadre de la lutte contre le paludisme, des produits insecticidessont déversés directement dans les <strong>mares</strong> (au Maroc 263 ). <strong>Les</strong>apports indirects peuvent provenir des activités humaines diversessur le bassin versant, notamment les produits phytosanitaires utilisésdans l’agriculture. <strong>Les</strong> routes sont des sources de pollutiontrès diverses, que ce soit à l’occasion d’accidents impliquant desvéhicules transportant des produits toxiques, par les lessivats routiersriches en hydrocarbures ou par les produits utilisés pour l’entretiendes routes (herbicides, sels, chaux, etc.). Dans le cas deszones humides karstiques, l’origine de la contamination peut êtrebeaucoup plus lointaine que ne le laisse suggérer le bassin versantsuperficiel (Chapitre 3b). Le degré de contamination d’un site variesurtout en fonction de la quantité de produit chimique déverséepar unité de surface, mais aussi de la taille de la surface traitée etde la rémanence des substances. Il n’est pas rare de trouver desconcentrations plus élevées de substances toxiques dans lespetites <strong>mares</strong> isolées (systèmes fermés) situées près des zonesagricoles que dans des zones humides plus vastes où le renouvellementde l’eau est plus important.Partout en Méditerranée, les <strong>mares</strong> <strong>temporaires</strong> servent de dépôtsd’ordures ou de gravats. Ces dépôts font régresser les Bryophytescaractéristiques et provoquent l’apparition de groupements terricolesnitrophiles à Barbula unguiculata, Funaria hygrometrica,etc., qui sont des espèces rudérales très banales (Hugonnot &Hébrard, com. pers.).L’accumulation de pesticides dans les eaux de ruissellement,représente un risque élevé pour les amphibiens (Encadré 36) et lesinvertébrés aquatiques 166 (Encadré 37). Dans un certain nombre decas, il semble que les amphibiens aient de bonnes capacités derésistance aux agents polluants. L’établissement de populationsd’amphibiens dans les bassins de rétention des eaux de lessivageEncadré 37. <strong>Les</strong> pesticides et les libellulesLa qualité des eaux de surface s’est fortement dégradée depuisplusieurs années et les libellules semblent actuellement moinsnombreuses, certaines espèces paraissant même avoir disparu 101 .Des études récentes 58 montrent que plusieurs pesticides contaminentde façon chronique les eaux de pluie, en particulierl’Atrazine (herbicide), la DEA (diéthylatrazine), l’Alachlore (herbicide),le Lindane (γ-HCH) (insecticide) et son isomère le β-HCH.<strong>Les</strong> teneurs en pesticides dans les eaux peuvent parfois dépasserplusieurs dizaines de milligrammes à l’hectare (en Atrazine etAlachlore). Si peu d’études existent dans la région méditerranéenne,on dispose de données dans les régions périphériquesmontrant une grande sensibilité des libellules aux pesticidesdurant leur vie aquatique, c’est-à-dire aux stades larvaires.Le Méthoprène, agent régulateur de croissance des insectes, utilisépour lutter contre les moustiques, provoque une diminutiondes peuplements d’Odonates 362, 56 . De même les carbamates sontactifs sur 7 genres de Zygoptères et d’Anisoptères 164 . Après septjours d’application de Diflubenzuron, Zgomba et al. 420 constatent72 % de mortalité des Odonates en Yougoslavie. <strong>Les</strong> applicationsde Bacillus thurigensis, BT sérotype H-14, provoquent desréactions similaires. Des résultats identiques ont été observéssur les populations de Diptères Chironomides 305 .<strong>Les</strong> organophosphates provoquent la mort des larves de libellulesen moins de deux heures. Le Fenthion, le Bromophos et leLindane sont très toxiques sur les Zygoptères (<strong>Les</strong>tes sponsa,Ischnura elegans, Coenagrion puella) pour lesquelles on enregistreune mortalité de 40 % des populations en moins de 48 heures 212 .<strong>Les</strong> concentrations élevées en Roténone, éliminent les Aeschnidae.D’une façon générale, dans les eaux contaminées, les densitésen Odonates sont réduites de 30 % par rapport aux milieuxnaturels 370 . En Allemagne, dans la région d’Hambourg, seules2 espèces Coenagrion puella et C. pulchellum ont survécu sur les14 connues 25 ans plus tôt 183 .Dans le cas des rizières, les pesticides ont fait l’objet d’étudesrécentes : en Grèce, Schnapauff et al. 349 montrent un effet négatifdu Propanil (N-(3,4-dichlorophényl)-propionamid) associé auParathion (un organophosphoré) sur les populations d’Ishnuraelegans. En Camargue, Suhling et al. 366 notent que Sympetrumfonscolombii et Orthetrum cancellatum, sont clairement affectéespar des traitements qui associent l’Icazon à l’Alphamethine(un pyréthroide). Suhling (com. per.) émet l’hypothèse que Sympetrumdepressiusculum, qui sera bientôt ajoutée à la liste rougemondiale UICN et dont les larves se développaient dans lesrizières camarguaises dans les années 1960 3 , a disparu consécutivementà l’utilisation des insecticides. En Camargue, le Fipronyl,seul insecticide actuellement autorisé, est lui aussi soupçonnéd’entraîner une réduction de la taille et une modification de lastructure des populations chez la moitié des espèces présentesdans les rizières 155 (Crocothemis erythraea, Orthetrum cancellatumet O. albistylum).<strong>Les</strong> larves d’Odonates sont de bons indicateurs de la qualité deseaux 369, 253 . Un suivi à long terme des populations d’Odonates estdonc du plus haut intérêt pour la gestion des milieux. Toutefois,les libellules étant connues pour leurs grandes capacités de vol,un inventaire basé sur les occurrences d’adultes n’est pas pertinent.L’autochtonie des adultes doit être vérifiée par l’étude deslarves et des exuvies, preuves d’une reproduction réussie dans lebiotope.Thiéry A.67