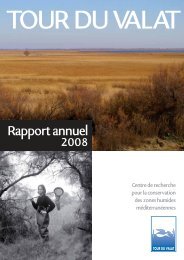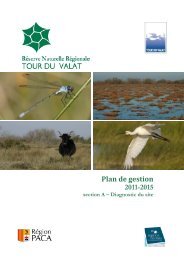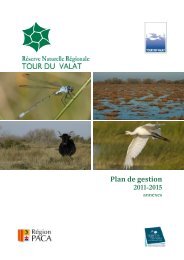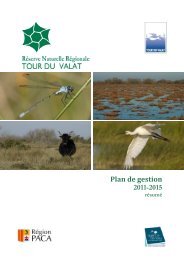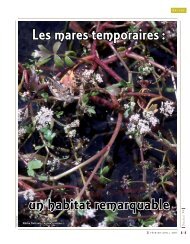Les mares temporaires méditerranéennes Volume 1
Les mares temporaires méditerranéennes Volume 1
Les mares temporaires méditerranéennes Volume 1
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Les</strong> <strong>mares</strong> <strong>temporaires</strong> méditerranéennesb. Suivi hydrologiqueChauvelon P. & P. HeurteauxL’établissement d’un diagnostic quantitatif du fonctionnement hydrologiqued’un plan d’eau nécessite le recensement des composantesdu cycle de l’eau (Fig. 36) qui interviennent dans ce fonctionnement.Une connaissance suffisante des caractéristiques géographiqueset géologiques du milieu étudié et un minimumd’équipement de mesure (capacité métrologique) sont indispensables.<strong>Les</strong> caractéristiques géographiques et géologiques à connaître ontdéjà été évoquées dans le Chapitre 3b.Elles s’obtiennent par une étude approfondie de tous les documentspouvant être rassemblés concernant un environnement élargi dusite étudié : cartes topographiques, cartes géologiques, cartes pédologiques,vues aériennes (photos et/ou images satellitales). Cesdonnées permettent de préciser les lignes de crête définissant lebassin versant, de calculer sa surface, d’apprécier sa topographieet sa végétation, de connaître sa lithologie (roches compactes,roches poreuses, réseaux karstiques) et d’envisager une possibleintervention des eaux souterraines dans le cycle de l’eau de surface.Cette documentation facilitera l’inventaire et la descriptiondes aménagements sur le bassin versant susceptibles d’avoir uneinfluence sur les écoulements (fossés, drains, etc.)Des précisions supplémentaires seront souvent nécessaires : levéstopographiques pour préciser les courbes de niveau des cartes etpour faire la bathymétrie détaillée des plans d’eau (Encadré 51),caractérisation locale du substrat sédimentaire du fond des <strong>mares</strong>(texture, structure, stratification) et à proximité jusqu’à une profondeurau moins égale à la cote du fond des <strong>mares</strong>.La capacité métrologique concerne au premier chef le suivi del’évolution des niveaux d’eau de la mare, la quantification des précipitations,de l’évaporation de l’eau libre et de l’évapotranspiration.Il faut rappeler que l’exploitation de matériel hydrométriqueinstallé en un lieu public est souvent soumise au risque de vol oude vandalisme.La mesure des niveaux (Encadré 52) doit être faite régulièrement.Leur enregistrement automatique en continu est évidemment lameilleure solution. Si l’on doit se contenter de mesures ponctuelles,deux mesures par mois semblent un minimum. Si possible,les mesures des épisodes pluvieux se feront, au plus tard, un oudeux jours après leur fin. Si l’on se cantonne à un calendrier avecdes dates d’intervention fixées systématiquement au cours dutemps, il y a peu de chance que les dates de visites coïncident avecdes événements hydrologiques intéressants.Pour quantifier les précipitations, on utilisera le plus souvent lesdonnées des réseaux d’observation existants (Encadré 53), malgréla variabilité spatiale importante des pluies, notamment en régionméditerranéenne où les précipitations orageuses prédominent.Lorsque la densité des pluviomètres est insuffisante et pour unbilan précis, la mesure sur site, c’est-à-dire à moins d’un kilomètrede distance, et à la même altitude, s’avèrera nécessaire.L’estimation des flux d’eau vers l’atmosphère (évaporation et évapotranspiration)se fera le plus souvent par le calcul à partir dedonnées climatologiques, en utilisant des formules empiriques.Encadré 51. La topographie et la bathymétrieLa bathymétrie des <strong>mares</strong> étudiées peut être obtenue assez facilementen mode relatif, par rapport à la surface calme du pland’eau, à une période de remplissage maximal de la mare. Il suffirapour cela d’un ruban gradué, d’une jauge de profondeur etde bonnes cuissardes.Il est conseillé d’avoir au moins 2 repères fixes au sol, alignésselon le plus grand axe de la mare : un en position “centrale” etl’autre en bordure ou sur la rive. Ces repères bien visibles (bornesde géomètre, piquets solidement enfoncés) serviront de référencepour la description géométrique du site et les suivis. Nousproposons comme base de description de mesurer ensuite lesprofondeurs selon 4 à 8 transects régulièrement espacés à partirde l’axe de référence matérialisé par les 2 repères au sol. <strong>Les</strong>densités de transects dans la mare et de points de mesure partransect sont très variables en fonction de la topographie : ilsseront faibles sur des pentes régulières et augmenteront lorsqueles pentes sont irrégulières.Pour un travail alliant précision, quantité de données et économiede temps, il est nécessaire d’utiliser du matériel de topographieprofessionnel. Le théodolithe électronique ou stationtotale, à visée laser, permet d’acquérir, avec deux opérateurs,plusieurs centaines de points par jour avec une précision centimétrique,et de récupérer les points stockés en mémoire pourune utilisation informatique directe.Certains GPS différentiels permettent d’effectuer des relevésavec une précision centimétrique, en ne monopolisant, une foisla station de référence mise en place, qu’un opérateur sur le terrain,pouvant se déplacer dans un rayon de plusieurs kilomètresautour de la référence pour effectuer le relevé de points.Ces dispositifs de mesure sont coûteux, mais des possibilités delocation existent pour les deux types (environ 1 000 € la semainepour un GPS différentiel, des locations à la journée sont possibles).Il faudra prévoir une formation de base sur leur utilisation,dispensée par les loueurs.Lorsque les budgets de fonctionnement sont limités, mais que lepersonnel est disponible et le temps non limitant, il est possibled’investir pour le prix d’une semaine de location, dans l’achat dematériel optique (lunette, mire, etc.) réutilisable à volonté.Chauvelon P. & P. HeurteauxToutes nécessitent au minimum la température de l’air sous abri,et d’autres plus élaborées comme celle de Penman 293 réclament, enplus, l’humidité de l’air, le rayonnement solaire et/ou la durée d’insolationet la vitesse du vent.Peu de gestionnaires auront la possibilité de mesurer ces paramètreseux-mêmes à l’aide d’une station météorologique automatiquesur leur site. <strong>Les</strong> données seront à rechercher auprès desorganismes gérant des réseaux de mesures. En France, on obtiendraces données auprès de Météo-France, de l’INRA, à titre onéreux, etéventuellement des services départementaux de l’agriculture (DDA)ou de l’équipement (DDE).L’évapotranspiration réelle (ETR) d’un couvert végétal n’est pascalculable a priori, et la méthode communément utilisée consisteà passer par l’intermédiaire d’une valeur climatique de référence :l’évapotranspiration potentielle climatique (ETP). En fonction de ladisponibilité en eau du substrat, l’ETR d’un couvert végétal représenteraune proportion plus ou moins grande de l’ETP.92