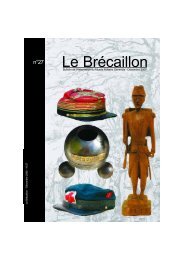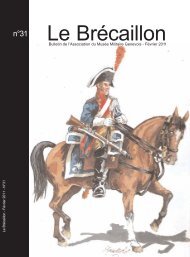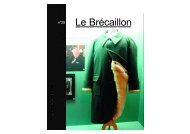Téléchargez - Musée Militaire Genevois
Téléchargez - Musée Militaire Genevois
Téléchargez - Musée Militaire Genevois
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1848: LA LÉGION HELVÉTIQUE ROMANDE 1848: LA LÉGION HELVÉTIQUE ROMANDE<br />
de ses camarades de classe et notamment<br />
Ferdinand Lecomte qui en fait lui aussi<br />
partie. Lecomte mentionne le fait dans<br />
livret de service qu’il recevra en 1876,<br />
alors qu’il est divisionnaire, et dans<br />
lequel il inscrira, année après année, les<br />
services effectués dans les armées suisse<br />
et étrangères. L’inscription pour l’année<br />
1845 est lapidaire: «garde civique soldée<br />
Lausanne, 8 semaines. (24) » Après la<br />
Révolution, Borgeaud retrouve sa classe<br />
et Lecomte peut consacrer tout son temps<br />
à ses études universitaires et à ses<br />
activité politiques. «A la Révolution de<br />
février 1845, explique Olivier Meuwly,<br />
qui voit les radicaux renverser leurs<br />
adversaires libéraux, Lecomte ne reste<br />
d’ailleurs pas étranger. Âgé de 19 ans, il<br />
est déjà pleinement du côté des radicaux<br />
et se tient à disposition, parmi les<br />
volontaires prêts à soutenir le nouveau<br />
régime. Une fois le changement de<br />
pouvoir effectué, il ne retourne pas aux<br />
marges de la vie politique: il l’a effleurée<br />
dans ces chaudes journées de l’hiver<br />
vaudois, il ne la quittera plus. (25) »<br />
Il subit cependant une terrible<br />
déconvenue, alors qu’il a porté déjà les<br />
armes pour son canton et sa révolution et<br />
qu’il désire plus que tout servir dans les<br />
troupes d’élite, il est, en 1846<br />
probablement, refusé au recrutement (26) Le général Guillaume-Henri Dufour (Album<br />
Lecomte)<br />
. La décision n’est pas scandaleuse,<br />
Ferdinand Lecomte est petit, fluet et, la suite de sa carrière le montrera, de santé<br />
fragile, mais elle l’irrite profondément et il n’aura pas de cesse avant de l’avoir<br />
contournée. Il n’est pas homme à renoncer. Il trouvera bien un moyen de servir! Il se<br />
jette, en attendant, à corps perdu dans le militantisme radical. Il le fait dans une<br />
ambiance fiévreuse, le climat politique suisse s’alourdit. La Diète, où Druey et le<br />
turbulent Eytel représentent le canton de Vaud, exige la dissolution du Sonderbund<br />
qui est finalement votée le 13 octobre 1847. Les préparatifs de guerre des cantons<br />
conservateurs vont déjà bon train. Le 21 octobre le général Dufour est désigné<br />
comme commandant en chef. Ce choix mécontente les radicaux genevois, bernois et<br />
vaudois. Dufour tergiverse. Le 24, après une scène assez pénible, il renonce à ce<br />
commandement. Jules Eytel lance que s’il ne veut pas être général on en trouvera un<br />
76 Le Brécaillon<br />
autre! Druey est encore plus cru. Finalement le 25, Dufour accepte sa désignation et<br />
prête enfin serment. La mobilisation est votée le 30 octobre et l’ordre de dissoudre<br />
le Sonderbund par la force est donné le 4 novembre.<br />
Certains cantons rechignent à fournir leur contingent, Berne et Vaud, et Dufour s’en<br />
plaindra, font plus que leur part. L’effort des Vaudois est titanesque. Ils lèvent plus<br />
de 20.000 hommes (27) . Constant Borgeaud, alors capitaine d’état major (28) , écrivant<br />
sur le tard ses souvenirs de la campagne (29) affirme: «Le canton de Vaud mit donc sur<br />
pied vingt quatre bataillons; huit compagnies de carabiniers d’élite; huit batteries,<br />
quatre compagnies de cavalerie; deux compagnies de sapeurs; quelques compagnies<br />
de volontaires (30) . Enfin les attelages pour toutes les voitures de réquisitions d’autant<br />
plus nombreuses que nous n’avions point de chemin de fer et d’autant plus difficiles<br />
à fournir qu’on avait déjà levé tous les chevaux de l’artillerie, de la cavalerie et des<br />
états-majors.»<br />
On peut, à la lecture de ces chiffres, parler d’enthousiasme mais qu’est-ce qui le<br />
motive? Laferveur révolutionnaire? Elle porte nombre d’officiers (31) et d’hommes de<br />
troupes, dont certainssont jeunes et bien décidés à changer les choses en Suisse.<br />
Borgeaud résume leur opinion lorsqu’il écrit au sujet de cette mobilisation: «Voilà ce<br />
que le canton de Vaud a fait avec enthousiasme pour substituer à l’ancienne alliance<br />
des cantons désunis une nation suisse...»<br />
L’engagement des Vaudois n’est pas avant tout révolutionnaire, par son effort contre<br />
le Sonderbund, la nation vaudoise s’affirme. Le contingent vaudois n’est pas qu’un<br />
contingent cantonal parmi d’autres, c’est «l’armée vaudoise», grand objet de fierté.<br />
Le canton de Vaud doit assurer aussi sa sécurité, Fribourg a 15.000 hommes sous les<br />
armes et le Valais que surveille la brigade Nicollier, presque autant et il n’est pas<br />
question de laisser occuper par l’ennemi la moindre parcelle du sol vaudois! Le 10<br />
novembre la brigade du colonel Frederich Veillon s’ébranle. Elle avance d’Yverdon<br />
sur Estavayer. Jules Eytel commande une compagnie de carabiniers dépendant<br />
directement du commandant de la brigade, il prend ses ordres de Borgeaud qui en est<br />
un peu l’officier à tout faire. Estavayer est occupé sans coup férir, la brigade y<br />
bivouaque. Le lendemain elle retrouve le sol vaudois et stationne à Payerne, le 12<br />
elle progresse jusqu’à Avry et le lendemain accroche les troupes fribourgeoises à la<br />
redoute Bertigny, près de laquelle se livre un combat confus, où Eytel et Borgeaud<br />
jouent le premier rôle (32) , qui incite le colonel Veillon à se replier quelque peu vers<br />
Montéor. Fribourg d’ailleurs a déjà demandé et obtenu un armistice. Le 14<br />
novembre, vers 15 heures, la division Rilliet entre dans la ville. «Les bataillons, écrit<br />
lyriquement Borgeaud, succédaient aux bataillons; les batteries succédaient aux<br />
batteries, les musiques jouaient, la trompette sonnait. Au bruit sourd des roues de<br />
notre artillerie sur les grands pavés se mêlait le mugissement de l’airain placé sur<br />
ses affûts. Les cavales hennissaient et forgeaient le fer...» Puis, sans transition, le<br />
vieux colonel quitte le champ des souvenirs et revient en 1897 à l’époque où il écrit:<br />
«Pour nous, petit groupe de vieillards, alors jeunes acteurs dans cette grande scène<br />
où il n’y avait ni vainqueurs, ni vaincus, mais où naissaient les prémices d’une<br />
Le Brécaillon<br />
77