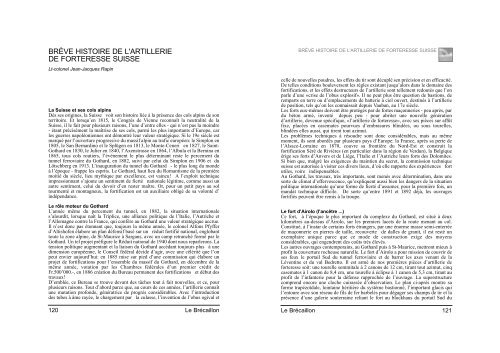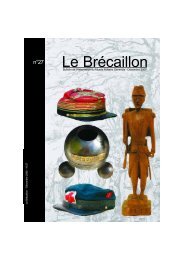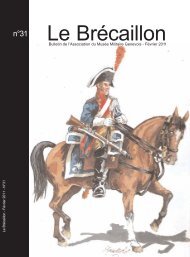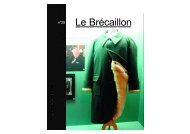Téléchargez - Musée Militaire Genevois
Téléchargez - Musée Militaire Genevois
Téléchargez - Musée Militaire Genevois
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BRÈVE HISTOIRE DE L'ARTILLERIE<br />
DE FORTERESSE SUISSE<br />
Lt-colonel Jean-Jacques Rapin<br />
La Suisse et ses cols alpins<br />
Dès ses origines, la Suisse voit son histoire liée à la présence des cols alpins de son<br />
territoire. Et lorsqu’en 1815, le Congrès de Vienne reconnaît la neutralité de la<br />
Suisse, il le fait pour plusieurs raisons, l’une d’entre elles - qui n’est pas la moindre<br />
- étant précisément la maîtrise de ses cols, parmi les plus importants d’Europe, car<br />
les guerres napoléoniennes ont démontré leur valeur stratégique. Si le 19e siècle est<br />
marqué par l’ouverture progressive du massif alpin au trafic européen: le Simplon en<br />
1805, le San Bernardino et le Splügen en 1813, le Monte-Ceneri en 1827, le Saint-<br />
Gothard en 1830, le Julier en 1840, l’Axenstrasse en 1864, l’Albula et la Bernina en<br />
1865, tous cols routiers, l’événement le plus déterminant reste le percement du<br />
tunnel ferroviaire du Gothard, en 1882, suivi par celui du Simplon en 1906 et du<br />
Lötschberg en 1913. L’inauguration du tunnel du Gothard - le plus long du monde<br />
à l’époque - frappe les esprits. Le Gothard, haut lieu du Romantisme de la première<br />
moitié du siècle, lieu mythique par excellence, est vaincu! A l’exploit technique<br />
impressionnant s’ajoute un sentiment de fierté nationale légitime, comme aussi un<br />
autre sentiment, celui du devoir d’en rester maître. Or, pour un petit pays au sol<br />
tourmenté et montagneux, la fortification est un auxiliaire obligé de sa volonté d’<br />
indépendance.<br />
Le rôle moteur du Gothard<br />
L’année même du percement du tunnel, en 1882, la situation internationale<br />
s’alourdit, lorsque naît la Triplice, une alliance politique de l’Italie, l’Autriche et<br />
l’Allemagne contre la France, qui confère au Gothard une valeur stratégique accrue.<br />
Il n’est donc pas étonnant que, toujours la même année, le colonel Alfons Pfyffer<br />
d’Altishofen élabore un plan défensif basé sur un réduit fortifié national, englobant<br />
toute la zone alpine, de St-Maurice à Sargans, avec un camp retranché formé par le<br />
Gothard. Un tel projet préfigure le Réduit national de 1940 dont nous reparlerons. La<br />
tension politique augmentant et la liaison du Gothard accédant toujours plus à une<br />
dimension européenne, le Conseil fédéral décide d’agir, avec une célérité que l’on<br />
peut envier aujourd’hui: en 1885 mise sur pied d’une commission qui élabore un<br />
projet de fortifications pour l’ensemble du massif du Gothard, en décembre de la<br />
même année, votation par les Chambres fédérales d’un premier crédit de<br />
Fr.500’000.-, en 1886 création du Bureau permanent des fortifications et début des<br />
travaux!<br />
D’emblée, ce Bureau se trouve devant des tâches tout à fait nouvelles, et ce, pour<br />
plusieurs raisons. Tout d’abord parce que, au cours de ces années, l’artillerie connaît<br />
une mutation profonde, génératrice de progrès considérables. Avec l’introduction<br />
des tubes à âme rayée, le chargement par la culasse, l’invention de l’obus ogival et<br />
120 Le Brécaillon<br />
celle de nouvelles poudres, les effets du tir sont décuplé sen précision et en efficacité.<br />
De telles conditions bouleversent les règles existant jusqu’alors dans le domaine des<br />
fortifications, et les effets destructeurs de l’artillerie sont tellement redoutés que l’on<br />
parle d’une «crise de l’obus explosif». Il ne peut plus être question de bastions, de<br />
remparts en terre ou d’emplacements de batterie à ciel ouvert, destinés à l’artillerie<br />
de position, tels qu’on les connaissait depuis Vauban, au 17e siècle.<br />
Les forts eux-mêmes doivent être protégés par de fortes maçonneries - peu après, par<br />
du béton armé, inventé depuis peu - pour abriter une nouvelle génération<br />
d’artillerie, devenue spécifique, «l’artillerie de forteresse», avec ses pièces sur affût<br />
fixe, placées en casemates pourvues d’embrasures blindées, ou sous tourelles,<br />
blindées elles aussi, qui tirent tout azimut.<br />
Les problèmes techniques à résoudre sont donc considérables, mais au même<br />
moment, ils sont abordés par plusieurs pays d’Europe: la France, après sa perte de<br />
l’Alsace-Lorraine en 1870, couvre sa frontière du Nord-Est et construit la<br />
fortification Séré de Rivières (en particulier dans la région de Verdun), la Belgique<br />
érige ses forts d’Anvers et de Liège, l’Italie et l’Autriche leurs forts des Dolomites.<br />
Si bien que, malgré les exigences du maintien du secret, la commission technique<br />
suisse est autorisée à visiter ces divers lieux, d’où elle rapporte des expériences fort<br />
utiles, voire indispensables.<br />
Au Gothard, les travaux, très importants, sont menés avec détermination, dans une<br />
sorte de climat d’effervescence, qu’expliquent aussi bien les dangers de la situation<br />
politique internationale qu’une forme de fierté d’assumer, pour la première fois, un<br />
mandat technique difficile. De sorte qu’entre 1891 et 1892 déjà, les ouvrages<br />
fortifiés peuvent être remis à la troupe.<br />
Le fort d’Airolo (l’ancêtre ...)<br />
Ce fort, à l’époque le plus important du complexe du Gothard, est situé à deux<br />
kilomètres au-dessus d’Airolo, sur les premiers lacets de la route menant au col.<br />
Constitué, à l’instar de certains forts étrangers, par une énorme masse semi-enterrée<br />
de maçonnerie en pierres de taille, recouverte de dalles de granit, il est resté un<br />
exemplaire unique parce que ce mode de construction exige des moyens<br />
considérables, qui engendrent des coûts très élevés.<br />
Les autres ouvrages contemporains, au Gothard puis à St-Maurice, mettront mieux à<br />
profit la couverture rocheuse naturelle. Le fort d’Airolo a pour mission de couvrir de<br />
ses feux le portail Sud du tunnel ferroviaire et de barrer les axes venant de la<br />
Léventine et du val Bedretto. Il est armé de nos premières pièces d’artillerie de<br />
forteresse soit: une tourelle sommitale à 2 canons de 12 cm, tirant tout azimut, cinq<br />
casemates à 1 canon de 8,4 cm, une tourelle à éclipse à 1 canon de 5,3 cm, tirant au<br />
profit de l’infanterie pour la défense rapprochée de l’ouvrage. La superstructure<br />
comprend encore une cloche cuirassée d’observation. Le plan ci-après montre sa<br />
forme trapézoïdale, lointaine héritière du système bastionné, l’important glacis qui<br />
l’entoure avec son réseau de fils de fer barbelés pour dégager ses champs de tir et la<br />
présence d’une galerie souterraine reliant le fort au blockhaus du portail Sud du<br />
Le Brécaillon<br />
BRÈVE HISTOIRE DE L'ARTILLERIE DE FORTERESSE SUISSE<br />
121