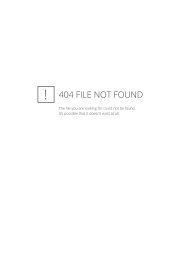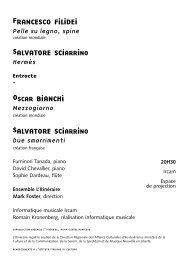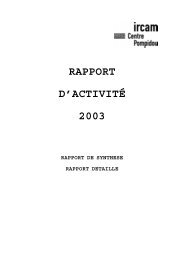You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENTANALYSE DES PRATIQUES MUSICALESRAPPORT DÉTAILLÉParticipants : Th. Bottini (stage UTC), N. Donin, J. Goldman (chercheur invité), J. Theureau.Collaboration interne : S. Goldszmidt (direction des Relations extérieures).1.6.2.4. Musicologie et sciences humaines – approche historiqueL’ensemble des déplacements par rapport à la musicologie traditionnelle opérés par notreprogramme de recherche supposent une élaboration théorique dans le champ musicologique,afin de contribuer à l’actuel renouveau méthodologique des études musicales, effectif depuisune vingtaine d’années dans les pays anglo-saxons et amorcé en France. Cette élaborations’effectue entre autres par la relecture critique de l’histoire des disciplines musicologiquesdans leur relation avec les pratiques musicales et savantes de leurs époques.D’une part, une collaboration avec Rémy Campos a permis une investigation critiqueapprofondie dans le passé de la musicologie, et en particulier dans le moment de soninstitutionnalisation (début du XXe siècle). Nous avons montré que la musicologie s’étaitconstituée non sur des méthodes mais autour de l’objet musique tel que les érudits de la fin duXIXe siècle pouvaient l’aborder, c’est-à-dire par une approche philologique de la partition (d’oùle graphocentrisme caractéristique de la musicologie au XXe siècle), par l’expérience vécue duconcert (importance des controverses esthétiques et de la question du jugement de valeur) etpar les instruments (organologie déconnectée des usages, selon le modèle des collectionsinstrumentales de particuliers puis de musées). Cela permet d’expliquer pourquoi lamusicologie a manqué à cette époque, et pour longtemps, son alliance avec les scienceshumaines naissantes, qui abordaient la question de la production sociale des pratiques et desvaleurs à travers des notions telles que la participation.D’autre part, une collaboration avec Frédéric Keck a permis de proposer une explicationhistorique du malentendu entre l’anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss (dansl’Ouverture du Cru et le cuit) et la musique contemporaines (controverses avec Pousseur,Deliège, Berio, etc.), en relation avec la constitution du structuralisme dans le champ dessciences humaines et dans la musique en France. Sont dégagées, à travers l’analyse de textesde Lévi-Strauss et de Boris de Schloezer, des pratiques de pensée et des pratiques d’écouteantagonistes (radio et concert, modèle wagnériste et modèle de la table rase, etc.), formésdans des champs intellectuels et culturels trop décalés chronologiquement pour pouvoir serencontrer. De là une hypothèse au sujet des pratiques musicales qui ont rendu possible lestructuralisme, notamment à partir du modèle synoptique de la partition comme mise envisibilité de différences senties (analyse du mythe d’Œdipe par Lévi-Strauss, reprise par desmusicologues tels Ruwet et Nattiez).Ces thèses sont développées dans un numéro thématique de la Revue d’histoire des scienceshumaines codirigé par R. Campos, N. Donin et F. Keck (n° 14, 2006).Participant : N. Donin.Collaborations extérieures : R. Campos (Conservatoire national supérieur de musique de Paris),F. Keck (GSPM, CNRS), S.-A. Leterrier (université d’Artois), O. Roueff (EHESS-Marseille).1.6.2.5. Médium et reproduction techniques : la sociologie de la musique deMax WeberL’exploration des relations entre musicologie et sciences humaines suppose non seulementd’exhumer les alliances réussies ou manquées (voir 6.1.2.4.) du début du XXe siècle, mais ausside réévaluer la place de la musique au sein des corpus fondateurs des sciences humaines etsociales. Une collaboration entre Philippe Despoix, germaniste et philosophe, et Nicolas Donina permis de pratiquer cet exercice sur la Sociologie de la musique de Max Weber. Bien que cetexte soit une référence connue de la sociologie de l’art, l’esquisse de Max Weber est restéeIRCAM 110RAPPORT D'ACTIVITÉ 2005