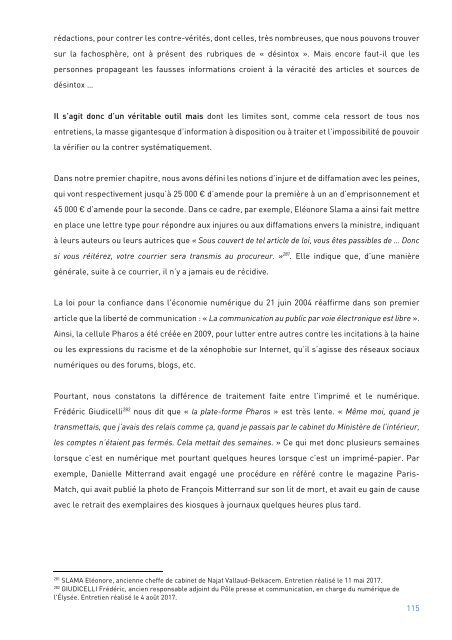MÉMOIRE - Laure Botella
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Facebook et Twitter que nous avons étudiés dans notre recherche, d’effectuer des commentaires<br />
ou de faire des annotations sur des écrits.<br />
Les différences entre le 17 e siècle et aujourd’hui ne portent finalement que sur la rapidité et la<br />
quantité, les deux étant liées mais pas nécessairement.<br />
En effet, quand il ne faut plus aujourd’hui qu’une microseconde à un statut ou à un commentaire<br />
pour circuler entre une multitude d’individus, qui appartiennent à un même réseau social, tout en<br />
habitant à 20 000 kilomètres les uns des autres, il fallait dans la première moitié du 19 e siècle 47<br />
heures par exemple pour qu’un courrier envoyé, par la Poste de Lyon, arrive à Strasbourg 277 . Les<br />
ordres de grandeurs devaient être identiques au 17 e siècles ou auparavant. À cela s’ajoute une<br />
alphabétisation plus grande. Car la diffusion des injures est forcément plus importante dans un pays<br />
où 99 % 278 de la population est alphabétisée, comme c’est le cas aujourd’hui de la France, que dans<br />
un pays où ce même taux était estimé aux alentours de 40 %, comme c’était le cas de la France peu<br />
avant la Révolution française 279 .<br />
Or si les historien·ne·s peuvent connaître des difficultés de vérification des sources liées à<br />
l’ancienneté ou l’absence de documents, aux traductions, ou aux interprétations propres aux<br />
copistes, les difficultés de vérification des sources sont aujourd’hui liées, comme nous l’avons vu<br />
dans notre chapitre 3, à la masse d’informations, à leur rapidité de mise à disposition et pour les<br />
journalistes aux contraintes actuelles, liées à leur profession.<br />
III.<br />
L’arrivée des réseaux sociaux numériques est, à l’inverse, un<br />
véritable outil pour les personnes critiquées, injuriées et/ou<br />
diffamées, leur offrant une opportunité de réponse et de transparence<br />
plus rapide.<br />
Cependant, comme nous l’avons vu dans notre chapitre 5, des ripostes, bien organisées et<br />
préparées, permettent parfois de contrer les désinformations qui peuvent circuler. Par ailleurs,<br />
comme nous le dit Christian Delporte 280 : « Je suis historien, je travaille sur le journalisme depuis le<br />
XIXe siècle, globalement ils font bien mieux leur travail qu’il y a 100 ans… » Ainsi, les journalistes sont<br />
aujourd’hui plus scrupuleux dans leurs recherches d’informations et de sources. Et de nombreuses<br />
277<br />
JOLY Gérard, La poste aux chevaux en 1833, [en ligne], [consulté le 8 septembre 2017]. Disponible sur :<br />
http://www.philatelie-epernay.fr/IMG/pdf/La_Poste_aux_chevaux_en_1833.pdf<br />
278<br />
DAMGÉ Mathilde et JUBLIN Matthieu, Qui sont les illettrés en France ? Le Monde [en ligne], 18 septembre 2014<br />
[consulté le 9 septembre 2017]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/18/qui-sont-lesillettres-en-france_4490014_4355770.html<br />
279<br />
IUFM de Créteil, CNDP, [en ligne], décembre 2005 [consulté le 9 septembre 2017]. Disponible sur :<br />
http://www.cndp.fr/bienlire/01-actualite/c-en-parle24-Imp.htm#A34<br />
280<br />
DELPORTE Christian, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,<br />
Directeur de la revue Le Temps des médias. Entretien réalisé le 8 septembre 2017.<br />
114