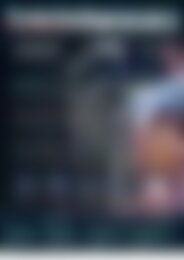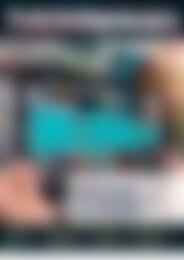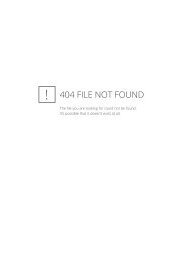Qualité Références n° 76
BPM/GED au service du responsable qualité p.26
BPM/GED au service du responsable qualité p.26
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MANAGEMENT DE PERFORMANCE<br />
LA QUALITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ<br />
la sécurité totale. La qualité totale est, en effet,<br />
un pan de la sécurité totale. Autre recommandation<br />
: il ne sert rien d’avoir raison contre tous.<br />
Enfin, dernier conseil : il faut pouvoir apporter<br />
au décideur des éléments très fiables pour<br />
qu’il puisse prendre sa décision.<br />
Q.R. : Quels outils ou lectures pouvez-vous<br />
indiquer à un professionnel de la qualité ?<br />
E.B. : Je vous recommande mon livre « <strong>Qualité</strong><br />
et sécurité dans les établissements de santé »<br />
publié par les éditions LEH. Je conseille de<br />
consulter des ouvrages provenant d’écoles d’ingénieurs<br />
ou des méthodes qui ont été validées<br />
au niveau international. D’ailleurs, je pense qu’un qualiticien et un<br />
gestionnaire de risque ou un ingénieur doivent plier la méthode<br />
aux exigences du terrain. Mon avis : l’outil et le chiffre sont des<br />
modestes moyens. Il faut plutôt mettre une gouvernance et une<br />
posture stratégique la plus compliante possible au système étudié.<br />
« Le manager doit être humble, voire vulnérable,<br />
et très communicant avec tous les interacteurs<br />
du système et avoir une vision systémique de la<br />
problématique. »<br />
Q.R. : Quelles compétences le manager de la qualité doit-il<br />
acquérir ?<br />
E.B. : Le manager doit être humble, voire vulnérable, et très<br />
communicant avec tous les interacteurs du système et avoir une<br />
vision systémique de la problématique.<br />
Q.R. : Sur quels points le manager de la qualité ne doit-il pas<br />
être vigilant ?<br />
E.B. : Le manager doit être vigilant sur le maintien de son réseau<br />
d’acteurs, de la dynamique et de sa communication locale. Il doit<br />
prioriser le dialogue et la confiance.<br />
Q.R. : Pouvez-vous donner des exemples d’application ? Quelle<br />
était la problématique ? Quels ont été les résultats ?<br />
E.B. : La sécurisation et la qualité de la Prise En Charge Médicamenteuse<br />
(PECM) sont des objectifs prioritaires de l’arrêté du 6<br />
avril 2011. L’article 8 prévoit la réalisation d’une étude des risques<br />
encourus par les patients liés à la PECM. L’objectif du travail<br />
« Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse au sein d’un<br />
service de chirurgie orthopédique : cartographie<br />
des risques selon la méthode d’analyse<br />
des risques à priori » est de réaliser<br />
cette étude au sein du service de chirurgie<br />
orthopédique de l’hôpital Ambroise Paré<br />
AP-HP, à l’aide de l’Analyse Préliminaire<br />
des Risques (APR) afin d’établir un plan<br />
d’actions de réduction des risques.<br />
Concernant la méthode et les matériels, le<br />
groupe de travail pluridisciplinaire était<br />
composé du gestionnaire des risques, d’un<br />
chirurgien orthopédique, d’un médecin<br />
urgentiste délocalisé dans le service de<br />
chirurgie orthopédique, d’un pharmacien<br />
et d’un interne en pharmacie, de<br />
la cadre de santé du service, de deux infirmières diplômées<br />
d’état, et d’une préparatrice en pharmacie. Le système étudié<br />
était « le circuit du médicament » selon les phases suivantes :<br />
prescription, approvisionnement, dispensation, détention et<br />
stockage, transport, information, gestion du traitement personnel,<br />
administration, et surveillance. L’APR a été élaboré en<br />
plusieurs étapes : la cartographie des dangers, la mise en place<br />
des échelles, la cartographie des situations dangereuses (APR<br />
système), l’analyse préliminaire des scénarios (APR scénario),<br />
la cartographie des risques et, l’élaboration d’un plan de réduction<br />
des risques.<br />
388 situations dangereuses (SD) ont été identifiées sur l’ensemble<br />
du système. L’étude s’est limitée à la seule phase de « dispensation<br />
» qui présente le plus grand nombre de SD. 62 SD sont identifiées<br />
dont 51 d’indice de priorité 1. A partir de ces 51 SD, 148<br />
scénarios d’accidents ont été décrits et analysés. 30% des scénarios<br />
présentaient un risque initial de criticité acceptable (C1), 47%<br />
un risque tolérable sous contrôle (C2) et 23% un risque inacceptable<br />
(C3). Un plan d’action de réduction des risques contenant<br />
54 actions de maîtrise des risques initiaux a été proposé. Chacune<br />
de ces actions est cotée en termes de mobilisation des ressources<br />
humaines, financières et matérielles. Les actions de réduction des<br />
risques proposées ont permis de supprimer les scénarios de criticité<br />
C3, tout en augmentant les nombre de scénario de criticité<br />
C1 (47%) et C2 (53%).<br />
Conclusion : L’APR a permis d’évaluer les risques du système<br />
et d’établir des actions prioritaires de réduction des risques. La<br />
révision du système documentaire, la formation, l’information<br />
et la communication au sein des équipes, l’informatisation de<br />
l’ensemble des prescriptions, et la mise en place d’une conciliation<br />
médicamenteuse sont des axes d’amélioration pour l’établissement.<br />
L’automatisation de la dispensation fait partie du<br />
projet de l’établissement mais elle nécessite des moyens financiers<br />
conséquents.<br />
Propos recueillis par Valérie Brenugat<br />
18 IQUALITÉ RÉFÉRENCES • N°<strong>76</strong> • Février-Mars 2018