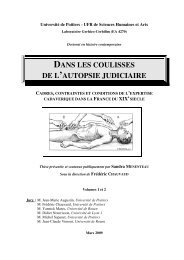Etude et développement d'un actionneur plasma à décharge à ...
Etude et développement d'un actionneur plasma à décharge à ...
Etude et développement d'un actionneur plasma à décharge à ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1. Revue bibliographique sur les <strong>décharge</strong>s <strong>et</strong> les <strong>actionneur</strong>s <strong>plasma</strong>s<br />
L’obj<strong>et</strong> de ce chapitre est d’effectuer une synthèse bibliographique succincte sur les <strong>décharge</strong>s<br />
électriques surfaciques <strong>à</strong> pression atmosphérique. Celui-ci est composé de quatre parties.<br />
Puisque les <strong>décharge</strong>s électriques sont un type de <strong>plasma</strong>s, nous allons dans un premier temps<br />
présenter quelques généralités sur ceux-ci. Puis, nous évoquerons les différents paramètres <strong>et</strong><br />
processus physiques qui interviennent au sein des <strong>plasma</strong>s, perm<strong>et</strong>tant ainsi leur classification. Nous<br />
détaillerons plus amplement les <strong>décharge</strong>s électriques dans les gaz <strong>à</strong> pression atmosphérique. Nous<br />
aborderons, dans un paragraphe spécifique, une propriété induite par ces <strong>décharge</strong>s : le vent électrique,<br />
qui représente le phénomène de base de l’<strong>actionneur</strong> <strong>plasma</strong>. Enfin, nous terminerons par une revue<br />
des différents <strong>actionneur</strong>s <strong>plasma</strong>s surfaciques employés pour le contrôle d’écoulement.<br />
1.1. Notions générales sur les <strong>plasma</strong>s<br />
1.1.1. Définition<br />
Les <strong>plasma</strong>s sont désignés comme étant le quatrième état de la matière faisant suite dans l’échelle<br />
des températures aux trois états classiques : solide, liquide <strong>et</strong> gaz. Le terme de <strong>plasma</strong> (du grec<br />
matière informe) a été introduit pour la première fois en 1923 par les physiciens Américains I.<br />
Langmuir <strong>et</strong> L. Tonks pour désigner, dans les tubes <strong>à</strong> <strong>décharge</strong> certaines régions équipotentielles<br />
contenant un gaz ionisé électriquement neutre.<br />
Dans les conditions usuelles, un milieu gazeux ne perm<strong>et</strong> pas la conduction de l’électricité.<br />
Lorsque ce milieu est soumis <strong>à</strong> un champs électrique faible, un gaz pur est considéré comme un isolant<br />
parfait, car il ne contient aucune particule chargée libre (électron ou ion positif). Les électrons <strong>et</strong> les<br />
ions positifs peuvent survenir si on soum<strong>et</strong> le gaz <strong>à</strong> un champ électrique de forte intensité ou <strong>à</strong><br />
des températures élevées, s’il est soumis <strong>à</strong> un champ électromagnétique très intense ou bien <strong>à</strong> un<br />
bombardement de particules.<br />
Lorsque l’ionisation est suffisante, soit un nombre d’électrons par unité de volume comparable <strong>à</strong><br />
celui des molécules neutres, le gaz devient alors un fluide conducteur qu’on appelle <strong>plasma</strong>. Un<br />
<strong>plasma</strong> est définit comme étant analogue <strong>à</strong> un gaz. Il est constitué de particules chargées, d’ions<br />
<strong>et</strong> d’électrons tel que c<strong>et</strong> ensemble soit globalement électriquement neutre.<br />
Les <strong>plasma</strong>s sont extrêmement répandus dans l’univers puisqu’ils représentent plus de 99% de la<br />
matière connue. On peut donc distinguer les <strong>plasma</strong>s naturels comme les étoiles, les aurores boréales,<br />
les éclairs, l’ionosphère ou encore le vent solaire, des <strong>plasma</strong>s industriels <strong>à</strong> l’instar des torches <strong>à</strong><br />
<strong>plasma</strong> (découpe), des écrans de téléviseurs, <strong>et</strong> dans le domaine spatiale avec la propulsion par <strong>plasma</strong><br />
(moteur ionique [2]) par exemple.<br />
1.1.2. Les processus physico-chimiques internes<br />
Un <strong>plasma</strong> est le siège de processus réactifs entre particules qui le composent. Soumis <strong>à</strong> un champ<br />
électrique, par conséquent <strong>à</strong> la force de Coulomb, les particules chargées vont entrer en collision avec<br />
les molécules environnantes. On distingue alors les collisions élastiques des collisions inélastiques.<br />
Dans les chocs élastiques, les atomes conservent la même structure interne. Ceux-ci n'échangent<br />
pas d'énergie entre eux ni même avec le milieu extérieur, seuls leurs vecteurs vitesse respectifs<br />
changent en direction <strong>et</strong> en norme. Globalement, l'énergie cinétique du système reste inchangée.<br />
A contrario, dans les chocs inélastiques, l’énergie interne des particules change. L’énergie de<br />
la particule incidente, dans ce cas, est suffisante pour que la particule heurtée passe <strong>à</strong> un niveau excité<br />
- 11 -