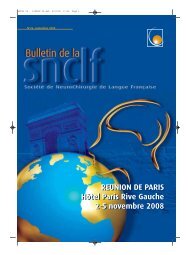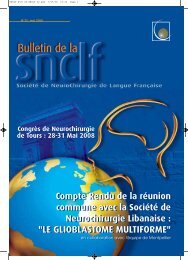Bulletin Janvier 2012 - snclf
Bulletin Janvier 2012 - snclf
Bulletin Janvier 2012 - snclf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
54<br />
<strong>Bulletin</strong> de la Société de Neurochirurgie de Langue Française<br />
Conclusion<br />
Alors que l’hydrocéphalie dans les tumeurs de la lame<br />
tectale est secondaire à une compression extrinsèque de<br />
l’aqueduc, l’efficacité à long terme de la ventriculocisternostomie<br />
est nettement inférieure dans ces formes à celle<br />
retrouvée dans les sténoses intrinsèques. Un suivi prolongé<br />
clinique et radiologique de ces malades est donc indispensable.<br />
A19<br />
Les Kystes Arachnoïdiens Intracraniens : A propos de 17<br />
cas.<br />
Afaf Kenaan, M.Boulfaiz, M.Rghioui, M.Manfalouti, A. Chellaoui,<br />
K.Ibahiouin, S. Hilmani, A.Lakhdar, A. Naja, A. Bertal ,<br />
A.Elazhari.<br />
Service de Neurochirurgie- CHU Ibn Rochd Casablanca.<br />
Introduction<br />
Les kystes arachnoïdiens sont des collections bénignes de<br />
LCR limités par une paroi développée aux dépens des cellules<br />
arachnoïdiennes. Leur étiopathogénie reste controversée..<br />
Ils sont dans la majorité des cas congénitaux mais<br />
peuvent être acquis. Ces kystes posent souvent des problèmes<br />
de diagnostic différentiel avec d’autres lésions.<br />
L’indication chirurgicale est réservée aux kystes symptomatiques,<br />
néanmoins le choix de la meilleure procédure est<br />
toujours sujet à discussion.<br />
Matériel - Méthode<br />
Le présent travail est une étude rétrospective de 17 cas de<br />
kyste arachnoïdiens intracrâniens, colligées au service de<br />
neurochirurgie du CHU IBN ROCHD de Casablanca sur une<br />
période de 10 ans allant de 2000 à 2010.<br />
Résultats ou Cas rapporté<br />
La fréquence était de 0.83% des processus intracrâniens.<br />
L’âge moyen de patients était de 17 ans. Une légère prédominance<br />
féminine a été notée de l’ordre de 53%. Le tableau<br />
clinique a été dominé par le syndrome d’HTIC dans 56.25%<br />
des cas, les crises convulsives chez 43.75% des malades et le<br />
retard psychomoteur dans 25% des cas. Tous nos patients<br />
ont bénéficié d’une TDM cérébrale et 68.75% d’une IRM<br />
cérébrale. Le traitement était chirurgical dans 15 cas. Les<br />
suites postopératoires immédiates ont été simples chez 14<br />
malades, un seul patient a été réopéré. L’évolution à long<br />
terme était bonne dans 50% des cas. Un seul patient a présenté<br />
une persistance des crises convulsives, 2 malades ont<br />
été réopéré pour récidive<br />
Conclusion<br />
Les kystes arachnoïdiens restent parmi les processus intracrâniens<br />
les moins fréquents. L’indication d’un traitement<br />
chirurgical est réservée aux kystes symptomatiques, néanmoins<br />
le choix de la meilleure procédure est toujours sujet<br />
à discussion.<br />
A20<br />
Une myélopathie par neurobilhraziose, une exception ?<br />
Alexis Perez, Stéphane Derrey, Claire Chapuzet, Guillaume<br />
Perrod, Fahad Hammad, Pierre Freger, François Proust.<br />
CHU Rouen.<br />
Introduction<br />
De tropisme classiquement uro-digestif, la bilharziose intéresse<br />
exceptionnellement le système nerveux central. Nous<br />
rapportons l’observation d’un patient atteint d’une myélopathie<br />
secondaire à une neuro-bilharziose.<br />
Résultats ou Cas rapporté<br />
Nous présentons le cas d’un homme de 58 ans, congolais,<br />
vivant en France depuis 25 ans, ayant effectué un voyage au<br />
Congo deux ans auparavant. Cet homme présentait une tétraparésie<br />
progressive prédominant au membre supérieur,<br />
douloureuse, nécessitant la prise d’antalgique de classe III,<br />
associée à des troubles vésico-sphinctériens. A l’examen<br />
clinique, un syndrome tétra-pyramidal et une altération<br />
cordonale postérieure étaient objectivés. Une IRM vertébro-médullaire<br />
cervicale montraient une méningo-myélite<br />
de niveau métamérique C4 associé à une cervicarthrose. La<br />
sérologie bilharziose revint positive dans le sang et le LCR. Il<br />
fut traité par fortes doses de PRAZIQUANTEL associé à une<br />
corticothérapie IV. L’évolution se caractérisait par une stabilisation<br />
clinique et la régression de l’imagerie à 12 mois.<br />
Conclusion<br />
En zone d’endémie, l’existence d’une myélite et une imagerie<br />
caractéristique en IRM permet d’évoquer le diagnostic.<br />
A21<br />
Topogramme pour le Repérage du Nerf Grand Occipital<br />
(NGO) dans les Abords Occipitaux et/ou Cervicaux Postérieurs.<br />
E Simon, S. Artignan, M. Sindou, P. Mertens.<br />
Service de Neurochirurgie A, Hôpital Neurologique P. WERTHEI-<br />
MER, Hospices Civils de Lyon Département Universitaire d’Anatomie<br />
Rockefeller, Université Claude Bernard Lyon.<br />
Introduction<br />
Les abords de la fosse postérieure du crâne, de l’angle pontocérébelleux,<br />
ainsi que du rachis cervical exposent à des<br />
troubles sensitifs et des douleurs séquellaires, par lésion du<br />
Nerf-Grand-Occipital (NGO). La connaissance de ses repères<br />
est le meilleur garant d’une épargne du nerf. D’une étude<br />
sur 23 cadavres (thèse de S.A.) les auteurs présentent un<br />
topogramme des repères du NGO, applicable à la pratique<br />
chirurgicale.<br />
Matériel - Méthode<br />
L’étude a porté sur le trajet du NGO, depuis son émergence<br />
latéralement au ligament atloïdo-axoïdien postérieur (RE-<br />
PERE-A), jusqu’à son passage à la ligne nuchale supérieure,<br />
départ des branches sensitives pour le scalp. Sa première<br />
portion, passant en arrière de la capsule articulaire C1-C2, le<br />
mise_en_page.indd 54 07/02/<strong>2012</strong> 10:51:34