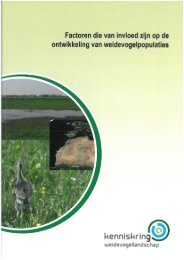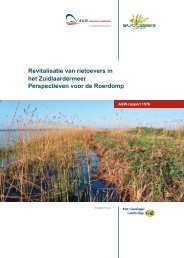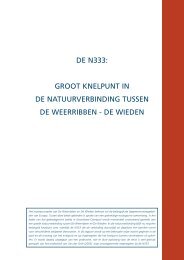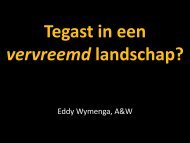Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
190 Restauration à base communautaire des forêts inondées<br />
1 Fondement historique<br />
Pour comprendre l’évolution dans la gestion des<br />
ressources naturelles dans le <strong>Delta</strong> Intérieur du Niger,<br />
nous devons tenir compte de son histoire. L’évolution<br />
historique dans le <strong>Delta</strong> a été résumée par Gallais<br />
(1967) et les implications de cette évolution dans la<br />
gestion des ressources naturelles du <strong>Delta</strong> a été analysée<br />
par Moorehead (1991). Les premiers habitants<br />
du <strong>Delta</strong> sont les Bozos qui étaient pêcheurs et les<br />
Nonos (aussi appelé Norons) qui cultivaient le riz et<br />
faisaient aussi la pêche. <strong>Du</strong>rant plusieurs siècles, ils<br />
prenaient le <strong>Delta</strong> pour eux-mêmes. Ils utilisaient<br />
plusieurs techniques de pêche, des pièges de toute<br />
sorte, des harpons et des barrages. Les pêcheries<br />
étaient gérées de façon patrilinéaire, supposée être le<br />
fondement de la communauté et s’appropriaient<br />
ainsi les ressources naturelles. Le plus vieux membre<br />
de ce patriarcat accomplissait la fonction de maître<br />
d’eau et allouait les droits de pêche. A l’époque de<br />
l’Empire du Mali (1250 – 1450) deux nouveaux<br />
groupes ethniques furent créés: les Markas (une<br />
communauté marchande) et les Somonos (les marins<br />
de l’empire).<br />
Toutes ces deux ethnies sont dérivées des populations<br />
locales de Bozo et de Nono. D’autres groupes<br />
ethniques capturés lors des guerres étaient aussi<br />
inclus parmi les Somonos. Il était donné à ces derniers<br />
le droit à l’eau et aussi leur désignation de<br />
‘Maîtres d’eau’ pour gérer les pêcheries généralement<br />
le long des cours d’eau. L’empire Sonrhaï<br />
(1450 – 1590) a vraisemblablement changé un peu<br />
le chemin sur lequel les ressources naturelles étaient<br />
exploitées.<br />
Les changements majeurs ont eu lieu aux 17 ème et<br />
18 ème siècle avec les immigrations importantes de<br />
Bambaras et Peuls sont arrivées. Les Bambaras se sont<br />
installés sur les terres sèches pour cultiver le mil. Ils<br />
n’avaient pas assez d’influence sur la gestion des<br />
habitats des zones humides mais ont sans doute augmenté<br />
les pressions sur les types de forêts sèches.<br />
D’autre part, l’augmentation de la population des<br />
Peuls fut d’une grande importance dans la zone.<br />
Depuis le 13 ème siècle déjà, ils avaient accédé à la<br />
zone à partir de l’Ouest avec leurs troupeaux et au<br />
17 ème siècle devenaient de plus en plus dominants.<br />
Ils ont tout d’abord colonisé les zones autour du<br />
<strong>fleuve</strong> Diaka qui fut connu comme le Royaume du<br />
Macina. Les villages locaux étaient souvent détruits et<br />
les habitants expulsés. Les Peuls ont créé un groupe<br />
ethnique et d’esclaves qui sont les Rimaïbés, provenant<br />
des populations locales des différents groupes<br />
ethniques. Les Rimaïbés étaient installés dans le <strong>Delta</strong><br />
pour cultiver les céréales destinées aux Peuls pour<br />
leur permettre de répartir leur temps à se mouvoir<br />
avec leurs troupeaux.<br />
Au 19 ème siècle, sous le système de la Dina, les Peuls<br />
avaient le contrôle total sur le <strong>Delta</strong>. Bien que beaucoup<br />
d’habitants furent expulsés de la zone et beaucoup<br />
de villages détruits, les dirigeants Peuls ont<br />
laissé au niveau local la gestion des eaux et des terres<br />
aux populations restantes et ont également laissé la<br />
gestion des pêcheries aux anciens maîtres d’eau. Un<br />
intéressant système alternatif de gestion s’est développé<br />
dans la même région, où le maître d’eau (Bozo<br />
ou Somono) règle le droit de pêche pendant la crue<br />
et le Dioro règle les droits de pâturage pendant la<br />
décrue. Dans la répartition des droits de pêche, la<br />
priorité est donnée aux communautés des pêcheurs<br />
résidents sur les groupes de pêcheurs nomades qui<br />
suivent le régime de la décrue à travers le <strong>Delta</strong>. De<br />
façon similaire, pour la répartition des droits de<br />
pâturage et la coupe de bourgou, la priorité est donnée<br />
aux pasteurs locaux sur les groupes transhumants.<br />
Il a été établi pour les Peuls transhumants et<br />
leurs troupeaux un très bon système de traversée<br />
dans lequel la date et le lieu sont fixés.<br />
Dans ce système traditionnel de gestion, les forêts<br />
inondées sont restées intactes sans mesure spéciale de<br />
protection par ce qu’elles étaient reconnues comme<br />
utiles pour chacun. Pendant l’administration coloniale<br />
(1893 – 1960) ces systèmes de gestion furent<br />
longtemps laissés intacts bien qu’un réseau de services<br />
techniques gouvernementaux fût superposé<br />
aux structures locales de gestion. Après l’indépendance<br />
(1960), un gouvernement socialiste a vu le<br />
jour et a classé l’ancien système de gestion des<br />
Maîtres d’eau et des Dioros comme féodal et injuste.<br />
Le gouvernement donna la responsabilité de l’eau et<br />
les problèmes de gestion des terres au service technique<br />
des eaux et forêts. En pratique, cela signifie que<br />
deux systèmes de gestion incompatibles continuent à<br />
exister simultanément. On assiste à un regain de tensions<br />
entre les communautés locales qui pour la<br />
plupart ont adhéré au système traditionnel et les<br />
nomades qui trouvent de meilleures opportunités<br />
dans le nouveau système gouvernemental. Dans certains<br />
cas, ceci aboutit à des conflits sociaux ou les<br />
gens sont blessés et tués. En plus de ces problèmes,<br />
les agents des services techniques souffrent souvent<br />
des retards de salaire et sont ainsi contraints de trouver<br />
une source de revenu supplémentaire à travers<br />
l’imposition d’amendes sur les populations violant<br />
les règles de gestion ou en recevant des payements<br />
informels. Les réactions répressives des services techniques<br />
ont plutôt rendu impopulaire leur action. Ces<br />
développements ont endommagé l’équilibre dans la<br />
gestion des terres et de l’eau et ont abouti à une perte<br />
générale du sens de la responsabilité parmi les communautés<br />
locales. En combinaison avec le besoin<br />
d’extension de la culture du riz dans les eaux profondes<br />
durant la sécheresse des années 1970 et 1980,<br />
il a résulté une destruction presque totale des forêts<br />
inondées (voir figure 7.1).<br />
Avec le régime démocratique, la décentralisation du<br />
pouvoir est une issu importante; de même que les<br />
services techniques présentement aussi responsables<br />
de la conservation de la nature sont en train d’améliorer<br />
leur image. Ces changements offrent de<br />
Histoire du succès de Akkagoun et Dentaka 191<br />
grandes opportunités pour restaurer les ressources<br />
naturelles au niveau villageois à travers une gestion<br />
responsable.<br />
2 Histoire du succès de<br />
Akkagoun et Dentaka<br />
<strong>Du</strong>rant la période 1985 – 1988, l’UICN a exécuté un<br />
projet dénommé ‘Conservation de l’Environnement<br />
dans le <strong>Delta</strong> Intérieur du <strong>fleuve</strong> Niger’ qui était une<br />
combinaison de deux projets initialement distincts<br />
(IUCN 1989). Le premier projet financé par le gouvernement<br />
allemand était concentré sur l’éducation<br />
et l’exploitation des ressources naturelles par les<br />
hommes. Le second projet financé par WWF<br />
International visait l’identification des zones à protéger<br />
et à la préparation des plans de gestion de ces<br />
zones. Le projet était basé à Youvarou.<br />
Le projet a identifié trois sites potentiels qui ont été<br />
plus tard érigés par le gouvernement malien en Sites<br />
Ramsar. En plus, le projet a identifié les forêts inondées<br />
d’Acacia kirkii comme site d’importance à protéger<br />
du fait de son rôle d’espèce clé dans l’écosystème<br />
des plaines d’inondation du <strong>Delta</strong> et du fait que ces<br />
forêts abritent de larges colonies mixtes d’oiseaux<br />
d’eau nicheurs avec une valeur de conservation<br />
extrêmement élevée (Skinner et al. 1987, chapitre 7).<br />
Il était reconnu que ces forêts avaient déjà été sévèrement<br />
dégradées et dans beaucoup de cas perdu leurs<br />
colonies d’oiseaux d’eau. Trois sites prioritaires où<br />
l’UICN voulait concentrer ses efforts furent identifiés<br />
:<br />
• Bouna<br />
• Dentaka<br />
• Akkagoun