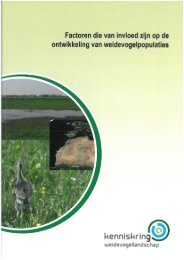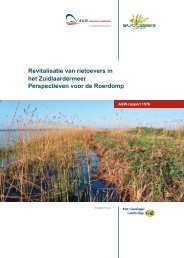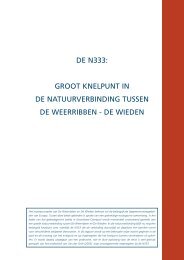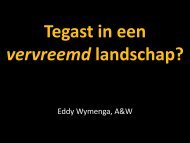Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
174 Colonies nicheuses d’oiseaux d’eau<br />
Héron pourpré - Ardea purpurea<br />
Skinner et al. (1987) ne l’ont pas signalé en nichant,<br />
mais Lamarche (1981) fait mention de ‘construction<br />
de nids de décembre à février’ dans Lac Aougoundou.<br />
<strong>Du</strong>rant 1998 – 2001 nous n’avons pu établir sa nidification,<br />
mais en février-mars 1995 deux nids avec<br />
des poussins ont été découverts dans la forêt de<br />
Dentaka; la distance entre les nids était de 10-15 m.<br />
En décembre/janvier 1996 quelques centaines de<br />
pourprés étaient présents, en pleine journée, dans la<br />
forêt sans que nous ayons pu trouver des traces de<br />
reproduction. Comme chez le Héron cendré il s’agit<br />
ici d’une reproduction incidentelle, sans pour autant<br />
exclure d’autres cas de nidification ailleurs dans le<br />
DIN, notamment là où se situent des typhaies (Horo,<br />
Fati, Aougoundou, et par ailleurs: les Falas du <strong>Delta</strong><br />
Mort). Lors du survol de juin 2000 plusieurs nids<br />
blanchis (fiente) étaient remarqués au centre du Lac<br />
Horo indiquant un noyau où les pourprés (ou autre<br />
espèce de héron) pourraient se reproduire en sécurité.<br />
Anhinga d’Afrique - Anhinga rufa<br />
L’Anhinga d’Afrique était commun (Lamarche<br />
1981) jusqu’au début des années 1980 mais depuis<br />
lors la population s’est effondrée en peu de temps,<br />
allant de milliers d’oiseaux (basé sur des sources<br />
dignes de foi) à un petit effectif nicheur de 40-45<br />
couples en 1986/87 et de 15-30 couples en<br />
1994/95. Dans les années 1980 les anhingas nichaient<br />
encore à Koumbé Niasso, près de Bouna et dans<br />
le complexe Debo, mais en 1995 leur reproduction<br />
se limitait aux Debos (1-2 localités) où les oiseaux<br />
ont failli disparaître totalement à la fin du millénium.<br />
L’espèce figure néanmoins parmi celles en voie de<br />
rétablissement depuis que les crues se sont améliorées<br />
(1994). En comptant, durant le mois de<br />
février, leurs sorties matinales à partir de la forêt de<br />
Dentaka dans le même secteur, nous avons pu établir<br />
une augmentation annuelle de leur effectif postnuptial<br />
(figure 5.7). Cependant les anhingas restent<br />
très vulnérables du fait qu’ils n’ont qu’un seul site de<br />
reproduction dans le DIN, et que la chaire des pous-<br />
sins est très apprécié; des juvéniles captifs sont régulièrement<br />
signalés lors des recensements mensuels.<br />
Ibis sacré - Threskiornis aethiopica<br />
Egalement en augmentation, l’effectif d’Ibis sacrés se<br />
déduit notamment des recensements post-nuptiaux.<br />
Comme les espèces suivantes elle niche dans le <strong>Delta</strong><br />
en saison sèche, pendant la décrue (décembremars);<br />
Lamarche (1981) donne, pour le Mali, la<br />
période juillet-février en incluant ainsi la saison des<br />
pluies sahélienne. Leur nidification a été établie dans<br />
la forêt de Dentaka, en étant toutefois remarqué que,<br />
pareil à la Spatule d’Afrique (voir ci-après), le nombre<br />
de nids trouvés a toujours été en dessous du<br />
nombre de couples nicheurs déduit des effectifs<br />
post-nuptiaux en avril-juin, mais en aucune occasion<br />
on a effectué un inventaire intégral à cause des<br />
dérangements impliqués. Il est plausible qu’un mouvement<br />
saisonnier d’oiseaux plus équatoriaux (voir<br />
Lamarche 1981, Brown et al. 1982) ou extra-deltaïques<br />
vienne augmenter l’effectif nicheur présent<br />
dans le DIN (Debo), en rendant son estimation assez<br />
grossière (figure 5.9).<br />
Ibis falcinelle - Plegadis falcinellus<br />
La nidification de l’Ibis falcinelle en Afrique est rapportée<br />
surtout pour l’Est et le Sud du continent<br />
(Brown et al. 1982). Le DIN au Mali est le seul lieu en<br />
Afrique de l’øuest où l’espèce a été trouvé comme<br />
oiseau nicheur (Morel & Morel 1961, Lamarche<br />
1981). La sécheresse depuis le début des années<br />
1970 semble avoir mis fin à son statut d’oiseau<br />
nicheur. Skinner et al. (1987) ne l’ont plus retrouvé<br />
en tant que tel, mais van der Kamp (1995) établissait<br />
un effectif de quelque 150 couples nichant dans la<br />
forêt de Dentaka, en février-mars 1995; ce constat a<br />
été le seul documenté depuis la fin des années 1970.<br />
<strong>Du</strong>rant 1996-2001 il n’y a pas eu de nouvelles preuves<br />
de nidification, et la question à propos d’une<br />
réelle population afrotropicale en Afrique de l’Ouest<br />
devrait être posée.<br />
Spatule d’Afrique - Platalea alba<br />
Peu commune, avec des rassemblements parfois jusqu’à<br />
200 oiseaux -Lac Horo- d’après Lamarche<br />
(1981). Dans les années 1980 relativement commune.<br />
Skinner et al. (1987) estimaient le nombre de<br />
couples nicheurs pour le DIN à 300-350, mais en<br />
1995 l’effectif était réduit à 50 couples environ.<br />
<strong>Du</strong>rant 1999-2001 la Spatule d’Afrique a connu des<br />
effectifs croissants après la saison de reproduction<br />
(fig. 5.10), mais afin d’établir l’effectif d’oiseaux<br />
nicheurs il faudrait éliminer les (jeunes) oiseaux<br />
rejoignant les nicheurs locaux; des juvéniles ont été<br />
retrouvé à plusieurs centaines de km de leur lieu de<br />
naissance (Brown et al. 1982). Cela poserait le même<br />
problème que chez les Ibis sacrés, et l’estimation du<br />
nombre de couples nicheurs (100-150) se base donc<br />
prudemment sur les effectifs maximaux vus en<br />
février-mars. Après mars il pourrait y avoir un influx<br />
d’autres oiseaux.<br />
Bec-ouvert africain - Anastomus lamelligerus<br />
Skinner et al. (1987) estimaient le total de couples<br />
nicheurs dans le DIN à 30-40, mais l’espèce est classée<br />
comme rare par Lamarche (1981) qui ne fait pas<br />
mention de sa nidification au Mali. Il est donc possible<br />
que la sécheresse sahélienne depuis 1972 ait<br />
mené à la reproduction des Bec-ouverts africains<br />
dans le DIN. L’espèce nichait en effet dans la forêt<br />
d’Akkagoun vers 1975 (comm. pers. S. Konta).<br />
Toutefois sa nidification semble avoir été temporaire<br />
puisque déjà dans les années 1990 l’espèce n’était<br />
que rarement signalée, sans preuve de reproduction.<br />
Les seules observations durant 1998-2001 ont été 2<br />
oiseaux dans la Plaine de Séri (comptage aérien, mars<br />
1999) et 2-4 dans la plaine autour de Walado Debo<br />
(avril 1999).<br />
Autres espèces dans le <strong>Delta</strong> Intérieur<br />
nicheurs isolés (habitats marécageux, grands arbres)<br />
Le tableau 7.2 comprend 17 espèces et ne prend pas<br />
en compte les nicheurs solitaires: le Héron goliath<br />
Ardea goliath, le Blongios nain Ixobrychus minutus, le<br />
Effectifs reproducteurs d’oiseaux d’eau nichant en colonies 175<br />
Héron à dos vert Butorides striatus, le Jabiru d’Afrique<br />
Ephippiorhynchus senegalensis et l’Ombrette africaine Scopus<br />
umbretta. Les trois derniers sont très rarement (Jabiru,<br />
Ombrette) ou régulièrement (Héron à dos vert)<br />
observés, tandis que le Héron goliath et le Blongios<br />
nain ne semblent plus exister dans le <strong>Delta</strong>: aucun<br />
constat depuis la fin des années 1980 (voir Lamarche<br />
1981). Cependant, la sous-espèce afrotropicale du<br />
Blongios nain, I. m. payesi, a été observée le long du<br />
<strong>fleuve</strong> Niger à Bamako durant la saison des pluies<br />
(premiers constats en avril; J. van der Kamp) et<br />
récemment aussi dans les falas du <strong>Delta</strong> Mort (juillet<br />
2002).<br />
autres nicheurs en colonies<br />
Un inventaire du bassin du <strong>fleuve</strong> Niger est supposé<br />
révéler si d’autres espèces, aujourd’hui peu communes<br />
ou même rares (tableau 5.5), telles que la<br />
Sterne hansel Gelochelidon nilotica, la Mouette à tête<br />
grise Larus cirrocephalus et le Bec-en-ciseau d’Afrique<br />
nichent au Mali. Lamarche (1981) fait mention de la<br />
reproduction de la Mouette à tête grise (‘au dire de<br />
pêcheurs’) et du Bec-en-ciseau (‘bancs de sable du<br />
Niger, du nord au sud’), mais en 1998-2001 cela<br />
n’a pu être confirmé. La Mouette à tête grise est<br />
observée chaque année (Debo) en très petit nombre,<br />
et la seule indication de reproduction a été son comportement<br />
nuptial au début 1995 (forte crue après<br />
la grande sécheresse) lorsque l’espèce était relativement<br />
commune. Le Bec-en ciseau d’Afrique est<br />
aujourd’hui très rare et sa reproduction actuelle<br />
nous semble douteuse. Ledit inventaire du Niger<br />
pourrait donner la réponse définitive à propos du<br />
statut reproducteur de cette espèce. Cela vaut également<br />
pour la Sterne hansel, dont la nidification n’a<br />
jamais été établie au Mali, sans l’exclure toutefois<br />
dans les années à venir.<br />
Les espèces nichant en colonies dont la reproduction<br />
a été constatée dans d’autres habitats du DIN sont la<br />
Guifette moustac Chlidonias hybridus, la Sterne naine<br />
Sterna albifrons ssp. guineae et l’Echasse blanche Himantopus<br />
himantopus.