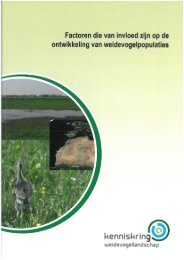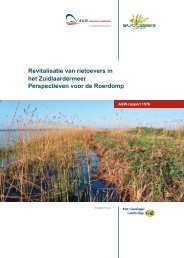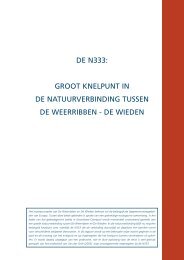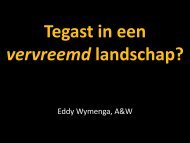Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
180 Colonies nicheuses d’oiseaux d’eau<br />
4 Synthèse<br />
estimation des populations<br />
Les effectifs des populations nicheuses ont été évalués<br />
à travers différentes approches d’estimation. En<br />
1985-87 les résultats des recensements durant la<br />
saison de reproduction ont été utilisés, tandis qu’en<br />
1999-2002 les recensements en fin de saison de<br />
reproduction ont servi à établir les nombres de<br />
couples nicheurs. En 1994-95 les deux approches<br />
ont été utilisées: comptage des dortoirs après la<br />
saison de reproduction et des recensements mensuels<br />
pour les cormorans, les anhingas et les Ardeidae,<br />
et - additionnellement - comptage de nids pour les<br />
nicheurs de saison sèche, comme les ibis et les spatules.<br />
Les comptages aériens ainsi que les constats et observations<br />
dans les colonies ont été complémentaires<br />
sans pour autant oublier leur grand intérêt au sujet<br />
des espèces à reproduction irrégulière telles que le<br />
Héron cendré, le Héron pourpré et l’Ibis falcinelle.<br />
<strong>Du</strong>rant la période du projet (1998-2002) nous<br />
avons à peine trouvé de l’évidence pour la reproduction<br />
de ces espèces (seulement pour le Héron cendré,<br />
voir p. 173), et non plus pour le Bec-ouvert<br />
africain. Considérant le caractère incidentel de leur<br />
reproduction la question devrait être posée au sujet<br />
de l’origine et le comportement opportuniste de ces<br />
nicheurs, incluant des sujets en matière de l’extension<br />
des aires de reproduction et le flux génétique y afférent.<br />
evolution des effectifs nicheurs<br />
Tableau 7.2 montre une image divergente. La seule<br />
espèce en augmentation parmi les Ardeidae est<br />
l’Aigrette intermédiaire; cela semble confirmer<br />
l’expansion de son aire de dispersion depuis les dernières<br />
décennies (Brown et al. 1982). Les autres<br />
espèces ayant des populations croissantes ne font pas<br />
partie des hérons: le Cormoran africain, l’Anhinga<br />
d’Afrique, l’Ibis sacré et la Spatule d’Afrique. Elles<br />
ont pu profiter des crues améliorées depuis 1994,<br />
qui ont favorisé leur situation alimentaire (i.e.<br />
Cormoran africain), ou prolongé les périodes<br />
d’inondation - sécurité ! - pour les espèces nichant<br />
tardivement (Ibis sacré, Spatule d’Afrique). L’Aigrette<br />
garzette (blanche) et le Crabier chevelu sont les seuls<br />
stables, mais il s’agit ici d’espèces avec des populations<br />
afrotropicales et paléarctiques rendant les estimations<br />
assez grossières.<br />
Le Héron garde-boeuf est le nicheur le plus commun,<br />
dont l’effectif s’avère à la baisse. La population<br />
actuelle des deux colonies restantes (Debo) reflèterait<br />
peut-être une situation initiale de surpeuplement,<br />
menant à une reproduction insuffisante (cf.<br />
Skinner et al. 1987). Cependant la baisse établie pourrait<br />
également être comprise dans les fluctuations<br />
naturelles liées à la dynamique de l’hydrosystème du<br />
DIN; le suivi dans les années à venir devra le mettre<br />
en évidence. La Grande Aigrette a subi une forte<br />
décroissance de son effectif nicheur en étant au plus<br />
bas à la fin des années de sécheresse. Depuis lors<br />
l’évolution de son effectif a été positive sans pour<br />
autant atteindre le niveau des années 1980. Les<br />
Hérons noirs ne s’avèrent pas capables de se rétablir<br />
depuis les crues améliorées. Leur population continue<br />
à baisser.<br />
Les nicheurs irréguliers sont des espèces ayant des<br />
gros effectifs d’oiseaux paléarctiques et on peut se<br />
poser la question quant à l’origine des oiseaux<br />
nicheurs. Le Bihoreau gris est le nicheur le plus commun<br />
parmi les ‘irréguliers’, et pourrait avoir une<br />
population afrotropicale. La nidification du Héron<br />
cendré, du Héron pourpré et de l’Ibis falcinelle fait<br />
toutefois penser à des oiseaux paléarctiques ‘détachés’<br />
temporairement ou incidentellement en Afrique subsaharienne;<br />
leurs populations semblent peu (ou pas)<br />
viables en étant négligeables comparés avec le contingent<br />
présent de migrateurs paléarctiques.<br />
Les colonies actuelles: dentaka et akkagoun<br />
Depuis les années 1990 la forêt de Dentaka a fonctionné<br />
comme lieu de reproduction pour toutes les<br />
espèces figurant dans le tableau 7.2 en étant remarqué<br />
que cela est douteux pour le Bec-ouvert africain.<br />
Concernant la forêt d’Akkagoun l’image est moins<br />
claire, du fait qu’elle a été moins surveillée que<br />
Dentaka. Skinner et al. (1987) donnent le Cormoran<br />
africain et six espèces d’Ardeidae comme nicheurs et la<br />
reproduction a été noté, en 1999 et 2002, pour<br />
l’Aigrette garzette noire (voir p. 172) et le Crabier<br />
chevelu.<br />
Actuellement il semble être question d’un manque<br />
de sécurité à akkagoun, suite au pillage de la colonie<br />
de Hérons garde-boeufs en 1998, au dire de la population<br />
locale. Depuis cet incident toutes les autres<br />
espèces nicheuses ont renoncé à se reproduire dans<br />
la forêt, jusqu’à la crue de 1999 lorsque les gardeboeufs<br />
se sont réinstallés (cf. photo page 165).<br />
Toutefois, durant la saison de nidification en 2000<br />
leur colonie fut abandonnée de nouveau pour être<br />
rétablie ailleurs dans la forêt, dans un endroit où<br />
l’espèce était également présente en 2001. Par contre,<br />
jusqu’à présent (crue 2000-2002) les cormorans ne<br />
sont pas revenus pour nicher, et les autres espèces, en<br />
tant que signalées, semblent nicher en nombres négligeables<br />
comparés à ceux de Dentaka. Une surveillance<br />
pertinente de la forêt depuis le début (juin) du<br />
cycle de reproduction des garde-boeufs doit avoir<br />
haute priorité pour la sauvegarde de la colonie mixte<br />
de cormorans, hérons, aigrettes, et potentiellement<br />
anhingas, spatules et ibis; la réussite reproductive des<br />
garde-boeufs est à la base de l’installation ultérieure<br />
des autres espèces. Vers la fin de la saison de reproduction<br />
la forêt d’Akkagoun sert de plus en plus de<br />
dortoir aux cormorans, hérons et aigrettes provenant<br />
de la forêt de Dentaka, et d’autres zones en amont du<br />
complexe Debo. Aussi un constat de nidification à<br />
Akkagoun dans ce stade, à base de la présence de<br />
juvéniles au vol, est prématuré en demandant de plus<br />
amples preuves.<br />
Synthèse 181<br />
Forêt de Dentaka, site de reproduction et dortoir, en voie de tarissement.<br />
Février 2001.<br />
En résumant, les conditions de reproduction dans le<br />
DIN sont précaires. Il n’y existe actuellement que<br />
deux forêts inondables avec des colonies substantielles<br />
d’oiseaux d’eau. Une de ces forêts - Akkagoun -<br />
est sous forte pression anthropique, tandis qu’elle n’a<br />
pas seulement une grande potentialité socio-économique<br />
(poisson, fourrage, bois, etc.) mais aussi en<br />
termes de biodiversité (UICN 1999, 2001). Pour la<br />
forêt de Dentaka ces potentialités ont déjà été mises<br />
en évidence en rendant la restauration et la gestion<br />
des autres forêts dégradées ou (quasi-)disparues un<br />
grand défi dans les années à venir (voir chapitre 8).