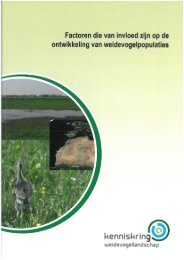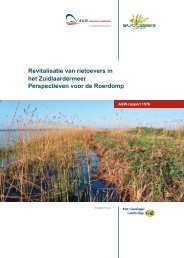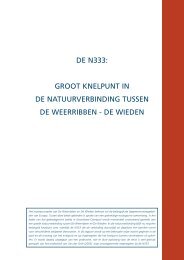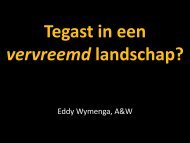Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
164 Colonies nicheuses d’oiseaux d’eau<br />
1 Colonies nicheuses<br />
dans le <strong>Delta</strong><br />
Actuellement les forêts inondables du <strong>Delta</strong> Intérieur<br />
constituent les principaux sites de colonies nicheuses<br />
pour l’ensemble des hérons, aigrettes, cormorans,<br />
anhingas, spatules et ibis. En outre la reproduction<br />
sur Acacia sp. du Pélican gris Pelecanus rufescens et du Becouvert<br />
africain Anastomus lamelligerus a été constatée<br />
dans le passé récent (Lamarche 1981, Skinner et al.<br />
1987). Les autres habitats de reproduction ont été<br />
inspectés assez globalement durant 1998-2001, lors<br />
des actions de suivi mensuel, aérien et incidentel, en<br />
laissant peu d’espoir -outre les espèces solitaires<br />
comme le Héron goliath Ardea goliath et le Jabiru<br />
d’Afrique Ephippiorhynchus senegalensis - pour le Pélican<br />
blanc Pelecanus onocrotalus, la Mouette à tête grise Larus<br />
cirrocephalus, la Guifette moustac Chlidonias hybridus, la<br />
Sterne naine Sterna albifrons et le Bec-en-ciseaux<br />
d’Afrique Rhynchops flavirostris. La Guifette moustac et la<br />
Sterne naine sont les seules espèces dont la reproduction<br />
a été constatée récemment mais elles se voient<br />
confrontées au genre de dérangement qui a également<br />
contribué à la disparition des autres: prélèvement<br />
de poussins, piétinement par les passants et le<br />
bétail. Des actions d’inventaire, et de sensibilisation et<br />
conservation joueront un rôle capital dans la sauvegarde<br />
des (groupes d’) espèces mentionnées et en<br />
faveur de la biodiversité dans les habitats cités cidessus.<br />
Comme indiqué au chapitre 5 le <strong>Delta</strong> Intérieur<br />
abrite un nombre important d’oiseaux d’eau paléarctiques<br />
et afrotropicaux, les seconds ayant de considérables<br />
populations nicheuses dans la zone. Lamarche<br />
(1981) donnait des informations générales sur les<br />
oiseaux d’eau nicheurs, mais Skinner et al. (1987)<br />
menèrent une première étude sur les forêts inondées<br />
existantes et leurs colonies de hérons. L’histoire<br />
récente de ces forêts a été fournie par l’analyse de<br />
photos aériennes prises en 1952 et en 1971, et complétée<br />
par les résultats des prospections aériennes<br />
exécutées en 1985-87. Cette étude des années 1980 a<br />
révélé un sérieux déclin du nombre d’habitats de<br />
reproduction disponibles, à cause de la surexploitation<br />
(pâturages, défrichements à des fins rizicoles) des<br />
forêts inondées, exacerbé par les longues années de<br />
sécheresse sahélienne et les faibles inondations annuelles.<br />
En 1985, ils ne restaient que cinq grandes colonies<br />
utilisant sept forêts inondées, sur les vingt-cinq<br />
antérieurement connues (années 1950). Néanmoins<br />
les 87.000 couples nicheurs établis comprenant<br />
quinze espèces (Skinner et al. 1987) font encore du<br />
DIN une zone d’intérêt capital, sinon le plus important<br />
site de reproduction en Afrique de l’Ouest (cf.<br />
Kushlan & Hafner 2000). A côté des hérons et aigrettes,<br />
la gamme d’espèces incluait aussi le Cormoran<br />
africain Phalacrocorax africanus, l’Anhinga d’Afrique<br />
Anhinga rufa, l’Ibis sacré Threskiornis aethiopica, la Spatule<br />
d’Afrique Platalea alba et le Bec-ouvert africain. Les<br />
accords de gestion entre les parties intéressées, initiés<br />
par l’UICN dans les années 1980, ont conduit, en<br />
première instance, à une diminution encourageante<br />
de la coupe du bois et à une augmentation de la régénération<br />
de deux forêts inondées.<br />
Aujourd’hui, pendant que ces deux forêts servent<br />
d’exemples stimulants de forêts régénérées, il est alarmant<br />
de noter le déclin continu des habitats de reproduction<br />
disponibles à travers davantage de dégradation<br />
des zones boisées ailleurs dans le DIN, même si<br />
d’autres crues plus performantes ont été enregistrées<br />
depuis 1994. Au cours des années 1998-2002 les<br />
investigations au cours du projet (van der Kamp &<br />
Diallo 1999, Wymenga et al. 2000, van der Kamp et al.<br />
2001) ont révélé seulement deux grandes colonies<br />
nicheuses restantes, les autres ayant été abandonné ou<br />
abritant une à trois espèces en reliquats de colonies<br />
prospérant autrefois (cf. Skinner et al. 1987). Les deux<br />
grandes colonies sont trouvées dans les forêts inon-<br />
Colonies nicheuses dans le <strong>Delta</strong> 165<br />
Vue aérienne de forêt d’Akkagoun en novembre 1999 (composition photographique, assemblée à partir de plusieurs photos), avec un chenal<br />
sillonnant la “tête” de forêt. Le niveau d’eau est de 511 cm (l’échelle à Akka).<br />
dées régénérées en bordure du complexe Debo,<br />
montrant l’impact des mesures de conservation prises<br />
en coopération avec les comités de gestion locaux.<br />
Comparés aux années 1940, 92% des sites de colonies<br />
restaient dans les années 1950, 28% en 1985 et seulement<br />
8% étaient occupés en 2000 (figure 7.1).<br />
Skinner et al. (1987) notaient sept sites de colonie<br />
comme ‘non-occupés du fait de faibles crues’ qui<br />
auraient pu être réoccupés depuis l’apparition (1994)<br />
de crues plus substantielles, mais nos prospections<br />
(survol, terrain) confirment plutôt la dégradation<br />
progressive des zones boisées. Un total provisoire de<br />
couples nicheurs estimé à 79.500 dans le DIN en<br />
2001 (toutes espèces comprises) signifierait une<br />
diminution de 7-8% sur les 15 dernières années. Dans<br />
le tableau 7.2 les espèces nicheuses en colonies des<br />
forêts inondées sont listées, avec leur nombre estimé<br />
de couples nicheurs en 1985/86 (Skinner et al.<br />
1987), durant les années 1994-96 et en 1999/2001.<br />
La figure 7.1 donne une vue d’ensemble des sites de<br />
reproduction des forêts inondées, dans le passé et à<br />
présent.<br />
Les forêts d’envergure substantielle: Akkagoun<br />
et Dentaka<br />
Les deux forêts en état dégradé et dépérissant au<br />
début des années 1980, ont pu être rétablies grâce<br />
aux initiatives concertées de l’UICN et les populations<br />
locales (voir UICN 1999, 2001). Elles consistent<br />
essentiellement en Acacia kirkii, avec quelques Ziziphus<br />
mauritiana à Akkagoun.<br />
akkagoun<br />
Akkagoun est situé au bord du <strong>fleuve</strong>, à la sortie du<br />
Lac Debo. La forêt a été replantée partiellement, puis<br />
surveillée et gérée par un comité de gestion villageois<br />
en étant actuellement d’une superficie d’environ 178<br />
ha (UICN 1999: zone boisée dense 74 ha, zone peu<br />
boisée 104 ha). Sa forme de ‘têtard’ permet aux<br />
oiseaux de nicher dans la partie la plus dense (la<br />
‘tête’) en étant remarqué que suite aux dérangements<br />
humains la colonie mixte s’est déplacée<br />
quelques fois dans les années passées. Il en a résulté<br />
que la colonie actuelle est principalement occupée<br />
par le Héron garde-boeuf Bubulcus ibis; la quasi-totalité<br />
des autres espèces l’ont abandonnée. Cependant,