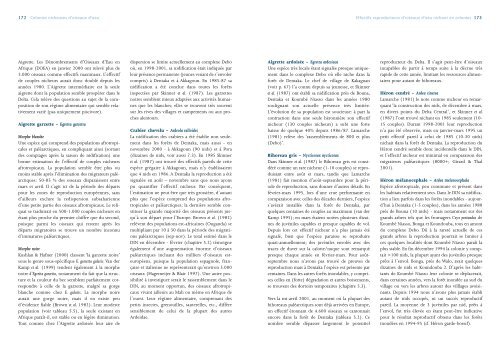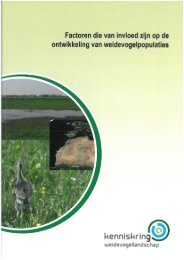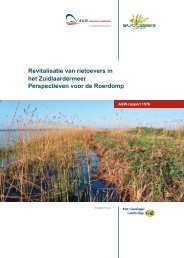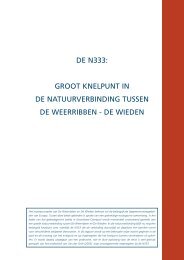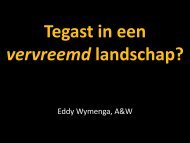Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
172 Colonies nicheuses d’oiseaux d’eau<br />
Aigrette. Les Dénombrements d’Oiseaux d’Eau en<br />
Afrique (DOEA) en janvier 2000 ont relevé plus de<br />
5.000 oiseaux comme effectifs maximaux. L’effectif<br />
de couples nicheurs aurait donc doublé depuis les<br />
années 1980. L’Aigrette intermédiaire est la seule<br />
aigrette dont la population semble prospérer dans le<br />
<strong>Delta</strong>. Cela relève des questions au sujet de la composition<br />
de son régime alimentaire qui semble relativement<br />
varié (pas uniquement piscivore).<br />
Aigrette garzette - Egretta garzetta<br />
morphe blanche<br />
Une espèce qui comprend des populations afrotropicales<br />
et paléarctiques, en compliquant ainsi (sortant<br />
des comptages après la saison de nidification) une<br />
bonne estimation de l’effectif de couples nicheurs<br />
afrotropicaux. La population semble être plus ou<br />
moins stable après l’élimination des migrateurs paléarctiques:<br />
50-85 % des oiseaux disparaissent entre<br />
mars et avril. Il s’agit ici de la période des départs<br />
pour les zones de reproduction européennes, sans<br />
d’ailleurs exclure la redispersion subsaharienne<br />
d’une petite partie des oiseaux afrotropicaux. Le reliquat<br />
se traduirait en 500-1.000 couples nicheurs en<br />
étant plus proche du premier chiffre que du second,<br />
puisque parmi les oiseaux qui restent après les<br />
départs migratoires se trouve un nombre inconnu<br />
d’immatures paléarctiques.<br />
morphe noire<br />
Kushlan & Hafner (2000) classent ‘la garzette noire’<br />
sous le genre sous-spécifique E. garzetta gularis. Van der<br />
Kamp et al. (1999) tendent également à la morphe<br />
noire d’Egretta garzetta, notamment du fait que la structure<br />
et la couleur du bec semblent parfaitement correspondre<br />
à celle de la garzette, malgré sa gorge<br />
blanche comme chez E. gularis. La morphe noire<br />
aurait une gorge noire, mais il en existe peu<br />
d’évidence fiable (Brown et al. 1982). Leur modeste<br />
population (voir tableau 5.5), la seule existant en<br />
Afrique paraît-il, est stable ou en légère diminution.<br />
Tout comme chez l’Aigrette ardoisée leur aire de<br />
dispersion se limite actuellement au complexe Debo<br />
où, en 1998-2001, sa nidification était indiquée par<br />
leur présence permanente (jeunes venant de s’envoler<br />
compris) à Dentaka et à Akkagoun. En 1985-87 sa<br />
nidification a été conclue dans toutes les forêts<br />
inspectées par Skinner et al. (1987). Les garzettes<br />
noires semblent mieux adaptées aux activités humaines<br />
que les blanches; elles se trouvent très souvent<br />
sur les rives des villages et campements ou aux proches<br />
alentours.<br />
Crabier chevelu - Ardeola ralloides<br />
La nidification des crabiers a été établie non seulement<br />
dans les forêts de Dentaka, mais aussi - en<br />
novembre 2000 - à Akkagoun (90 nids) et à Pora<br />
(dizaines de nids, voir aussi 7.3). En 1985 Skinner<br />
et al. (1987) ont trouvé des effectifs pareils de cette<br />
espèce grégaire à Akkagoun, mais n’y établissaient<br />
que 4 nids en 1986. A Dentaka la reproduction a été<br />
signalée en août – novembre sans que nous ayons<br />
pu quantifier l’effectif nicheur. Par conséquent,<br />
l’estimation ne peut être que très grossière, d’autant<br />
plus que l’espèce comprend des populations afrotropicales<br />
et paléarctiques; la dernière semble constituer<br />
la grande majorité des oiseaux présents jusqu’à<br />
son départ pour l’Europe. Brown et al. (1982)<br />
relèvent des populations est-africaines (Ouganda) se<br />
multipliant par 10 à 30 dans la période des migrations<br />
paléarctiques (sep-nov). Le total estimé dans le<br />
DIN en décembre - février (chapitre 5.2) témoigne<br />
également d’une augmentation énorme d’oiseaux<br />
paléarctiques incluant des milliers d’oiseaux esteuropéens,<br />
puisque la population espagnole, française<br />
et italienne ne représenterait qu’environ 5.000<br />
oiseaux (Hagemeijer & Blair 1997). Une autre possibilité<br />
à investiguer serait le rassemblement dans le<br />
DIN, au moment opportun, des oiseaux afrotropicaux<br />
vivant ailleurs au Mali ou même en Afrique de<br />
l’ouest. Leur régime alimentaire, comprenant des<br />
petits insectes, grenouilles, sauterelles, etc., diffère<br />
sensiblement de celui de la plupart des autres<br />
Ardeidae.<br />
Aigrette ardoisée - Egretta ardesiaca<br />
Une espèce très locale étant signalée presque uniquement<br />
dans le complexe Debo où elle niche dans la<br />
forêt de Dentaka. Le chef de village de Kakagnan<br />
(voir p. 67) l’a connu depuis sa jeunesse, et Skinner<br />
et al. (1987) ont établi sa nidification près de Bouna,<br />
Dentaka et Koumbé Niasso dans les années 1980<br />
soulignant son actuelle présence très limitée.<br />
L’évolution de sa population est soucieuse: à part la<br />
contraction dans une seule héronnière son effectif<br />
nicheur (130 couples nicheurs) a subi une forte<br />
baisse de quelque 40% depuis 1986/87. Lamarche<br />
(1981) relève des ‘rassemblements de 800 et plus<br />
(Debo)’.<br />
Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax<br />
Dans Skinner et al. (1987) le Bihoreau gris est considéré<br />
comme un rare nicheur (1-10 couples) se reproduisant<br />
entre août et mars, tandis que Lamarche<br />
(1981) fait mention d’août-septembre pour la période<br />
de reproduction, sans donner d’autres détails. En<br />
février-mars 1995, lors d’une crue performante en<br />
comparaison avec celles des décades derniers, l’espèce<br />
s’avérait installée dans la forêt de Dentaka, par<br />
quelques centaines de couples au maximum (van der<br />
Kamp 1995); en mars étaient notées plusieurs dizaines<br />
de juvéniles capables et presque capables de vol.<br />
Depuis lors cet effectif nicheur n’a plus jamais été<br />
signalé, bien que l’espèce paraisse se reproduire<br />
quasi-annuellement; des juvéniles envolés avec des<br />
traces de duvet sur la calotte/nuque sont remarqué<br />
presque chaque année en février-mars. Pour aoûtseptembre<br />
nous n’avons pas trouvé de preuves de<br />
reproduction mais à Dentaka l’espèce est présente par<br />
centaines. Dans les autres forêts inondables, y comprises<br />
celles en (forte) dégradation et autres boisements,<br />
se trouvent des dortoirs temporaires (chapitre 5.3).<br />
Vers la mi-avril 2001, au moment où la plupart des<br />
bihoreaux paléarctiques sont déjà arrivées en Europe,<br />
un effectif étonnant de 4.600 oiseaux se cantonnait<br />
encore dans la forêt de Dentaka (tableau 5.2). Ce<br />
nombre semble dépasser largement le potentiel<br />
Effectifs reproducteurs d’oiseaux d’eau nichant en colonies 173<br />
reproducteur du <strong>Delta</strong>. Il s’agit peut-être d’oiseaux<br />
incapables de partir à temps suite à la décrue très<br />
rapide de cette année, limitant les ressources alimentaires<br />
pour autant de bihoreaux.<br />
Héron cendré - Ardea cinerea<br />
Lamarche (1981) le note comme nicheur en remarquant<br />
‘la construction des nids, de décembre à mars,<br />
en divers points du <strong>Delta</strong> Central’, et Skinner et al.<br />
(1987) l’ont trouvé nichant en 1985 seulement (10-<br />
15 couples). <strong>Du</strong>rant 1998-2001 leur reproduction<br />
n’a pas été observée, mais en janvier-mars 1995 un<br />
petit effectif pareil à celui de 1985 (10-30 nids)<br />
nichait dans la forêt de Dentaka. La reproduction du<br />
Héron cendré semble donc incidentelle dans le DIN,<br />
et l’effectif nicheur est minimal en comparaison des<br />
migrateurs paléarctiques (8000+; Girard & Thal<br />
2001).<br />
Héron mélanocephale - Ardea melanocephala<br />
Espèce afrotropicale, peu commune et présent dans<br />
les habitats relativement secs. Dans le DIN sa nidification<br />
a lieu parfois dans les forêts inondables - aujourd’hui<br />
à Dentaka (1-5 couples), dans les années 1980<br />
près de Bouna (10 nids) - mais notamment sur des<br />
grands arbres tels que les fromagers Ceyx pentandra de<br />
Koumbé Niasso, Bonga et Koundouba, tous en amont<br />
du complexe Debo. Dû à la rareté actuelle de ces<br />
grands arbres la reproduction pourrait se limiter à<br />
ces quelques localités dont Koumbé Niasso paraît la<br />
plus stable. En fin décembre 1994 la colonie y comptait<br />
>100 nids, la plupart ayant des juvéniles presque<br />
prêts à l’envol. Bonga, près de Walo, avait quelques<br />
dizaines de nids et Koundouba 2. D’après les habitants<br />
de Koumbé Niasso leur colonie se déplacerait,<br />
dans certaines années, vers la forêt inondée au sud du<br />
village ou vers les arbres autour des villlages avoisinants.<br />
Depuis 1994 nous n’avons plus jamais établi<br />
autant de nids occupés, ni un succès reproductif<br />
pareil. La moyenne de 3 juvéniles par nid, prêts à<br />
l’envol, fut très élevée en étant peut-être indicative<br />
pour le résultat reproductif obtenu dans les forêts<br />
inondées en 1994-95 (cf. Héron garde-boeuf).