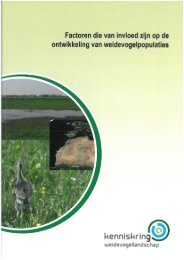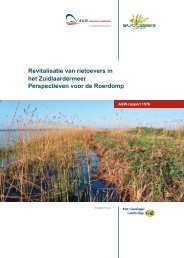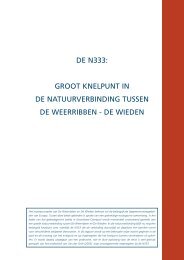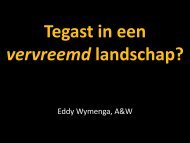Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
146 Niveaux de crue, oiseaux d’eau et ressources alimentaires disponibles<br />
que les lâchers d’eau du barrage de Markala peuvent<br />
noyer des étendues substantielles de jeunes pousses/<br />
plantes de Bourgou Echinochloa stagnina, et en conséquence<br />
l’habitat des pourprés. La disparition du<br />
bourgou n’est pas seulement limitatif pour les<br />
herons, mais a un effet néfaste aussi pour le cheptel<br />
des Peul, concentré dans les Debos lors de l’étiage.<br />
Leur bétail dépend fortement de ce fourrage. Dans<br />
des années sèches les animaux tardent souvent à<br />
partir du <strong>Delta</strong>, par manque de pluies, en détériorant<br />
ainsi les conditions de croissance du bourgou par<br />
leur exploitation prolongée. Ici aussi, le bourgou<br />
surexploité risque de périr dans la nouvelle crue.<br />
L’évolution des effectifs lors des grandes crues se<br />
trouve évidemment sur un plan numérique plus<br />
élevé que dans les années sèches. Toutefois, chez le<br />
Héron pourpré on constate une différence entre les<br />
deux bonnes années, contrairement à ce qui se fait<br />
voir chez les cormorans dont les effectifs sont du<br />
même ordre. C’est ici que le Cormoran africain<br />
(espèce afrotropicale) et le Héron pourpré (paléarctique)<br />
se distinguent: le premier semble montrer un<br />
taux de reproduction amélioré (effet direct), le<br />
second - au premier instant - une survie améliorée<br />
dans son quartier d’hiver pouvant mener, à plus long<br />
terme, à une population croissante (effet indirect).<br />
La relation entre les conditions climatiques du Sahel<br />
(pluviométrie, crues des <strong>fleuve</strong>s) et l’évolution des<br />
populations ouest-européennes du Héron pourpré a<br />
été démontrée par Den Held (1981) et Cavé (1983).<br />
Cette relation peut même être plus forte en tenant<br />
compte de la superficie des bourgoutières flottantes<br />
dans le <strong>Delta</strong> (voir aussi van der Kamp et al. 2001) en<br />
général et le complexe Debo en particulier, étant le<br />
lieu clé de rassemblement prémigratoire.<br />
aigrette garzette – figure 6.1<br />
Le graphique visualise une augmentation progressive<br />
des effectifs, jusqu’à des niveaux d’eau très bas.<br />
L’Aigrette garzette pêche dans d’autres habitats que<br />
le Héron pourpré; son niche comprend les berges et<br />
rives dénudés des lacs et cours d’eau, les espaces<br />
d’eau ouverte et peu profonde, et les dernières lames<br />
d’eau (2-5 cm de profondeur) des zones à végétation<br />
aquatique où les poissons ont peu de chances à<br />
échapper. Les évolutions numériques lors des différentes<br />
crues ne sont pas très divergentes, soit que les<br />
écarts sont plus grands en dessous de 200 cm (échelle<br />
Akka). L’effectif de mars 2001 (10.000+ ) contribue<br />
notamment à cette divergence et semble assez<br />
exceptonnel: ce grand effectif est similaire au total<br />
du DIN établi lors des comptages aériens de l’ONCFS<br />
en janvier (Girard & Thal 2001).<br />
Chevalier arlequin – figure 6.1<br />
Comme indiqué au chapitre 5.3, de grands nombres<br />
de Chevaliers arlequins se regroupent au cours de la<br />
décrue dans le complexe Debo. Les arlequins peuvent<br />
s’associer à d’autres espèces, en offrant parfois des<br />
scènes spectaculaires de quelques milliers d’Aigrettes<br />
garzettes, Echasses blanches et Chevaliers arlequins<br />
pêchant ensembles; par contre, au reposoir l’espèce<br />
s’associe souvent aux Barges à queue noire (benthivores<br />
au Debo). La relation avec la hauteur d’eau<br />
montre clairement un effectif élevé à un niveau d’eau<br />
au dessous de 200 cm (Akka), tandis que l’espèce est<br />
absente aux hautes eaux. L’effectif pic, en groupes<br />
ramassés, peut dépasser 2.000 oiseaux dans<br />
l’intervalle 175 à 75 cm.<br />
Guifette moustac et Guifette leucoptère – figure 6.1<br />
Dans les recensements se présente souvent un nombre<br />
substantiel de guifettes non-identifiées, raison<br />
pour laquelle les deux espèces de guifettes ont été<br />
prises ensembles dans la figure présentée. Leur technique<br />
de pêche semble être légèrement différente<br />
(Cramp & Simmons 1983) sans être très apparente<br />
dans le complexe Debo. Leur technique de pêche au<br />
vol, sans avoir besoin de hauts-fonds exondés en tant<br />
que reposoirs, leur permet d’être présentes lors de<br />
l’inondation totale du complexe Debo. Les écarts<br />
numériques sont grands sur toute la décrue,<br />
l’évolution des effectifs ayant néanmoins une tendance<br />
positive vers les niveaux d’eau les plus bas.<br />
L’effectif croissant vers la fin de décrue peut être dû<br />
à leur visibilité améliorée - reposoirs sur hauts-fonds<br />
sans ou avec pelouse initiale - et/ou à un influx<br />
d’oiseaux migrateurs provenant des zones en amont<br />
du <strong>Delta</strong> (cf. Lamarche 1981). L’ensemble des espèces<br />
est toujours présent par milliers, les écarts étant<br />
expliqués par leur disparition régulière dans la<br />
végétation émergeante lors des périodes de repos/<br />
digestion, ou de couvaison (moustacs). Une moindre<br />
présence dans les années de sécheresse n’est pas évidente.<br />
sterne caspienne – figure 6.1<br />
Un pêcheur paléarctique qui dépend fortement de la<br />
présence et de la disponibilité des bancs de sable et<br />
autres hauts-fonds emergés où l’espèce peut se cantonner<br />
outre ses activités de pêche. Présence et disponibilité<br />
sont mentionnées séparément puisque dès<br />
l’apparition des hauts-fonds les premiers campements<br />
de pêche y sont installés en laissant, au premier<br />
instant, peu d’espace aux caspiennes. Cependant<br />
les oiseaux ne tardent pas à venir: moins de deux<br />
semaines plus tard, juste en dessous de 300 cm sur<br />
l’échelle de Akka, la quasi-totalité est déjà présente en<br />
restant sur place jusqu’à leur départ vers les zones de<br />
reproduction (voir chapitre 5.3).<br />
L’image présentée se distingue de celle du Héron<br />
pourpré, un autre pêcheur paléarctique, par la stabilisation<br />
de l’effectif total, peu après son apparition à<br />
une niveau d’eau d’environ 250 cm à Akka. La stabilisation<br />
de leur effectief suggère que pratiquement<br />
tous les oiseaux du <strong>Delta</strong> y sont actuellement présents.<br />
Les caspiennes n’ont pratiquement pas été<br />
observées dans les lacs périphériques au nord des<br />
Debos, lors des comptages aériens en mars 1999 et<br />
2001 (van der Kamp et al. 2001).<br />
Le total de la Sterne caspienne a atteint presque 3.200<br />
oiseaux en 2000, étant un renforcement sensible de<br />
l’effectif après la deuxième grande crue, qui a mené<br />
probablement à une survie améliorée (conditions<br />
alimentaires améliorées lors de cette bonne crue,<br />
moins d’oiseaux attrapés). En 2001 le maximum a<br />
Impact de la crue: les niveaux d’eau et la présence d’oiseaux d’eau en Debo 147<br />
été de 3.334 oiseaux rendant l’accroissement signalé<br />
en 2000 plus consistent. L’effet de la première grande<br />
crue (1994) n’a pu être établi directement, par<br />
manque d’observations. La seule occasion dans les<br />
années 1995-97, début mars 1996, fut affectée par<br />
une période de poussière (visibilité restreinte) en<br />
donnant un résultat douteux. Ledit effet se déduit<br />
néanmoins en prenant les moyennes des effectifsmaximum<br />
avant et après la première bonne crue:<br />
2.552 en 1992/1994 et 2.734 en 1998-1999.<br />
echasse blanche – figure 6.2<br />
Dans les périodes où le niveau d’eau leur permet de<br />
venir dans la zone d’étude, à partir d’une cote de<br />
décrue d’environ 330 cm, les Echasses blanches<br />
montrent une évolution progressive des effectifs, en<br />
étant donné que lors des deux grandes crues nous<br />
n’avons pu les suivre que jusqu’au démarrage de<br />
cette évolution, en mars. C’est dans ce mois-ci que<br />
leur migration transsaharienne a lieu et, par conséquent,<br />
le complexe Debo n’a pas d’intérêt pour les<br />
échasses - et d’autres limicoles ayant la même période<br />
de départ - lors des crues performantes, puisque<br />
la possibilité d’y exploiter les ressources alimentaires<br />
vient trop tard. A noter également - peut-être - que<br />
les oiseaux semblent ‘hésiter’ à venir lors des crues<br />
performantes en comparant les évolutions numériques<br />
initiales des grandes et des faibles crues.<br />
En fin de décrue l’effectif total peut dépasser 5.000<br />
oiseaux, comme établi en début 1994. Leur aire de<br />
répartition doit avoir été restreinte à cet époque<br />
(même pour l’Echasse blanche figurant parmi les<br />
espèces largement répandues dans le DIN), en fin<br />
d’une série d’années de très faibles crues (chapitre<br />
3). L’Echasse semble continuer à agrandir son effectif<br />
jusqu’à son départ en migration, contrairement à ce<br />
que l’on constate chez les deux espèces suivantes.<br />
Cela pourrait s’expliquer par le régime alimentaire<br />
de l’espèce: l’échasse pêche aussi et cela lui permettrait<br />
de maintenir sa croissance numérique là où le<br />
stock en mollusques s’épuise en fin de décrue.