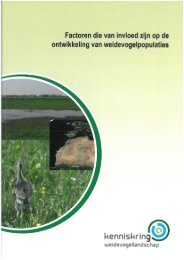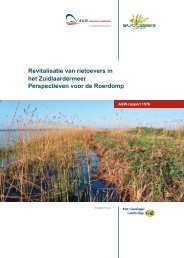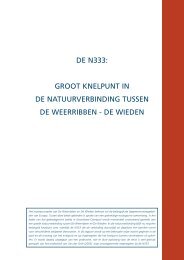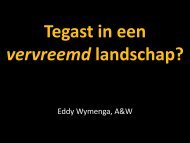Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Delta intérieur Du fleuve niger
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
32 Brève description du <strong>Delta</strong><br />
Actuellement au Mali avec l’avènement de la décentralisation<br />
des années 1990, les collectivités territoriales<br />
décentralisées peuvent disposer de leur domaine.<br />
Elles sont responsables de leur gestion, aménagement,<br />
conservation et de la sauvegarde de leur équilibre<br />
écologique. Aussi les nouveaux textes forestiers<br />
et les textes institutionnels et juridiques au Mali,<br />
donnent l’ouverture pour une mobilisation des<br />
populations dans la gestion des ressources naturelles<br />
de leur commune et l’établissement de conventions<br />
locales pour l’utilisation rationnelle de ces ressources.<br />
Les communautés locales, groupes ethniques<br />
et l’utilisation des terres.<br />
Le <strong>Delta</strong> Intérieur du Niger, commun aux régions de<br />
Ségou, Mopti et Tombouctou, était peuplé d’environ<br />
800.000 habitants en 1990 (Quensière 1994). Étant<br />
donné que la population a augmenté considérablement,<br />
celle-ci doit approcher le million d’habitants.<br />
Les principales activités, telles que l’agriculture,<br />
l’élevage, la pêche, la cueillette et l’artisanat, sont<br />
pratiquées par différents groupes ethniques. L’élevage<br />
est pratiqué par les pasteurs transhumants composés<br />
de Peul, Tamasheq et Maures. Les agro-pastoralistes<br />
(Peuls, Rhimaïbés et Bellas) pratiquent à la fois des<br />
activités agricoles et d’élevage. Les Bozos, Somonos<br />
et Sorkos sont des agro-pêcheurs et les pêcheurs<br />
transhumants sont essentiellement composés de<br />
Bozos. Cette spécialisation dans les activités demeure<br />
encore, bien qu’elle ait été fortement ébranlée au fil<br />
des années. Cet ébranlement est dû:<br />
• aux longues années de sécheresses avec ses collolaires<br />
de faibles crues et pluviométrie;<br />
• à la paupérisation des différentes couches socioprofessionnelles<br />
ayant conduit certaines à se<br />
reconvertir dans d’autres activités;<br />
• à la diminution des pouvoirs des gestionnaires des<br />
ressources naturelles dû aux chevauchements entre<br />
les lois étatiques et coutumières.<br />
Depuis le temps de la Dina jusqu’à maintenant les<br />
Peuls (Dioro) restent les gestionnaires des immenses<br />
pâturages d’Echinochloa stagnina (‘bourgoutières’) bien<br />
que leur pouvoir ait été affaibli par les querelles entre<br />
les différents clans. Le Dioro est l’administrateur de<br />
l’exploitation des pâturages de bourgou et reçoit une<br />
redevance payée par les propriétaires des troupeaux<br />
étrangers des Tamasheq, des Peuls et des Maures<br />
autorisés à paître. L’accès aux différents pâturages de<br />
bourgou (novembre-mars) se fait par des séries de<br />
traversées par le bétail dont les dates sont fixées par<br />
la Conférence Régionale des bourgoutières de Mopti,<br />
regroupant toutes les parties prenantes.<br />
Les dures années de sécheresse, les faibles crues,<br />
l’augmentation des effectifs du cheptel et de la<br />
population humaine ont fortement dégradés ou fait<br />
disparaître la presque totalité des pâturages. C’est<br />
pourquoi il n’est pas rare de voir aujourd’hui les<br />
populations locales s’adonner à des actions de régénération<br />
de ces pâturages (plantation de Bourgou).<br />
Les Bozos et les Somonos sont des agro-pêcheurs. Les<br />
Bozos, considérés comme des autochtones sont les<br />
plus nombreux. C’est dans cette lignage d’autochtones<br />
que les gestionnaires des pêcheries (les maîtres des<br />
eaux) sont choisis. En plus de la pêche dans les mares,<br />
lacs et <strong>fleuve</strong>s ces deux ethnies - Bozos et Somonos<br />
- cultivent le riz flottant et s’adonnent à la cueillette<br />
du riz sauvage, des graines de bourgou, des nénuphars<br />
et des fourrages de bourgou. Les Bozos gèrent<br />
les zones de pêche fréquentées par les pêcheurs<br />
sédentaires et transhumants.<br />
Les pêcheurs transhumants sont en majorité de<br />
l’ethnie Bozo et viennent de l’amont du DIN: Ségou,<br />
Djenné et Macina. Ils s’installent dans de grands<br />
campements sur les <strong>fleuve</strong>s Diaka, Bani et Niger et<br />
aux abords des lacs Debo et Walado. Ils participent<br />
aux côtés des pêcheurs sédentaires aux pêches collectives.<br />
En général les pêcheurs transhumants payent<br />
des redevances au maîtres des eaux en nature (huile<br />
de poissons) ou en argent. Une fois que la saison des<br />
pluies s’installe dans le DIN les transhumants regagnent<br />
leurs villages.<br />
Les années de sécheresse consécutives, les faibles<br />
crues, l’accroissement du nombre des pêcheurs et la<br />
surpêche ont fortement bouleversés la vie des<br />
pêcheurs (pour plus d’information se référer à<br />
Quensière 1994, Laë 1995). Toutes ces calamités<br />
naturelles ont conduit à des pratiques de pêche prohibées<br />
(filet à petite maille et barrages de pêche).<br />
Selon les pêcheurs, les quantités de poissons pêchées<br />
sont très inférieurs à celles d’antan et les poissons<br />
capturés sont plus petits. D’autres se plaignent de la<br />
disparition de certaines espèces dans leur prise ou de<br />
la rareté à haute valeur monétaire de certaines. Cette<br />
situation a conduit beaucoup de pêcheurs à se rabattre<br />
sur des activités secondaires comme la capture des<br />
oiseaux d’eau.<br />
Les ethnies qui pratiquent l’agriculture sont les<br />
Rhimaïbés et Bellas (anciens esclaves des Peul), les<br />
Bambara, Dogon, Marka et Sonrai. Dans les plaines<br />
inondées elles cultivent le riz flottant: Oryza glaberrima<br />
entre juin et décembre. Sur les terres environnantes<br />
du DIN, le mil et sorgho sont cultivés entre juin et<br />
octobre. Pendant les décrues dans les lacs périphériques,<br />
grandes mares et cours d’eau, elles développent<br />
des cultures de décrues comme le sorgho, et le<br />
maraîchage.<br />
L’utilisation des terres rurales et communautés locales 33<br />
Les années de sécheresse et les faibles crues ont<br />
poussé ces agriculteurs à défricher les zones de pâturages<br />
et débroussailler les quelques forêts inondées<br />
qui existaient pour faire de la riziculture.<br />
Malheureusement ces terres se sont révélées inaptes à<br />
la riziculture. La gestion de la majorité de ces terres<br />
agricoles relève de la compétence du chef de village<br />
et de ses conseillers.<br />
Les activités de cueillette (récolte de bourgou, graines,<br />
nénuphars, bois) sont pratiquées par toutes les<br />
ethnies tandis que l’artisanat (poterie et vannerie) est<br />
pratiqué par les personnes de castes (forgerons et<br />
cordonniers). Ces activités procurent des revenus<br />
importants à ces groupes ethniques (tourisme). La<br />
spécialisation des ethnies dans des activités a été mise<br />
à rude épreuve par les calamités naturelles et les<br />
mutations socio-économiques. Cependant des lueurs<br />
d’espoir se profilent avec la reprise des bonnes crues<br />
depuis 1994 et la mise en route de décentralisation<br />
qui responsabilise les communautés locales pour la<br />
gestion des ressources naturelles de leur terroir (voir<br />
aussi chapitre 8).