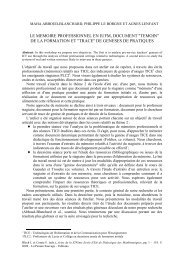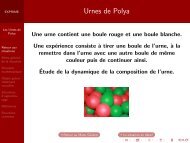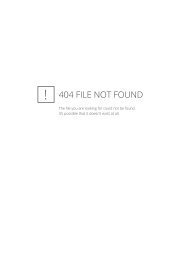Master HPDS, Université Lyon 1, Laboratoire LEPS ... - Educmath
Master HPDS, Université Lyon 1, Laboratoire LEPS ... - Educmath
Master HPDS, Université Lyon 1, Laboratoire LEPS ... - Educmath
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
faire l’hypothèse que cette communauté de pratique déjà réalisée nous permettra de bénéficier<br />
d’un terrain privilégié une étude de phénomènes de symbiose, objets de notre recherche.<br />
Bien entendu, si nous avions disposé de plus de temps, nous aurions pu étudier la situation<br />
dans les deux autres équipes locales. Cela aurait permis de disposer de communautés de<br />
cultures différentes (une communauté issue du SFoDEM à Montpellier, une communauté plus<br />
liée aux équipes de recherche didactique à Paris). Cela pourrait constituer un prolongement de<br />
l’étude de ce mémoire.<br />
L’équipe locale de <strong>Lyon</strong> est formée de 4 enseignants et d’un chercheur. Parmi ces 4<br />
enseignants, trois expérimentent la calculatrice dans leurs classes, le quatrième participe aux<br />
observations dans les classes et aux réunions de l’équipe. Les élèves de l’enseignant<br />
observateur ne sont pas équipés de la calculatrice. Le chercheur de l’équipe est aussi le<br />
coordonnateur du projet e-CoLab.<br />
5.1.3 L’émergence des communautés de pratique<br />
On étudie l’émergence des communautés de pratique au sein des trois équipes suivant les<br />
critères et les dimensions de la pratique (§ 4.5.1). Les membres de l’équipe e-CoLab sont des<br />
enseignants de mathématiques et des chercheurs en didactique des mathématiques, dont tous<br />
les membres concourent au projet commun d’expérimentation du nouvel environnement<br />
technologique et de conception de ressources spécifiques pour cet environnement. Les trois<br />
équipes locales constituaient, avant le projet e-CoLab, des communautés de pratique, on<br />
étudie ici si les nouvelles pratiques engagées dans ce projet ont bien permis l’émergence de<br />
nouvelles communautés.<br />
En ce qui concerne la participation, on distingue la participation des membres dans les<br />
équipes locales (<strong>Lyon</strong>, Montpellier, Paris) et la participation dans l’équipe nationale. Les<br />
membres des équipes locales participent au travail dans leurs équipes de plusieurs façons<br />
actives : à partir des apports de ressources, des propositions des ressources adaptée par un<br />
enseignant à la calculatrice TI-nspire, des discussions qui auront lieu au sein de l’équipe sur<br />
les ressources proposées et sur les contraintes et les potentialités de la machine. Toutes ces<br />
activités s’inscrivent dans le cadre de la participation active. Les observations dans les classes<br />
qui auront lieu ensuite constituent à la fois une participation de la part de l’enseignant et une<br />
facilitation d’engagement d’autres membres de l’équipe (les chercheurs et les observateurs<br />
des séances). De même pour les discussions qui auront lieu sur les ressources expérimentées,<br />
les analyses a priori et a posteriori des séances dans une classe d’expérimentation et la<br />
description des points faibles et des points forts s’inscrivent dans le cadre de l’évolution de<br />
ressources et de la facilitation de sa mise en œuvre dans une autre classe par un autre<br />
enseignant. Des différents niveaux de participation existent à l’intérieur des équipes locales :<br />
il y a des chercheurs et des enseignants, certains enseignants ont des classes expérimentales,<br />
d’autres n’en ont pas. Mais tous participent aux observations dans les classes, à l’analyse des<br />
apprentissages, à la conception des ressources, aux réunions du projet, à la présentation du<br />
projet dans des colloques. De cette façon un type d’engagement mutuel a lieu dans le cadre<br />
des équipes locales. La participation des trois équipes dans le projet commun renforce cet<br />
engagement. Les réunions trimestrielles sont l’occasion de discussions sur les directions du<br />
travail dans chacune des équipes, l’état de l’évolution des ressources et de leur mutualisation<br />
entre équipes. A distance, sur l’espace de travail, des échanges se poursuivent.<br />
Les objectifs du projet sont clairs (§ 5.1) et un projet commun avec les lignes de travail existe<br />
dès le début de l’expérimentation en septembre 2006. Au cours du temps, des ressources<br />
commencent à être développées par les membres de l’équipe : des comptes rendus, des<br />
questionnaires pour élèves, des échanges à distance et un ensemble des ressources<br />
26