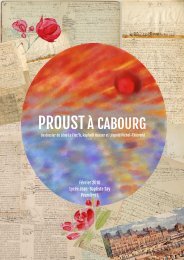Proust à Cabourg - Quatrième édition
Après plus de 850 lectures sur la version précédente, nous sommes très heureux de vous proposer la quatrième édition révisée de notre dossier (TPE) Proust à Cabourg, portant sur la relation entre le célèbre écrivain et la station normande. --------------------------------------------------------------------------------------------- Retrouvez l'édito et commentez cette publication sur notre site internet ➟ https://proustacabourg.weebly.com
Après plus de 850 lectures sur la version précédente, nous sommes très heureux de vous proposer la quatrième édition révisée de notre dossier (TPE) Proust à Cabourg, portant sur la relation entre le célèbre écrivain et la station normande.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Retrouvez l'édito et commentez cette publication sur notre site internet ➟ https://proustacabourg.weebly.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UN RYTHME BINAIRE
Cette phrase proustienne se double d’un rythme binaire, présent dans À l’ombre des jeunes filles
en fleurs. Il forme une structure nouvelle qui permet de comparer deux objets ou personnes
simultanément. Par exemple, Saint-Loup et Bloch sont souvent amenés à se rencontrer et si ce n'est pas
le cas, l'un est souvent le sujet de discussion de l'autre. De la même manière la pureté et l'élégance
« aérienne » des jeunes filles en fleurs provoquent un nouveau souffle pour le narrateur, qui se lasse
des cercles mondains et de l'aristocratie ennuyeuse du Grand-Hôtel. L'opposition est renforcée par un
cadre spatial particulier : les filles sont sur la digue et la plage tandis que les clients de l'hôtel sont
cloîtrés dans le restaurant ou au casino. Le narrateur est attiré davantage par le mouvement des filles
devant la mer que les villégiaturistes parisiens devant leur café.
Le rêve puis la réalité, l'idéal puis la désillusion définit également l'écriture de Marcel Proust. Le
narrateur corrige parfois ses attentes trop grandes, ou les met en confrontation avec celles des autres :
« mon rêve n'admettait pas, de baigneurs, de cabines, de yachts de plaisance. » - lorsqu'il répond
intérieurement aux dires d'Elstir. Ici, le romancier utilise plutôt le rythme ternaire, comme pour
montrer ce qui aurait pu être mais qui n'est pas, la triste réalité. Le trouble s'installe quand le rythme
binaire disparaît au profit du chiffre trois, comme dans le célèbre extrait des trois arbres de
Hudimesnil :
« Je regardais les trois arbres, je les voyais bien, mais mon esprit sentait qu’ils recouvraient quelque
chose sur quoi il n’avait pas prise, comme sur ces objets placés trop loin dont nos doigts allongés au
bout de notre bras tendu, effleurent seulement par instant l’enveloppe sans arriver à rien saisir. » En
passant devant cette allée d'arbres, le narrateur se perd dans une dimension possible - ou du moins il lui
a été donné de la voir, à priori, il n'est jamais passé par là. Nous sommes en réalité devant un exemple
des fameuses « madeleines de Proust ». L'un de ses sens est en alerte, le narrateur a l'impression de
connaître ce lieu, ce parfum, cette lumière et cette sensation le transpose directement dans le passé, au
lieu et au Temps rappelé.
UN RECOURS FRÉQUENT À DES SYNESTHÉSIES
Comme nous venons de le voir, Marcel Proust adopte une approche brillante pour plonger le
lecteur dans un événement particulier. Il utilise les synesthésies dont son aîné Charles Baudelaire avait
fait l'éloge dans le poème Correspondances. Les vers de ce sonnet : « La Nature est un temple où de
vivants piliers ... » comptent aujourd'hui parmi les plus illustres de la langue française. La synesthésie
est un procédé qui vise à réunir et à faire correspondre les différents sens. La vue, l’ouïe, le goût, …
deviennent donc les piliers d'une constitution universelle, où les sensations sont reines.
Continuellement, Proust enrichit sa littérature de correspondances pour lui donner un mouvement
phonétique et rythmique. On peut citer notamment le passage : « Je ne voyais pas mes amies […]
embaumée[s] dans la robe d'or. »
Un second extrait permet de mettre en relation les trois principales caractéristiques de La
Recherche, à savoir l'art, le mouvement et les synesthésies. L'extrait fait la description élégante de la
grâce des danseuses, à la façon d'un pastel de Degas, qui n’est pas sans évoquer la carte postale du
Kursaal (voir page 60) : « Les fillettes que j'avais aperçues, avec la maîtrise de gestes que donne un
parfait assouplissement de son propre corps et un mépris sincère du reste de l'humanité, (...) exécutant
87