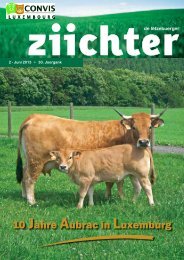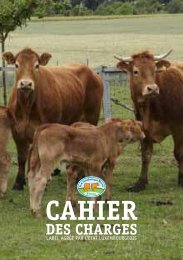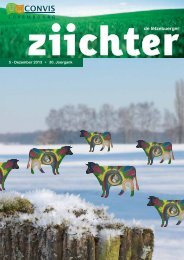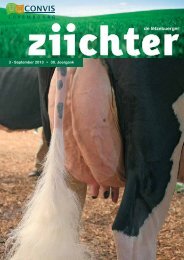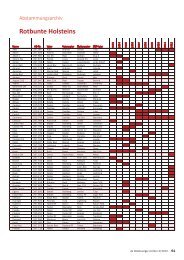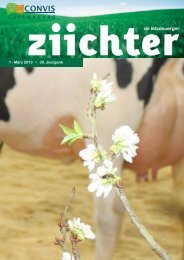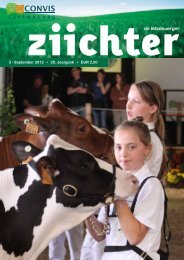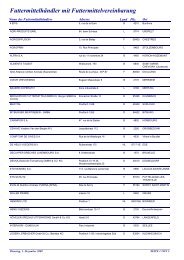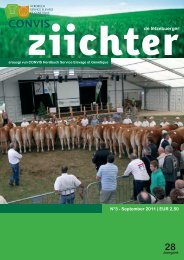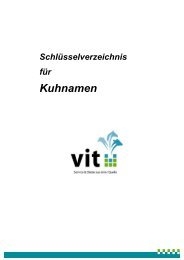de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...
de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...
de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
72 FLEISCHRINDER<br />
qu’environ la moitié <strong>de</strong>s céréales dont il<br />
a besoin. Concernant les fourrages (herbe<br />
et maïs), même constat : la Belgique n’atteint<br />
à l’heure actuelle que 65% d’autonomie<br />
fourragère apparente. Par contre,<br />
ici, il serait potentiellement possible d’y<br />
remédier en travaillant sur la sélection<br />
génétique <strong>de</strong> variétés plus performantes<br />
et sur les pratiques culturales. Pour les<br />
tourteaux protéiques, l’importation <strong>de</strong><br />
soja reste également indispensable mais<br />
<strong>de</strong>s mesures correctives sont néanmoins<br />
possibles pour en réduire l’importance<br />
(stimulation <strong>de</strong> la culture <strong>de</strong> protéagineux<br />
par l’amélioration <strong>de</strong>s moyens phytotechniques<br />
et la réduction <strong>de</strong>s points faibles<br />
nutritionnels <strong>de</strong> ces espèces, utilisation<br />
<strong>de</strong>s coproduits d’industries agro-alimentaires<br />
comme l’éthanolerie).<br />
■ Quelles autres barrières<br />
aux systèmes alimentaires<br />
locaux ?<br />
Les systèmes alimentaires locaux,<br />
constituent <strong>de</strong>s schémas <strong>de</strong> productionconsommation<br />
alternatifs au schéma<br />
conventionnel et cela constitue déjà une<br />
barrière en soi.<br />
Du point <strong>de</strong> vue infrastructurel, la mise en<br />
place <strong>de</strong> ces systèmes requiert <strong>de</strong> nouvelles<br />
compétences et donc le développement<br />
<strong>de</strong> connaissances nouvelles. Cependant,<br />
il est typique que le cofinancement<br />
nécessaire aux projets <strong>de</strong> recherche<br />
appliqués ne puisse pas être produit par<br />
ces systèmes locaux (contrairement aux<br />
sous-secteurs classiques).<br />
De même, au niveau institutionnel, les<br />
règles à respecter concernant l’agriculture<br />
et les secteurs alimentaires sont<br />
adaptées au schéma conventionnel<br />
c.à.d. à un schéma avec <strong>de</strong>s étapes <strong>de</strong><br />
production bien séparées. Dans le cas<br />
<strong>de</strong>s systèmes locaux, ces étapes sont<br />
réintégrées si bien que leur mise en place<br />
conduit régulièrement à <strong>de</strong>voir enfreindre<br />
les règles existantes en terme <strong>de</strong> sécurité<br />
alimentaire, transport, vente au détail,…<br />
Par ailleurs, les systèmes alimentaires<br />
locaux se créent souvent à l’initiative <strong>de</strong><br />
petits groupes <strong>de</strong> personnes liées ente<br />
<strong>de</strong> <strong>lëtzebuerger</strong> <strong>ziichter</strong> 2|<strong>2012</strong><br />
elles par <strong>de</strong>s idées communes, une relation<br />
<strong>de</strong> confiance. Ceci peut malheureusement<br />
conduire à un manque d’interactions<br />
du système développé avec le milieu<br />
extérieur, ces personnes ne s’intéressant<br />
pas toujours au développement d’initiatives<br />
similaires et ne recherchant pas forcément<br />
<strong>de</strong>s partenaires externes.<br />
En résumé, l’exposé <strong>de</strong> M. Mathijs, professeur<br />
d’économie agricole à l’Université <strong>de</strong><br />
Leuven, montre qu’il existe actuellement<br />
<strong>de</strong>s barrières culturelles et institutionnelles<br />
au développement <strong>de</strong>s systèmes<br />
alimentaires locaux et qu’un changement<br />
<strong>de</strong>s mentalités est indispensable. Reste<br />
donc à savoir quelle place sera accordée<br />
à ces systèmes dans le futur : <strong>de</strong>vront-ils<br />
se former au sein du système dominant<br />
du capitalisme (dont le discours prône la<br />
productivité) et donc s’adapter ou pourront-ils<br />
se former à côté, en systèmes<br />
nouveaux prônant un discours alternatif<br />
(discours <strong>de</strong> suffisance)?<br />
■ Appellations d’Origine Protégée<br />
(AOP) et Indications<br />
Géographiques Protégées<br />
(IGP)<br />
A côté <strong>de</strong>s produits dont la production<br />
et la consommation sont réalisés dans<br />
un espace local, il existe une autre sorte<br />
<strong>de</strong> produits dits « locaux ». Il s’agit <strong>de</strong><br />
produits pour lesquels le territoire est<br />
un argument <strong>de</strong> vente, un signe <strong>de</strong> qualité<br />
et <strong>de</strong> spécificité : Dans le cas <strong>de</strong>s<br />
IGP, le lien avec l’origine géographique<br />
provient principalement <strong>de</strong> la réputation,<br />
<strong>de</strong> la notoriété, d’un savoir-faire développé<br />
dans une zone déterminée. Pour<br />
les AOP, le lien avec le territoire est plus<br />
fort : toutes les phases <strong>de</strong> conception du<br />
produit doivent se dérouler dans la zone<br />
définie et ce, avec un savoir reconnu et<br />
constaté. Il faut pouvoir démontrer que<br />
les spécificités du produit sont liées au<br />
terroir (conditions pédoclimatiques, …) et<br />
donc non reproductibles ailleurs.<br />
Ces signes ont été mis en place par l’UE<br />
pour promouvoir la diversification <strong>de</strong> la<br />
production agricole, augmenter la compétitivité<br />
<strong>de</strong>s produits spécifiques (protection<br />
contre les imitations et usurpations)<br />
et répondre aux attentes du consommateur<br />
(qualité, information). En outre, ils<br />
peuvent générer <strong>de</strong>s retombées économiques<br />
intéressantes pour le producteur<br />
et lui ouvrir la porte aux marchés internationaux.<br />
A noter, le Grand-duché <strong>de</strong> Luxembourg<br />
détient actuellement 2 AOP (beurre rose<br />
<strong>de</strong> la marque nationale, miel <strong>de</strong> la marque<br />
nationale) et 2 IGP (vian<strong>de</strong> <strong>de</strong> porc <strong>de</strong> la<br />
marque nationale et salaisons fumées <strong>de</strong><br />
la marque nationale).<br />
Lors <strong>de</strong> son exposé, Mme Sindic du laboratoire<br />
Qualité et Sécurité <strong>de</strong>s Produits<br />
Agroalimentaires <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Liège-<br />
Gembloux Agro-bio Tech dresse, dans un<br />
premier temps, un état <strong>de</strong>s lieux concernant<br />
les AOP/IGP pour les classes <strong>de</strong> produits<br />
« vian<strong>de</strong>s et abats frais » et « produits<br />
à base <strong>de</strong> vian<strong>de</strong> ». Pour ces 2 classes<br />
<strong>de</strong> produits, il existe actuellement en<br />
Europe 246 AOP/IGP (2/3 IGP, 1/3 AOP),<br />
la France et le Portugal détenant à eux<br />
seuls 130 <strong>de</strong> ces AOP/IGP. Concernant<br />
la répartition entre les filières, 50 % <strong>de</strong>s<br />
AOP/IGP concernent la filière porcine (à<br />
90% pour <strong>de</strong>s produits à base <strong>de</strong> vian<strong>de</strong>),<br />
le reste se répartissant grosso modo à<br />
parts égales entre les filières bovine, avicole<br />
et ovine. Les liens avec l’origine géographique<br />
diffèrent quant à eux selon la<br />
classe <strong>de</strong> produits et le type d’appellation.<br />
Pour les vian<strong>de</strong>s et abats frais AOP, le lien<br />
se fait par le choix d’une race issue <strong>de</strong><br />
la zone géographique considérée, par une<br />
adaptation particulière <strong>de</strong> l’animal à son<br />
environnement (notamment au niveau<br />
<strong>de</strong> son alimentation), par un système<br />
d’élevage reposant sur le pâturage (souvent<br />
avec une végétation spécifique) et<br />
par <strong>de</strong>s caractéristiques organoleptiques<br />
particulières découlant <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux points<br />
précé<strong>de</strong>nts. Pour les vian<strong>de</strong>s et abats<br />
frais IGP, <strong>de</strong> nouveau, le lien se fait par<br />
le choix d’une race mais dans ce cas, la<br />
métho<strong>de</strong> d’élevage (le savoir-faire), le<br />
type d’alimentation (par exemple, <strong>de</strong>s coproduits<br />
d’activités locales) et la notoriété<br />
du produit jouent un rôle important. Enfin,<br />
concernant les produits <strong>de</strong> vian<strong>de</strong>, c’est<br />
l’utilisation <strong>de</strong> matières locales typiques<br />
voire l’influence <strong>de</strong> facteurs naturels sur<br />
les spécificités acquises par le produit<br />
qui interviennent pour les AOP tandis que<br />
pour les IGP, tout repose essentiellement<br />
sur le savoir-faire local.