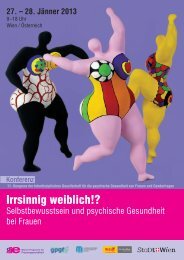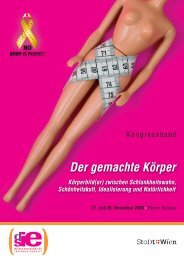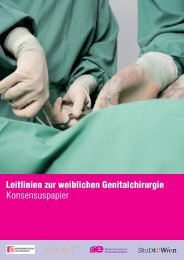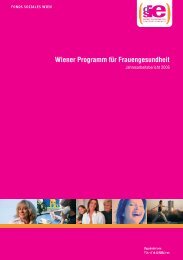Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’examen de ces stratégies laisse apparaître une certaine richesse<br />
et une sensibilité particulière des soignants aux problèmes<br />
de communication. On peut par exemple postuler que<br />
dans leurs affectations figure une sorte de devoir de bilectalisme<br />
(Borel 2004), qui débouche notamment sur des activités<br />
de reformulation. Ce bilectalisme est particulièrement évident<br />
quand les langues premières du patient et du soignant<br />
diffèrent l’une de l’autre, mais aussi dans des situations plus<br />
ordinaires, où la différence tient alors dans la rupture entre<br />
langue commune et langue de spécialité.<br />
Exemple 1 (voir conventions transcription en fin d’article)<br />
21-Inf <strong>und</strong> die MILCH:::\. wenn die Brust nicht genug(t)<br />
22-P mh mh<br />
23-Inf nicht genugt\. welche Milch wollen Sie geben/.. gleiche<br />
wie hier/... oder andere\. <strong>für</strong> das Kind/. soll ich aufschreiben/.<br />
der NAME der Milch/<br />
(P-mabi010205a)<br />
Ce petit échange entre l’infirmier et le patient, sous son apparente<br />
banalité, montre le recours à au moins quatre stratégies<br />
particulières concourant à la négociation du sens:<br />
accentuation prosodique en 21 et 23: les mots «Milch» et<br />
«Name» sont mis en évidence, car ils constituent des noyaux d’information,<br />
le second constituant un développement du premier;<br />
répétition: le terme «Milch» apparaît à trois reprises et donnent<br />
plusieurs chances de saisie du sens ou, au moins, du thème de<br />
l’échange;<br />
report en fin d’énoncé en 23: le mot «Milch» est repris en fin<br />
d’énoncé, ce qui en renforce la disponibilité pour l’interlocuteur,<br />
particulièrement sensible au début et à la fin des prises de parole;<br />
passage à l’écrit: le soignant propose au patient d’écrire le<br />
nom du lait, ce qui peut non seulement faciliter la compréhension<br />
<strong>im</strong>médiate (on saisit parfois plus vite le nom d’une marque<br />
que le produit auquel elle renvoie), mais aussi permettre une<br />
communication plus facile, ultérieurement, lors de l’achat du<br />
produit.<br />
Dans le déroulement de la communication, le soignant n’a pas<br />
forcément conscience de cette richesse stratégique qui correspond<br />
le plus souvent, à ses yeux, à une empathie somme toute<br />
bien naturelle, non attribuable à une compétence professionnelle<br />
particulière.<br />
Exemple 2<br />
139-Sf on n’a pas . aidé/. il est sorti tout seul on n’a pas aidé<br />
avec euh . une ventouse ou quelque chose/<br />
140-P euh oui: non pas avec une ventouse<br />
141-Sf les forceps/<br />
142-P av- avec<br />
143-Sf comme une sorte de cuillère/<br />
144-P non non non . sans: sans .. without tools<br />
145-?M (XXX)<br />
146-P ça a été naturel mais mais . ils ont donné quelque<br />
chose<br />
147-Sf mh mh<br />
148-P un (XXX)<br />
149-Sf oui<br />
150-P mais ça a été naturel<br />
151-Sf d’accord\. ils ont juste mis une perfusion pour [que ça<br />
aille plus vite<br />
152-P [oui oui . oui oui\. c’est: c’est tout<br />
(P-mage220605a)<br />
Ce deuxième exemple montre aussi comment s’élabore progressivement<br />
le sens entre un soignant et un patient. Les<br />
différentes formulations et reformulations montrent bien le<br />
caractère non francophone de la patiente, mais peuvent aussi<br />
s’appliquer en bonne partie à la relation générale entre un patient<br />
et un soignant, dans la mesure où est en jeu le lexique<br />
spécialisé.<br />
En parlant du précédent accouchement de sa patiente, la sagefemme<br />
amène ainsi le terme «ventouse», qu’elle rapporte<br />
tout de suite à une catégorie qui demeure <strong>im</strong>plicite («quelque<br />
chose [comme]»). Le double enjeu de la séquence se situe<br />
précisément ici, autour de mots particuliers, d’une part,<br />
et autour d’un problème plus général de placement du soignant<br />
par rapport au patient (territoire médical ou privé), d’autre<br />
part. Après le terme «ventouse» apparaît celui de «forceps»,<br />
qui semble poser problème à la patiente (142) et que la sagefemme<br />
reformule en termes ordinaires en 143 («comme une<br />
sorte de cuillère»). Le passage à l’anglais du tour de parole<br />
suivant («without tools») déplace l’attention d’un problème<br />
linguistique particulier à un aspect plus général du sens, qui insiste<br />
sur la naturalité de l’accouchement précédent (146,150).<br />
La description de l’accouchement s’appuie donc non plus sur<br />
sa médicalisation, comme tend à le faire la sage-femme, mais<br />
sur son absence d’instrumentalisation. A «naturel» s’oppose<br />
toutefois «quelque chose» (146), dont le caractère flou finit<br />
par se résoudre grâce à une nouvelle participation de la sagefemme<br />
en 151 qui propose, selon les indications fournies,<br />
le terme de «perfusion», compatible à la fois avec «without<br />
tools», «naturel» (surtout à travers «juste») et «ils ont donné<br />
quelque chose», terme ratifié par la patiente en 152.<br />
Cet exemple montre bien les deux perspectives du patient et<br />
du soignant dans l’interaction, mettant en jeu deux univers<br />
(l’hôpital et la sphère privée ou sociale), deux répertoires langagiers<br />
(code spécialisé et code commun) et, dans le cas des<br />
patients migrants, deux langues premières différentes. Ce<br />
troisième aspect prolonge et tout à la fois met en évidence les<br />
deux premiers. Nous y reviendrons.<br />
Dans les l<strong>im</strong>ites de cette étude, nous nous intéressons avant<br />
tout au travail des soignants et montrons délibérément d’abord<br />
leurs stratégies de mise à disposition et/ou de négociation du<br />
sens. Ces stratégies demandent aussi la participation du patient,<br />
quand ce n’est pas lui qui les initie pour résoudre un<br />
problème de communication. Cependant, il faut remarquer la<br />
particulière disponibilité des soignants pour la communication,<br />
la richesse de leurs outils manifestant un aspect de leur compétence<br />
professionnelle.<br />
Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse que la compétence<br />
transculturelle se situe à l’intérieur d’une compétence générale<br />
d’interaction ou de communication, dont elle révèle mieux<br />
certaines composantes. Maîtriser une compétence transculturelle<br />
revient donc non seulement à connaître plusieurs «codes»<br />
culturels et linguistiques, mais à comprendre ce qui fait la<br />
richesse et la complexité de la compétence de communication<br />
tout court, notamment dans les trois composantes suivantes:<br />
composante encyclopédique ou socioculturelle: la communication<br />
ne peut fonctionner avec succès sans un min<strong>im</strong>um<br />
de savoirs à propos du rôle du culturel dans l’interaction, du<br />
phénomène d’altérité et des processus d’acculturation, ainsi<br />
que de savoirs sur la maladie, sur la thérapie, ainsi que la<br />
27