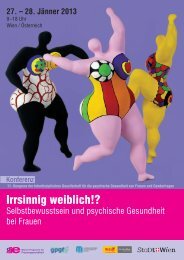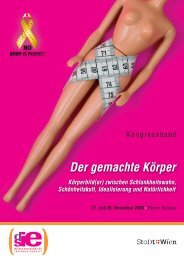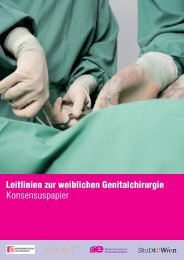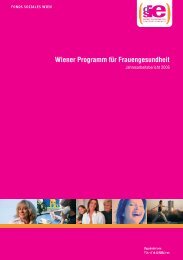Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1 Introduction<br />
L’issue de la grossesse dans les collectivités migrantes a reçu<br />
une attention <strong>im</strong>portante de la part de la communauté scientifique,<br />
car elle fait référence à une situation concrète concernant<br />
les enfants, individus les plus fragiles de la société. En<br />
principe, l’hypothèse de référence est que les femmes migrantes<br />
sont en bonne santé et que leur interaction avec les systèmes<br />
de santé de pointe, disponibles dans les pays d’accueil<br />
occidentaux, devrait conduire à des grossesses aussi réussies<br />
en termes sanitaires que celles des femmes natives du pays.<br />
En fait, une telle hypothèse est remise en question dans différents<br />
pays ou au sein d’un même pays pour des groupes ethniques<br />
spécifiques, en relation avec les barrières linguistiques<br />
et culturelles, les connaissances et la compréhension parfois<br />
réduites du système de soins et avec tout ce qui se réfère aux<br />
comportements de santé et aux inégalités socio-économiques,<br />
sinon aux discr<strong>im</strong>inations avérées au sein de la société (Bollini<br />
et Siem 1995; Bender et al. 1993). Ce résultat suggérerait dès<br />
lors une expérience migratoire et d’intégration qui varie d’un<br />
pays à l’autre (Bollini et Siem 1995).<br />
Les pays d’accueil ont montré différentes attitudes concernant<br />
l’<strong>im</strong>migration et plus spécifiquement concernant la santé et le<br />
bien-être des communautés migrantes (Bollini 1993). Bien qu’il<br />
soit difficile d’effectuer un tour d’horizon généralisé, on peut<br />
mettre en évidence les pays ayant adopté une attitude passive,<br />
où les migrants sont supposés s’adapter aux institutions<br />
du pays d’accueil, et les pays ayant une attitude plus active,<br />
où différentes mesures sont introduites pour prendre en considération<br />
les spécificités culturelles et les besoins spécifiques<br />
qui en résultent. Cette deuxième approche conduit à deux<br />
types de politiques sociales, qui peuvent être appliquées soit<br />
de manière isolée, soit ensemble: 1) les politiques ethniques<br />
de santé qui se concentrent sur un accès croissant aux soins,<br />
et en particulier sur l’amélioration de la communication entre<br />
les patients et les fournisseurs de services de soins, et 2) les<br />
politiques d’intégration qui visent une participation sociale<br />
accrue et une intégration des communautés migrantes dans<br />
le pays d’accueil, pour réduire les problèmes psychosociaux<br />
liés à la vie dans une pauvreté relative et à l’exclusion de la<br />
participation sociale. Jusqu’à présent, l’<strong>im</strong>pact des politiques<br />
d’intégration et des politiques ethniques de santé sur la santé<br />
des collectivités migrantes, et plus particulièrement sur les<br />
suites de la grossesse, n’a pas été étudié par une approche<br />
comparative.<br />
Dans la présente étude, nous abordons la problématique de la<br />
santé reproductive des femmes migrantes en adoptant trois<br />
approches distinctes: 1) le rôle des politiques d’intégration et<br />
de santé, spécifiques aux migrants, est étudié par une étude<br />
comparative européenne, 2) la situation suisse et les différences<br />
de risque observées, pour plusieurs indicateurs, sont<br />
analysées en fonction de la nationalité, et 3) les facteurs intervenant<br />
sur la grossesse et ses suites sont explorés dans deux<br />
communautés de femmes migrantes en Suisse.<br />
2 Déroulement de l’étude / méthode<br />
2.1 Etude 1 – Revue de la littérature internationale<br />
Toutes les études épidémiologiques (abordant une approche<br />
cas-témoin, longitudinale ou transversale) menées dans les<br />
pays européens depuis 1966 jusqu’en juin 2004 comparant par<br />
différents indicateurs l’issue de la grossesse de femmes migrantes<br />
et de femmes natives ont constitué la source de cette<br />
méta-analyse. Dans le but d’identifier ces études, on a eu recours<br />
à la base de données Medline, en utilisant les mots-clés<br />
suivants: emigration and <strong>im</strong>migration, ethnic groups, infant<br />
mortality, fetal death, infant, newborn, diseases, pregnancy<br />
complications, pregnancy outcome. En outre, une recherche<br />
complémentaire a été effectuée avec le terme «foreigner»,<br />
traduction anglaise du mot «Ausländer», fréquemment utilisé<br />
dans la littérature germanophone lorsqu’il est question<br />
de migrants. Le taux de naturalisation des migrants (comme<br />
indicateur de l’intégration) et la présence d’une politique ethnique<br />
de santé qui favorise l’accès aux soins (en particulier<br />
l’amélioration de la communication par la création de services<br />
d’interprètes) ont été analysés pour chaque pays. On a étudié<br />
la corrélation entre l’issue de la grossesse, les facteurs de risque<br />
et les politiques d’intégration et de santé par le biais de<br />
différents modèles de régression logistique.<br />
2.2 Etude 2 – Analyse des données existant en Suisse sur<br />
la mortalité infantile et la santé reproductive<br />
La statistique des naissances enregistre depuis 1876<br />
l’ensemble des naissances vivantes survenues en Suisse.<br />
Depuis 1969, ces données figurent dans le registre informatisé<br />
des naissances (BEVNAT). Les décès d’enfants, issus du<br />
registre des décès de l’état civil, sont également disponibles<br />
sous forme informatique depuis la même année. La population<br />
incluse dans l’enregistrement regroupe l’ensemble des personnes<br />
domiciliées en Suisse, quel que soit le statut de séjour.<br />
Les données des registres de l’état civil fournissent différentes<br />
informations: les dates de naissance de l’enfant et des parents<br />
(de la mère uniquement en cas de naissance hors mariage et<br />
en cas de décès d’enfant au cours de la première année de<br />
vie), le lieu de domicile de la mère au moment de la naissance,<br />
la nationalité de l’enfant (en cas de décès) et des parents (au<br />
moment de la naissance). Le rang de naissance est également<br />
disponible dans le fichier des naissances vivantes. On fait généralement<br />
l’hypothèse que la nationalité de la mère est un<br />
meilleur indicateur du risque de décès de l’enfant: on a fait<br />
un appariement entre le registre des naissances vivantes (qui<br />
fournit la nationalité de la mère) et le registre des décès (qui informe<br />
uniquement sur la nationalité de l’enfant), pour les naissances<br />
entre 1987 et 1996, pour lesquelles on dispose de suffisamment<br />
de variables non modifiables permettant d’attribuer<br />
à chaque décès d’enfant la naissance correspondante. On a<br />
considéré cinq indicateurs: faible poids de naissance (