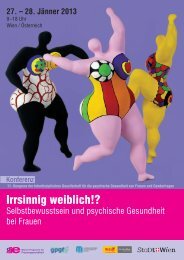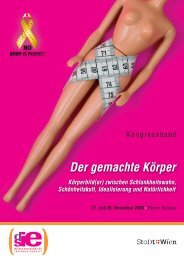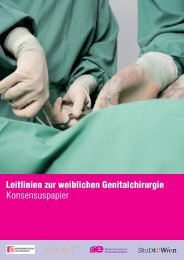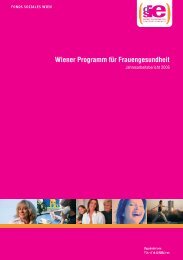Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
Forschung Migration und Gesundheit im Rah - Bundesamt für ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
connaissance du monde hospitalier; plus l’écart socioculturel<br />
entre les protagonistes est <strong>im</strong>portant, moins ce savoir est supposé<br />
partagé et agit de manière <strong>im</strong>plicite, plus on peut qualifier<br />
la relation d’interculturelle;<br />
composante interactionnelle: les modalités d’interaction<br />
(prises de parole, gestion des silences, gestion de l’asymétrie,<br />
etc.) et d’interprétation conditionnent le déroulement de la<br />
communication et peuvent admettre des variations d’ordre<br />
culturel;<br />
composante stratégique: elle correspond à une sorte de<br />
«roue de secours», qui se met en marche en cas de difficulté<br />
communicative ou de défaillance des moyens usuels; elle<br />
permet le maintien de la communication indépendamment de<br />
l’inégalité de l’accès aux savoirs linguistiques et s’avère particulièrement<br />
précieuse dans la communication interculturelle.<br />
Cette dernière revêt un caractère central dans la gestion<br />
de la communication problématique, mais est facilitée en<br />
l’occurrence par la deuxième qui, en milieu hospitalier, attribue<br />
des rôles relativement clairs aux acteurs et leur permet<br />
d’entrer dans une relation de type didactique. Le patient a<br />
le droit de ne pas savoir, le soignant doit l’aider. Au niveau<br />
linguistique, le même schéma est activé. On peut même se<br />
demander si l’asymétrie linguistique, très saillante dans la relation,<br />
ne facilite pas la didacticité et, d’une certaine manière, le<br />
ménagement de la face du patient.<br />
Ainsi, le soignant met en place des stratégies de réalisation<br />
de l’activité qui fonctionnent souvent à titre préventif. Quand<br />
la difficulté linguistique se fait plus présente, ces stratégies<br />
se muent alors en stratégies de résolution de problèmes, à<br />
l’aspect plus bricolé et moins professionnel. Pourtant, ces<br />
stratégies relèvent d’un même mécanisme.<br />
Exemple 3<br />
19-Sf c’est au niveau du bébé/. ou c’est [au niveau de<br />
vous/<br />
20-P [non non . c’e:::st: c’est de moi<br />
21-Sf de vous\. d’accord\. au niveau du COL/<br />
22-P (2,5 secondes) . euh . non c’est dans<br />
23-T vana<br />
24-P vana<br />
25-Sf au niveau vaginal<br />
26-P oui [oui&<br />
27-Sf [d’accord<br />
28-P &oui oui<br />
29-Sf et ça: et vous avez mal/. en bas/<br />
30-P oui . c’est tou:::t eu:::h …<br />
31-Sf alors c’est comme une infection/<br />
[…]<br />
46-Sf [d’accord\... vingt-sept juillet (XXX) (chuchote en écrivant,<br />
incompréhensible) (env. 25 secondes) et donc<br />
depuis hier vous avez mal au ventre . c’est ça/<br />
(P-mage220605a)<br />
Dans cette séquence, la sage-femme se trouve face à une patiente<br />
israélienne et déclenche un guidage de la compréhension<br />
au moyen de stratégies de réalisation de son activité. L’une<br />
de ses stratégies consiste en un ciblage progressif du lieu de<br />
la douleur et, partant, de l’objet de discours. Il s’agit dans un<br />
premier temps de savoir si l’on parle du bébé («au niveau du<br />
bébé» en 19) ou de la maman («au niveau de vous»). Ensuite,<br />
il faut identifier le siège morphologique précis de la douleur.<br />
28<br />
La sage-femme, plutôt que de poser une question ouverte à<br />
la patiente (du type «où avez-vous mal?»), recourt à une question<br />
fermée en faisant une proposition («au niveau du COL» en<br />
21). L’emphatisation de «col» laisse déjà présager une définition<br />
exolingue de la situation, la soignante tentant de détacher<br />
les éléments centraux de son message. Cela se confirme par<br />
l’incapacité de la patiente à trouver le mot désignant le siège<br />
de sa douleur (22) sans l’aide de la traductrice (23).<br />
Des stratégies de planification (réalisation de l’activité), l’on<br />
passe de cette façon insensiblement à des stratégies de résolution<br />
de problèmes de communication. Le lieu de la douleur<br />
étant identifié mais les termes pour en parler faisant défaut,<br />
la sage-femme semble revenir à un degré moindre de précision,<br />
en recourant aux termes «en bas» en 29 et «au ventre»<br />
en 46.<br />
Ce basculement de stratégies, sans doute peu perceptible sur<br />
le moment, relève pourtant d’une compétence communicationnelle<br />
et professionnelle remarquable. Si les stratégies de<br />
planification sont davantage préformatées et liées par exemple<br />
à la capacité à mener une consultation ou une anamnèse,<br />
les stratégies de résolution de problèmes de communication,<br />
bien que davantage <strong>im</strong>provisées voire «bricolées», témoignent<br />
d’une capacité à gérer la distance linguistique avec la priorité<br />
de ne pas renoncer à établir l’intercompréhension autour des<br />
objets centraux des soins. Ces secondes stratégies, souvent<br />
acquises sur le tas, pourraient tout à fait donner lieu à une<br />
forme d’enseignement ou de préparation. Elles demandent<br />
pour cela à être explicitées et valorisées. Malheureusement,<br />
bien souvent, elles induisent des représentations plutôt négatives<br />
dans les discours des soignants eux-mêmes.<br />
3.2 Du patient migrant au patient «ordinaire»: communication<br />
et action professionnelle<br />
Le passage très ténu entre les stratégies de planification et<br />
les stratégies de résolution de problèmes démontre d’une<br />
certaine manière la continuité entre le traitement d’un patient<br />
catégorisé comme migrant et celui d’un patient «ordinaire»<br />
(différence de degré et non de nature). Dans les deux cas, le<br />
médecin ou l’infirmière dirige l’interaction, la formate en fonction<br />
d’un objectif relativement précis et d’un cadre donné. Les<br />
rôles se définissent par contraste et les savoirs sont distribués<br />
de façon inégale. Ce format, ressenti parfois comme rigide,<br />
sert le déroulement des soins et protège d’une certaine façon<br />
le patient, traité, dans sa position «basse», à l’égal des autres<br />
patients.<br />
La prise en charge d’un patient, quel qu’il soit, dépend avant<br />
tout de sa pathologie avérée et de ses conditions d’entrée à<br />
l’hôpital. L’aspect strictement culturel n’apparaît pas comme<br />
prioritairement déterminant, hormis dans certains lieux de<br />
consultation et voies de triage s’adressant exclusivement<br />
aux migrants. Ainsi, une entrée par la voie des urgences, par<br />
exemple, déclenchera un certain scénario indépendamment<br />
des patients et des soignants ou médecins <strong>im</strong>pliqués.<br />
L’aspect culturel se présentera alors souvent à un niveau<br />
méso, intermédiaire entre deux autres niveaux d’organisation<br />
de la prise en charge, macro et micro:<br />
niveau macro: normes de l’institution et de ses services;<br />
scénarios typiques d’action; tâches prescrites;<br />
niveau méso: connaissances encyclopédiques d’un groupe,<br />
d’un lieu, d’une pratique; représentations explicites;<br />
niveau micro: prise en charge effective d’un patient, réalisa-