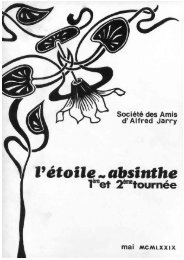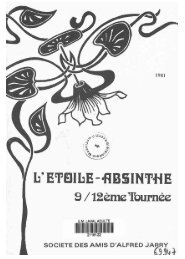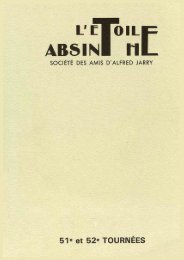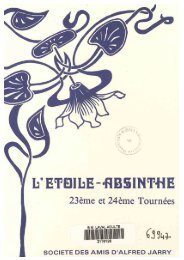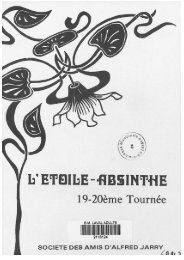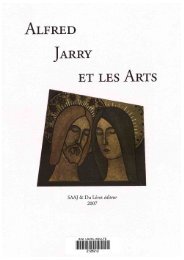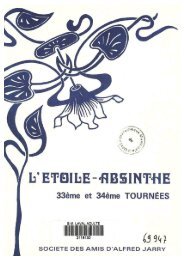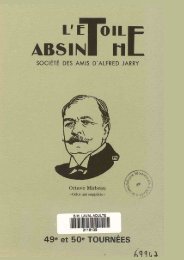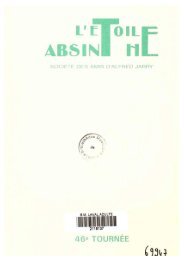103/104 : Colloque 2003, etc. - Société des Amis d'Alfred Jarry
103/104 : Colloque 2003, etc. - Société des Amis d'Alfred Jarry
103/104 : Colloque 2003, etc. - Société des Amis d'Alfred Jarry
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Actes<br />
du colloque <strong>2003</strong><br />
du jeu de mots polysémique typiquement jarryque sur la fente luisante de la<br />
machine renvoie pour sa part à la nature sexuelle <strong>des</strong> enjeux liés au surmâle,<br />
et comme contrepoint de sa virilité exceptionnelle signalée au chapitre II : la<br />
« machine amoureuse » ne fera, à son tour que reprendre ce thème.<br />
Cet épisode me semble tout à fait révélateur <strong>des</strong> rapports complexes et<br />
équivoques que le surmâle entretient avec la science de son époque. Ce rapport<br />
est d'abord un rapport d'opposition et de défi. Dans le premier chapitre,<br />
il en conteste les prémices théoriques, dans celui-ci il en conteste les pratiques<br />
expérimentales, et plus particulièrement exprime le refus, ou l'impossibilité,<br />
d'être mesuré, tant son type particulier de puissance est par nature<br />
incommensurable. Mais on peut aussi prendre les choses de l'autre côté,<br />
et constater que sans cesse, tout au long du roman, le surmâle ne cesse de<br />
se mesurer précisément avec les productions techniques de son époque : le<br />
dynamomètre n'est en ce sens que le premier élément sur la liste d'une série<br />
qui compte une locomotive, un phonographe et une chaise électrique : on ne<br />
sort donc pas si facilement de ce milieu, d'autant moins facilement que c'est<br />
bien dans cet environnement et dans cette science que la question même de la<br />
puissance et de la fatigue trouve son sens.<br />
On pourrait faire la même analyse à propos de la rivalité avec la locomotive<br />
et la quintuplette dans la course <strong>des</strong> dix mille milles : si la machine à<br />
vapeur incarne la métaphore dominante dans la paradigme contemporain et si<br />
la quintuplette incarne le fameux moteur humain (et sa supériorité fantasmée<br />
sur la machine) ainsi que l'ensemble <strong>des</strong> applications scientifiques <strong>des</strong>tinées<br />
à son rendement optimal, la victoire de Marcueil n'en est pas pour autant une<br />
victoire sur ces problématiques, qui définissent malgré tout le champ de son<br />
défi. On pourrait plutôt dire ici que Marcueil incarne précisément la fantasmagorie<br />
de la science dépassant ses propres limites : il est comme une version<br />
de la première loi de la thermodynamique, ou une sorte de néguentropie faite<br />
homme, qui vient certes nier mais aussi transcender les limites de ce à quoi<br />
la science se heurte. Car si l'on regarde d'un tout petit peu plus près ces discours<br />
scientifiques, on peut s'apercevoir que le surmâle y est contenu, comme<br />
un rêve impossible certes, mais aussi comme cette ombre improbable apparue<br />
devant la quintuplette : une sorte de passage en force de la limite que la<br />
science prépare sans pouvoir elle-même l'accomplir, ou d'absolutisation de<br />
ce qu'elle considère comme relatif, selon le raisonnement récurrent qui feint<br />
de ne pas distinguer entre un nombre indéfini et un nombre infini. J'en donnerais<br />
deux exemples : celui d'une dynamogénèse in(dé)finie par la stimulation<br />
sensorielle ou intellectuelle et celui <strong>des</strong> pouvoirs de l'automatisme psychique.<br />
Le premier point est récurrent dans les travaux de Charles Féré, notamment,<br />
Sensation et mouvement : étu<strong>des</strong> expérimentales de psycho-mécaniques<br />
(1897) ou encore le petit opuscule de 1901 : Les Variations de l'excita-<br />
69