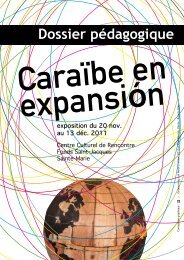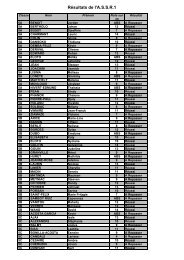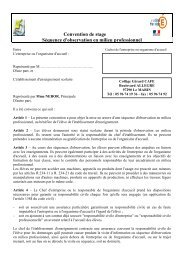fiche-action
fiche-action
fiche-action
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LA COOPÉRATION PARENTS-ENSEIGNANTS À L’ÉCOLE PRIMAIRE<br />
La concurrence éducative entre les parents et les enseignants à l’école primaire<br />
Ce critère de bonne éducation évolue dans le temps. Dans<br />
les années 50, l’enfant idéal était un enfant obéissant ;<br />
dans les années 70, c’était un enfant épanoui ; dans les<br />
années 80 et suivantes, un enfant autonome en<br />
complétant aujourd’hui avec l’élève performant.<br />
Quelques exemples classiques de pratiques éducatives des<br />
familles :<br />
Les enfants des familles démocratiques (entremêlant<br />
affection et autorité) (cf. D. Baumrind) ont de meilleurs<br />
résultats scolaires ; les enfants des familles moyennement<br />
structurées (c’est-à-dire peu rigides) ont un développement<br />
intellectuel supérieur (cf. J. Lautrey) ; les mères les<br />
plus stimulantes sont celles qui restent calmes, s’adaptent<br />
aux compétences de l’enfant et savent réajuster leur<br />
niveau de questionnement (cf. J.-P. Pourtois).<br />
Aujourd’hui, ce qui prévaut c’est le modèle libéral : chaque<br />
élève est pris dans sa spécificité et poussé à l’autonomie.<br />
J’ai réalisé une enquête auprès de 508 parents. Elle montre<br />
que l’opposition sociale la plus nette se fait entre esprit<br />
critique/curiosité d’esprit, d’une part et politesse et bon<br />
travail, d’autre part, sans corrélation avec les performances<br />
réelles de l’enfant. Par exemple, les enfants dont les<br />
parents stimulent le plus l’autonomie sont reconnus par les<br />
enseignants comme étant effectivement les plus autonomes.<br />
Dans les familles populaires, on véhicule l’idéal<br />
d’un élève plutôt passif, c’est-à-dire qui « écoute bien ce<br />
que dit l’enseignant, qui ne se fait pas remarquer ».<br />
Aujourd’hui, les parents des milieux moyens et aisés<br />
négocient de plus en plus souvent avec l’enfant, alors que<br />
jusque dans les années 60, dans ces mêmes milieux c’était<br />
l’autorité et l’obéissance qui étaient de mise. « La<br />
souplesse des pratiques éducatives favorise une bonne<br />
image de soi et l’acquisition du sentiment de<br />
responsabilité vis à vis de ses actes et des événements de<br />
la vie », précise C. Bouissou.<br />
Le point commun de toutes ces études est qu’elles<br />
constatent un net clivage social : les pratiques efficaces se<br />
repèrent majoritairement dans les classes sociales<br />
moyennes ou supérieures. C’est dire qu’à conditions<br />
socio-économiques équivalentes, les principes éducatifs<br />
auxquels se réfèrent les parents exercent une influence<br />
directe sur les performances scolaires de leurs enfants.<br />
Et la question qui se pose naturellement est celle<br />
d’estimer l’impact de ces pratiques éducatives sur la<br />
conduite scolaire de l’enfant. C’est à partir de cette<br />
conduite que les enseignants élaborent des hypothèses sur<br />
les pratiques éducatives supposées des parents.<br />
On pourrait aussi mentionner les pratiques langagières :<br />
quel droit à la parole lorsque l’intérêt de l’enfant porte<br />
sur le contenu et celui de l’enseignant sur la forme ?<br />
On peut retenir qu’il y a des pratiques éducatives en<br />
harmonie ou en opposition avec la demande scolaire.<br />
On peut aussi se demander par quel processus, des<br />
pratiques éducatives parentales peuvent devenir handicapantes,<br />
et pourquoi ne sont-elles pas handicapantes pour<br />
tous les enfants ? L’intervention d’une dimension psychologique<br />
est nécessaire.<br />
Représentations des enseignants<br />
On retrouve chez les enseignants des représentations caricaturales<br />
et schématiques de l’éducation donnée par les<br />
parents, induites de ce qu’ils perçoivent chez leurs élèves :<br />
façons de s’exprimer, de se conduire ou de s’habiller…<br />
C’est souvent négatif.<br />
Quelles sont ces représentations des enseignants sur les<br />
parents et sur leur niveau supposé de compétence ou<br />
d’incompétence éducative ? Qu’est-ce qui dans la dévalorisation<br />
implicite des parents, risque de bloquer la<br />
progres-sion scolaire de l’élève ?<br />
Il ne fait aucun doute que ces représentations jouent un<br />
rôle important sur les performances scolaires de l’enfant.<br />
Un enseignant n’attend pas les mêmes réponses d’un élève<br />
qu’il croit victime de carences éducatives (il n’intervient<br />
pas de la même façon, il ne pose pas les mêmes<br />
questions…), ou qu’il pense avoir des parents<br />
démissionnaires (parce qu’il ne les voit jamais)…<br />
La condescendance peut être nocive car elle conforte<br />
l’enfant dans une représentation défavorisée de lui-même…<br />
Il existe aussi un effet d’étiquetage et d’acceptation de cet<br />
étiquetage par l’élève, par exemple liées à ses origines<br />
sociales.<br />
La représentation que se font les enseignants des parents<br />
et de la culture dispensée à la maison peut influencer des<br />
décisions lourdes de conséquences pour l’enfant.<br />
Trop d’enseignants, parce qu’ils sont des professionnels,<br />
se croient experts en éducation (parce que statutairement<br />
ils sont reconnus comme éducateurs professionnels),<br />
alors même qu’ils n’ont reçu aucune formation à ce sujet ;<br />
mon expérience d’enseignant-formateur à l’IUFM m’a<br />
permis de le vérifier... Pour eux, tout se passe comme si<br />
l’incom-pétence éducative était une propriété intrinsèque<br />
de la parentalité, même lorsque ces parents sont euxmêmes<br />
enseignants ! Il est généralement reproché aux<br />
parents de ne pas assumer leurs responsabilités<br />
éducatives. Et si jamais ils les assument, ils seront accusés<br />
de mal les exercer.<br />
Une enquête d’Éric Debarbieux (1998) portant sur<br />
617 enseignants indique que 70% d’entre eux estiment<br />
que la famille joue moins bien son rôle qu’auparavant ; à<br />
toute époque, on va trouver chez les enseignants l’illusion<br />
d’une carence éducative croissante des parents. À<br />
l’inverse, les enquêtes auprès des parents montrent que<br />
les parents sont plutôt satisfaits des enseignants (un<br />
sondage de Libération, il y a 3 ans, donnait le chiffre de<br />
70% de parents satisfaits).<br />
On a donc une représentation très contrastée. Plusieurs<br />
éléments peuvent l’expliquer :<br />
un enseignant face à un parent pense avoir en vue<br />
l’intérêt objectif de 25 ou 30 élèves ;<br />
toute parole parentale est suspecte d’être entachée de<br />
subjectivité ou de parti-pris ; l’intérêt particulier que les<br />
parents portent à leur enfant les empêche de voir où est<br />
l’intérêt général ;<br />
9