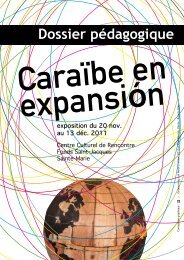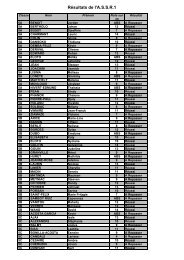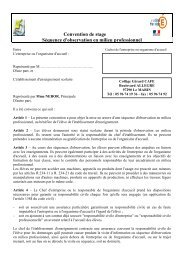fiche-action
fiche-action
fiche-action
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LA COOPÉRATION PARENTS-ENSEIGNANTS À L’ÉCOLE PRIMAIRE<br />
Le rôle des parents dans la socialisation de l’enfant et son intégration à l’école<br />
Le rôle des parents dans la socialisation<br />
de l’enfant et son intégration à l’école<br />
Françoise Hurstel<br />
Professeur de psychologie, psychanalyste<br />
Mon argument est à la fois simple et complexe. Les rôles<br />
et les places des parents et des professionnels de l’enfance<br />
ne sont pas les mêmes pour la socialisation de l’enfant. Ils<br />
sont complémentaires. Mais en quoi sont-ils complémentaires<br />
? Qu’est ce que la socialisation ? Et en quoi<br />
consiste le rôle de chacun, parents et professionnels ?<br />
Selon le grand dictionnaire de la Psychologie, Larousse,<br />
la socialisation se définit ainsi : « les processus<br />
d’adaptation d’un enfant au milieu socio-culturel dans<br />
lequel il est élevé (apprentissage des normes…) ». Ces<br />
processus et ces apprentissages supposent la mise en<br />
œuvre de deux registres distincts. Le premier, du point de<br />
vue du développement de l’enfant, revient aux parents et<br />
le second aux professionnels de l’enfance.<br />
Les rôle et place respectifs des parents<br />
et des professionnels pour la socialisation<br />
Le premier registre est ce qui permet que des apprentissages<br />
se fassent : il est en quelque sorte le substrat à<br />
partir duquel les apprentissages sociaux et les processus<br />
d’adaptation seront possibles. Ce registre est celui selon<br />
lequel un enfant entre dans la vie humaine, devient un<br />
humain et un sujet en s’appropriant langage et culture, en<br />
s’identifiant à son prénom et à son nom. Ce registre est la<br />
base à partir de laquelle se feront les apprentissages ; il est<br />
le moteur qui permettra à l’enfant de se développer.<br />
À cette tâche que j’appelle « les pré-requis » de la<br />
socialisation (par analogie avec les pré-requis de la<br />
lecture par exemple) les parents (qu’ils soient naturels ou<br />
adoptifs et même « famille d’accueil ») sont convoqués.<br />
J’appelle « transmission de la dette de vie » de génération<br />
en génération ce qui permet qu’un enfant entre dans le<br />
registre de l’humanité, du langage et de la culture. Voici<br />
comment Françoise Dolto définissait cette dette qui<br />
revient aux parents : « La vie donnée ne reste humanisée<br />
de génération en génération que si se transmet en même<br />
temps qu’elle une dette »... « Le petit d’homme éprouve<br />
très vite le sentiment que ceux qui lui ont donné la vie ont<br />
contracté une dette à son égard : ce qu’ils lui doivent,<br />
c’est la dette de vie ; en donnant la vie biologique les<br />
parents se sont engagés à délivrer suffisamment de<br />
sollicitude, de limitations, et d’interdits pour qu’il<br />
s’humanise. Ensuite, ils lui transmettront les savoir-faire<br />
nécessaires pour trouver sa place dans l’échange en<br />
société ». Et encore « Si des humains ne viennent pas<br />
appeler cette vie biologique, à s’humaniser, alors c’est<br />
l’autisme ou bien la psychose. Si l’enfant est accueilli par<br />
des loups, il devient un enfant loup. Le seul programme<br />
génétique est incapable d’humaniser la vie. L’humanisation<br />
relève d’un entourage humain, animé par le sentiment<br />
d’une dette dont on doit s’acquitter ». Citations de Pierre<br />
Kammerer dans Adolescents dans la violence, Gallimard,<br />
2000.<br />
Pour résumer le rôle des parents par une formule<br />
emprun-tée encore une fois à Pierre Kammerer, je dirai<br />
que « les parents apprennent aux enfants à désirer selon<br />
les lois humaines ». L’amour et les interdits des parents<br />
sont au service de cette aptitude à désirer selon ces lois.<br />
Le deuxième registre est celui de l’adaptation à la vie<br />
sociale et aux apprentissages, ainsi qu’à l’entrée dans les<br />
savoirs. C’est ce monde que l’enfant devient capable<br />
d’explorer et de s’approprier et c’est plus particulièrement<br />
à ces tâches que les professionnels de l’enfance<br />
sont convoqués. En cela ils prolongent sur un mode<br />
spécifique, le rôle des parents.<br />
Bien entendu, ces distinctions sont schématiques mais<br />
elles marquent bien ce qu’il en est des rôles respectifs<br />
fondamentaux des parents et des professionnels. Elles<br />
sont schématiques en ce que les parents eux aussi permettent<br />
des formes de socialisation et des apprentissages au<br />
sein de la famille. Quant aux professionnels ils sont<br />
confrontés à travers les apprentissages et les savoirs qu’ils<br />
offrent aux enfants, à leur permettre de saisir le sens de<br />
ce qu’est être un petit des hommes et un citoyen.<br />
Pour montrer en quoi la place et le rôle des parents et des<br />
enseignants diffère, je citerai deux exemples vécus.<br />
Ils illustrent ce qu’est cette transmission de la « dette de<br />
vie » par les parents et répondent à deux questions : de quoi<br />
est faite cette dette ? et comment transmettre cette dette ?<br />
Le premier est une anecdote qui m’a été rapportée lors<br />
d’un colloque sur « L’autorité des parents » (Marseille,<br />
2000). Il permet de réfléchir sur la place respective des<br />
parents et des professionnels. C’est une mère qui arrive à la<br />
crèche avec, sous un bras, son enfant de deux ans et dans<br />
l’autre main les chaussures de l’enfant. L’éducatrice les<br />
attend. Elle dit à l’enfant : « Maxime tu sais que tu dois<br />
mettre tes chaussures… ». Ce qu’il fait sur le champ. La<br />
mère demande : « Comment avez-vous fait ? ». Réponse :<br />
« Je lui ai dit de les mettre ».<br />
Le commentaire, à l’époque, avait été « Les parents n’ont<br />
plus d’autorité, les enseignants en ont encore ». Interprétation<br />
avec laquelle je ne suis pas d’accord. Les parents et<br />
les professionnels ne sont pas à la même place par<br />
rapport à l’enfant. La crèche, le jardin d’enfant ou les<br />
écoles maternelles sont des lieux de vie où l’enfant est<br />
confronté à un groupe et a envie de s’y faire admettre.<br />
5