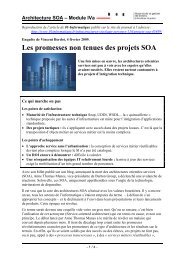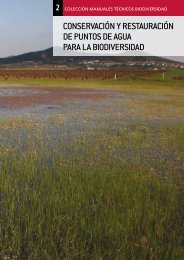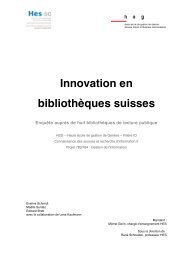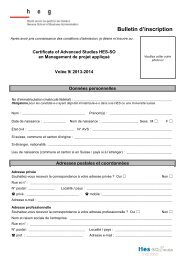Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
si des organismes caractéristiques des mares <strong>temporaires</strong>, en particulier<br />
des crustacés, peuvent s’y développer.<br />
<strong>Mares</strong> d’origine naturelle<br />
Les processus naturels à l’origine des mares sont essentiellement<br />
l’érosion et le colmatage.<br />
L’érosion peut résulter de l’action physico-chimique de l’eau (dissolution<br />
des calcaires pour certaines mares cupulaires ou les poljés,<br />
avec exportation de sédiments), de l’action du vent (exportation de<br />
sédiments fins), de processus géomorphologiques liés à la divagation<br />
des cours d’eau mais aussi de la combinaison de ces différents<br />
processus, éventuellement combinés à l’action de la faune voire de<br />
la flore 49, 263, 380 .<br />
Des colmatages naturels limitant le drainage ou le ruissellement<br />
peuvent contribuer à la création de mares (cas des séries de dépressions<br />
endoréiques* du nord-ouest de Benslimane au Maroc, des mares<br />
sur substrat Permien de la Plaine des Maures). L’origine des mares<br />
<strong>temporaires</strong> a des conséquences importantes sur leur richesse et<br />
leur fonctionnement, en particulier sur leur fonctionnement hydrologique<br />
(Chapitre 3b) et sur les connexions potentielles entre populations<br />
de plantes ou d’animaux (Chapitre 3f).<br />
Encadré 5. Les mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes en<br />
France<br />
Un premier inventaire, réalisé en 2003 en région méditerranéenne<br />
française 391 , a permis d’identifier 106 sites représentant<br />
plus de 900 mares <strong>temporaires</strong>, la majorité relevant de l’habitat<br />
3170 “mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes”. Quelques mares<br />
<strong>temporaires</strong> méditerranéennes se rencontrent au nord de la région<br />
méditerranéenne (Poitou-Charente notamment).<br />
On distingue trois grands types de mares en fonction du substrat<br />
260 :<br />
• les mares <strong>temporaires</strong> saumâtres des zones humides littorales :<br />
Camargue, Basse Crau, marges littorales du Languedoc, Corse,<br />
• les mares <strong>temporaires</strong> aux eaux assez richement minéralisées,<br />
le plus souvent sur substrat calcaire. Ce sont les mares des garrigues<br />
languedociennes (garrigues du Montpelliérain ou de<br />
l’Uzégeois, la Gardiole, causses méridionaux), et, en Provence, la<br />
mare de l’Estagnolet à La Barben, la mare du plateau de Cengle,<br />
et les mares du centre-Var,<br />
• les mares <strong>temporaires</strong> dulçaquicoles*, aux sols généralement<br />
superficiels, de texture sableuse ou limoneuse, pauvres en humus,<br />
de pH acide ou faiblement basique. Dans la Région Provence-<br />
Alpes-Côte d’Azur, on trouve d’est en ouest : les massifs de Biot,<br />
de l’Esterel, de la Colle du Rouet, la plaine de Palayson, la plaine<br />
des Maures et la plaine de Crau. Dans le Languedoc-Roussillon, on<br />
rencontre d’est en ouest : l’étang de Capelle, la Costière nîmoise,<br />
la région d’Agde, le plateau basaltique de Pézenas, la plaine de<br />
Béziers, les plateaux de Roque-Haute et de Vendres, les mares de<br />
Saint-Estève et du plateau de Rodès. En Corse, du nord au sud,<br />
s’échelonnent les mares du Cap Corse, des Agriate, du littoral du<br />
sud-ouest, de Porto-Vecchio et de Bonifacio.<br />
Bien qu’elles totalisent une surface très réduite (sans aucun<br />
doute moins de 1 000 ha), les mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes<br />
abritent, en France, plusieurs centaines d’espèces végétales<br />
(Chapitre 2b), 14 espèces d’amphibiens (Chapitre 2c), 18 espèces<br />
de crustacés anostracés (Chapitre 2d) et de nombreuses espèces<br />
d’insectes (Chapitre 2e).<br />
Yavercovski N., M. Cheylan & A. Thiéry<br />
2. Biodiversité et enjeux de conservation<br />
Un grand nombre de types de mares naturelles peuvent être distingués<br />
selon leur origine. Quelques-uns, caractéristiques, sont décrits<br />
ci-dessous.<br />
<strong>Mares</strong> cupulaires<br />
Ces mares de petite taille (quelques décimètres carrés à quelques<br />
mètres carrés) et de bassin versant très réduit, (Encadré 7) sont<br />
creusées par l’érosion dans des blocs de roche dure ou des dalles<br />
rocheuses. Leur alimentation en eau est exclusivement pluviale. La<br />
dessiccation de leurs sédiments est extrême en phase sèche. Ces<br />
cupules se caractérisent par une faible épaisseur de sol et par une<br />
Encadré 6. Les dayas du Maroc<br />
Le Maroc est considéré comme le premier pays à l’échelle du<br />
Bassin méditerranéen pour sa richesse en mares <strong>temporaires</strong>,<br />
appelées localement dayas. Elles sont largement représentées<br />
sur l’ensemble du territoire avec une fréquence faible à l’est, au<br />
sud et dans les hautes altitudes, et élevée dans la zone côtière<br />
ouest de Tanger à Tiznit. La durée de submersion diminue du<br />
nord (six à huit mois) au sud (un à deux mois) et d’ouest en est.<br />
D’un point de vue biogéographique, on observe une dominance<br />
très nette des espèces méditerranéennes et des espèces cosmopolites,<br />
alors que les taxons atlantiques sont peu représentés.<br />
Au Maroc, la grande diversité des situations climatiques, géologiques<br />
et géomorphologiques est à l’origine d’une variété remarquable<br />
de dayas. Les travaux réalisés sur les crustacés par Ramdani318 et Thiéry380 ont permis de distinguer quatre ensembles principaux<br />
de dayas :<br />
• Dayas des plateaux orientaux arides près de la frontière algérienne<br />
et des zones sahariennes au sud et de l’Atlas : localisées<br />
sur des plaines d’altitude de 900 à 1 400 m qui reçoivent moins<br />
de 200 mm d’eau par an irrégulièrement répartis, leur durée<br />
d’inondation est de quinze à soixante-quinze jours et elles peuvent<br />
rester sèches pendant plusieurs années. Elles sont peu profondes<br />
et ont, pour la plupart, une origine naturelle.<br />
• Dayas des plaines internes arides (Jbilets et le Haouz de Marrakech)<br />
: localisées sur des plaines sous bioclimat aride de 300 à<br />
1 000 m d’altitude recevant 200 à 400 mm d’eau par an, leur<br />
durée d’inondation est de deux à quatre mois. Leur substrat est<br />
schisteux et donne, par altération, un sol argileux.<br />
• Dayas des plaines côtières atlantiques (Gharb, Rabat avec la<br />
Suberaie de Mamora, la région de Benslimane, de Casablanca<br />
jusqu’à Settat et Essaouira) : dans les plaines atlantiques de basse<br />
altitude (< 500 m) sous bioclimat subhumide et semi-aride,<br />
recevant 400 à 800 mm d’eau par an, ces dayas ont une durée<br />
d’inondation comprise entre cinq et sept mois. Leur sol est soit<br />
hydromorphe sur un substrat gréseux ou schisteux (dayas de<br />
Benslimane), soit sableux sur un plancher argileux imperméable<br />
(dayas de Mamora).<br />
• Dayas de montagnes (Moyen Atlas, Haut Atlas, Rif) : elles se<br />
localisent sur les hautes altitudes (> 2 000 m) sous bioclimat<br />
humide et reçoivent plus de 800 mm d’eau par an directement<br />
par les eaux de pluies et indirectement par la fonte des neiges.<br />
Leur durée d’inondation et de trois à six mois. Leur substrat est<br />
basaltique, calcaire dolomitique ou gréseux rouge du Permotrias.<br />
Rhazi L.<br />
15