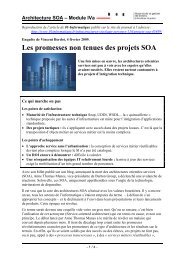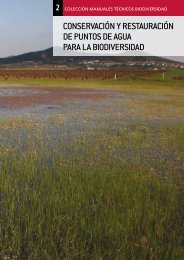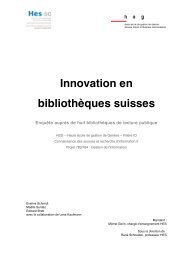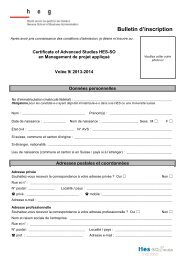Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ou celles qui doivent nécessairement y accomplir une partie de leur<br />
cycle.<br />
La connaissance de la biologie des populations et l’évaluation de<br />
leur diversité génétique sont indispensables pour leur gestion et leur<br />
conservation à long terme. Il est généralement accepté que la capacité<br />
d’adaptation des populations est liée à leur diversité génétique.<br />
Inversement et paradoxalement, une bonne adaptation locale à des<br />
milieux extrêmes peut aussi avoir comme conséquence une diminution<br />
de leur diversité génétique. Pour évaluer la diversité génétique<br />
des populations d’une espèce, plusieurs paramètres clés sont à<br />
prendre en compte : l’histoire des populations, leur taille, leur degré<br />
d’isolement, le système de reproduction (auto ou allogamie*), la<br />
nature des flux de gènes et l’existence d’adaptations locales.<br />
Une hiérarchisation des populations en fonction de leur niveau d’intérêt<br />
peut s’avérer nécessaire pour orienter le choix des gestionnaires<br />
vers telle ou telle population lorsque toutes, par exemple, ne<br />
peuvent pas faire l’objet de mesures conservatoires. Les biologistes<br />
de la conservation ont donc créé, dans les années 1980, la notion<br />
d’unité évolutive d’intérêt (Evolutionary Significative Unit ou ESU) :<br />
unité population qui mérite une gestion particulière et une haute<br />
priorité de conservation, sur la base d’une variation adaptative déterminée<br />
sur des données écologiques et/ou génétiques 94 .<br />
Des populations souvent petites et isolées<br />
La probabilité d’extinction est plus grande dans les populations de<br />
petite taille, et, plus particulièrement, dans un environnement fluctuant<br />
comme les mares <strong>temporaires</strong>. Dans ces milieux, les populations<br />
sont souvent détruites totalement ou partiellement, par<br />
exemple par un assèchement ou une inondation précoce (cas du<br />
Triton crêté, Encadré 26), avant qu’elles n’aient pu accomplir leur<br />
cycle de reproduction.<br />
Dans les populations de petite taille, l’augmentation de la consanguinité<br />
(dérive génétique) peut aboutir à l’accumulation de mutations<br />
défavorables, susceptibles de conduire à leur extinction. Elle<br />
s’accompagne généralement d’une diminution de la capacité d’adaptation<br />
(valeur sélective) des individus.<br />
La faible taille des populations constitue donc un risque pour les<br />
espèces du fait du risque aléatoire d’extinction lié aux fortes fluctuations<br />
environnementales et de la réduction des capacités d’adaptation<br />
due à la consanguinité. Certaines caractéristiques biologiques<br />
des espèces comme le système de reproduction (autogamie*/allogamie*),<br />
la dispersion (du pollen et des semences) ou l’importance<br />
du stock semencier pour les plantes, peuvent accentuer ou atténuer<br />
ce risque.<br />
Conséquences de l’isolement pour la reproduction<br />
et pour la dispersion<br />
L’isolement et la petite taille des populations imposent des contraintes<br />
fortes pour leur dynamique. Pour les individus, les enjeux<br />
sont de laisser des descendants susceptibles de maintenir la population<br />
et de les disperser dans plusieurs sites pour éviter les risques<br />
d’extinction locale accidentelle.<br />
La reproduction sexuée représente un coût 286 dans la contrainte de<br />
la recherche de partenaires et du fait de la transmission d’une seule<br />
copie de ses propres gènes. En contrepartie, elle réduit la dépression<br />
3. Fonctionnement et dynamique de l’écosystème et des populations<br />
Encadré 27. Les paradoxes de l’Armoise de Molinier<br />
L’Armoise de Molinier (Artemisia molinieri) est une espèce rare,<br />
endémique de trois mares <strong>temporaires</strong> du Var et décrite comme<br />
en danger d’extinction 285, 261 . Les deux principales populations<br />
d’Armoise sont localisées dans les lacs <strong>temporaires</strong> de Gavoty<br />
(Besse-sur-Issole) et de Redon (Flassans-sur-Issole), inclus dans<br />
le projet LIFE “<strong>Mares</strong> Temporaires”.<br />
Torrel et al. 389 ont réalisé une étude écologique et génétique sur<br />
les deux principales populations d’Armoise de Molinier visant à<br />
évaluer les risques encourus par cette espèce et à proposer des<br />
mesures de conservation. Les résultats étaient les suivants :<br />
• Dans les deux sites, l’Armoise est très abondante (quelques<br />
milliers d’individus) et représente l’espèce dominante.<br />
• La diversité génétique est élevée et inattendue chez une plante<br />
à distribution géographique aussi restreinte. De plus, aucun<br />
déséquilibre génétique (dérive) n’a été mis en évidence.<br />
• Les deux populations, distantes de 4 km, sont très peu différenciées<br />
génétiquement ce qui indiquerait l’existence de flux de<br />
gènes (échanges de pollen ou de graines) entre elles ou un isolement<br />
récent.<br />
• Le taux de viabilité du pollen (10 % à Redon et 30 % à Gavoty)<br />
et celui de germination des graines (4 % et 14 % respectivement)<br />
sont peu élevés dans les deux populations. La faible fertilité<br />
de la population de Redon peut, en partie, être liée à la<br />
contamination des capitules par un champignon et aux conditions<br />
environnementales (forte concentration de nutriments, inondations<br />
irrégulières, impact anthropique, pâturage, etc.).<br />
Dans ces conditions, l’Armoise se propagerait donc essentiellement<br />
par voie végétative grâce à un vigoureux système de stolons. Le<br />
taux de reproduction sexuée bas semble suffisant pour maintenir<br />
des populations denses et une diversité génétique importante.<br />
Torrel et al. 389 ont conclu que les principales mesures de conservation<br />
devaient consister en un maintien en l’état des deux lacs<br />
(statut légal de protection et/ou acquisition par une institution<br />
publique) associé à une surveillance continue des populations.<br />
En 2000, la moitié du Lac Redon a été labouré, détruisant une<br />
partie de la population d’Armoise et permettant l’expression d’espèces<br />
à forte valeur patrimoniale comme Lythrum tribracteatum,<br />
Damasonium polyspermum et Heliotropium supinum 1 . Ce lac est<br />
pâturé avec 200 ovins en parcours extensif.<br />
Finalement, l’Armoise de Molinier présente le paradoxe d’être<br />
une espèce rare avec un comportement d’espèce dominante et<br />
exclusive : le devenir des autres espèces sous couvert de l’Armoise<br />
est incertain. Compte tenu de son niveau d’endémisme élevé,<br />
l’Armoise représente un enjeu de conservation prioritaire par<br />
rapport aux espèces, également protégées mais beaucoup moins<br />
rares, dont elle partage l’habitat.<br />
Gauthier P., D. Rombaut & P. Grillas<br />
Artemisia molinieri, une espèce endémique mais dominante au lac<br />
Redon (Var, France)<br />
Roché J.<br />
55