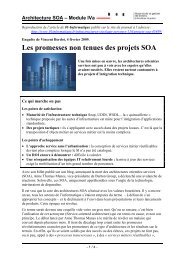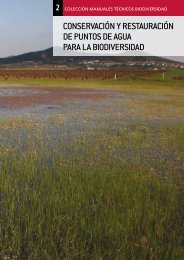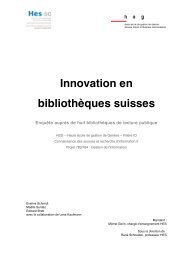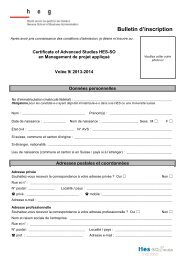Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cependant, une évaluation systématique de l’importance des facteurs<br />
de perturbations les plus fréquents est nécessaire. Elle pourra<br />
être faite à partir d’indicateurs d’impact évaluant l’état des populations<br />
et des communautés, et d’indicateurs du fonctionnement<br />
du milieu physique qui apporteront souvent des informations sur<br />
les causes et les mécanismes du dysfonctionnement.<br />
Indicateurs d’impact<br />
Le dysfonctionnement d’une mare temporaire sera soupçonné lorsque :<br />
• la taille des populations d’une ou plusieurs espèces caractéristiques<br />
(animale ou végétale) diminue,<br />
• des communautés d’espèces ou des espèces caractéristiques<br />
disparaissent et/ou sont remplacées par d’autres (progression des<br />
grandes hélophytes* et des arbres, augmentation des algues, etc.),<br />
• des espèces typiques de conditions écologiques différentes coexistent<br />
avec les espèces caractéristiques des mares <strong>temporaires</strong>.<br />
L’hypothèse d’un dysfonctionnement pourra découler d’une étude<br />
historique établissant des changements d’état dans le temps et/ou<br />
d’une comparaison avec des milieux similaires (richesse en espèces,<br />
en groupes d’espèces, abondance d’espèces particulières, etc.).<br />
Cette analyse doit impérativement prendre en compte les fluctuations<br />
normales des populations, notamment sous l’effet des conditions<br />
météorologiques. L’interprétation des données sera facilitée<br />
par des références : données antérieures sur le même site et dans<br />
les mêmes conditions climatiques, ou observations sur d’autres sites<br />
pertinents (les fluctuations ne sont pas nécessairement synchrones<br />
entre sites). La comparaison entre l’état actuel et les données<br />
anciennes devra être prudente et tenir compte de possibles différences<br />
de méthodes et d’objectifs.<br />
Le déclin d’une espèce peut non seulement être lié à la disparition de<br />
son habitat, mais aussi à d’autres facteurs comme l’apparition d’un<br />
nouveau prédateur, des problèmes de reproduction (prédation des<br />
semences ou des œufs, stérilité, consanguinité, etc.) qui n’ont pas<br />
nécessairement de lien avec l’habitat. Le diagnostic sur une espèce<br />
pourra donc amener à des recherches plus poussées sur sa biologie.<br />
Lorsque des dysfonctionnements sont confirmés ou probables, leurs<br />
causes doivent être recherchées. Des hypothèses, généralement<br />
multiples au départ, sont émises. Dans le cas des mares <strong>temporaires</strong>,<br />
des perturbations des facteurs clés “classiques” du fonctionnement<br />
sont recherchées : régime hydrologique, qualité de l’eau<br />
(eutrophisation ou pollution), sédimentation, fermeture du milieu<br />
(cf. Chapitre 4).<br />
Indicateurs de fonctionnement<br />
Le nombre d’indicateurs potentiels est très élevé lorsque l’on<br />
considère la diversité des causes de dégradation des écosystèmes.<br />
Si quelques indicateurs sont pertinents dans de nombreux cas<br />
(hauteur d’eau, par exemple), la recherche des indicateurs les<br />
mieux adaptés à une situation locale sera faite par une analyse<br />
du fonctionnement orientée vers les causes les plus probables de<br />
changement écologique. Par exemple le régime hydrologique peut<br />
être bouleversé soudainement par des interventions anthropiques<br />
(drainage, colmatage d’une mare, approvisionnement artificiel et<br />
continu, etc.) : les modifications écologiques seront donc immédiates<br />
et le diagnostic facile à établir visuellement. Lorsque les<br />
modifications hydrologiques sont moins fortes, comme des réductions<br />
ou prolongements de la période d’inondation (par pompage,<br />
changement climatique, modification de la zone d’influence, etc.),<br />
un suivi à long terme sera nécessaire pour le mettre en évidence.<br />
5. Méthodes de gestion et restauration<br />
L’effet d’un apport en nutriments (eutrophisation) sera diagnostiqué<br />
par des mesures de nutriments (cause), d’oxygène dissous, pH,<br />
production primaire (conséquences) ou par des espèces indicatrices<br />
: par exemple la prolifération de certaines algues ou des<br />
hélophytes au détriment des plantes typiques de conditions oligotrophes*<br />
ou la disparition d’espèces animales sensibles aux conditions<br />
d’oxygénation de l’eau (certains insectes, etc.).<br />
L’apport de toxiques (herbicides, insecticides ou pollutions accidentelles)<br />
sera souvent plus difficile à mettre en évidence. Même si certains<br />
organismes (Bryophytes et invertébrés, par exemple) sont<br />
reconnus comme accumulateurs de substances, leur quantification<br />
reste délicate. Lorsque l’hypothèse de pollution toxique est retenue,<br />
l’appel à des spécialistes est indispensable pour la vérifier.<br />
La sédimentation et l’érosion sont des phénomènes naturels, dont<br />
la vitesse varie en fonction de la nature du substrat, de la pente et<br />
de l’état de la végétation (Chapitre 4). La vitesse de sédimentation<br />
peut augmenter lorsque le couvert végétal sur le bassin versant<br />
diminue (débroussaillement, feu, surfréquentation, etc.). Le régime<br />
hydrologique et les communautés végétales et animales vont être<br />
affectées progressivement. Des espèces végétales plus compétitives<br />
et moins exigeantes en eau s’installent. Un suivi de la profondeur<br />
de l’eau et/ou de l’épaisseur du sédiment pourront donc aider<br />
au diagnostic. La sédimentation organique est souvent moins importante<br />
que la composante minérale du fait de la faible productivité<br />
des mares qui résulte de leur pauvreté en nutriments et de<br />
conditions hydrologiques limitantes. Cependant, cette composante<br />
En été, l'utilisation de la mare de Chevanu (Corse du Sud) comme parking<br />
crée des tassements et des ornières visibles pendant la phase inondée<br />
75<br />
Pozzo di Borgo, M.-L. (OEC)