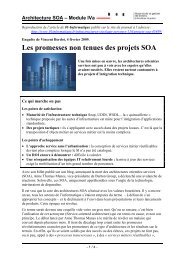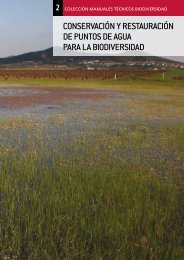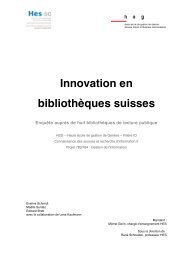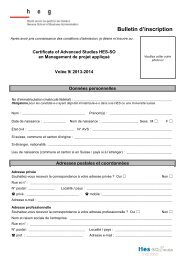Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Les mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes<br />
entre populations et donc leur survie à long terme (Chapitre 3d).<br />
Dans certains cas, la destructuration du paysage peut conduire à<br />
l’extinction totale de toutes les espèces. C’est le cas, par exemple,<br />
du delta de l’Ebre, en Espagne où, suite à une artificialisation<br />
extrême du paysage, tous les amphibiens ont aujourd’hui disparu,<br />
jusqu’aux espèces les plus résistantes comme la Grenouille de<br />
Perez (Santos, com. pers.). En contraste, le delta de la Camargue<br />
n’a perdu aucune de ses espèces originelles grâce à la préservation<br />
d’espaces naturels encore importants.<br />
Perturbations de l’hydrologie<br />
En région méditerranéenne, la santé publique a justifié le drainage ou<br />
le comblement des mares, “foyers à maladie” redoutés par l’homme.<br />
Ainsi des mares ont été asséchées au Maroc 263 et à Malte 182 pour<br />
lutter contre le moustique (Anopheles labranchiaei), vecteur du<br />
paludisme.<br />
Les zones humides <strong>temporaires</strong> sont aussi comblées ou drainées<br />
pour augmenter les surfaces arables. L’intensification de l’agriculture<br />
est la principale cause de disparition des mares en Espagne<br />
entre 1955 et 1980 (Medina, com. pers.) et dans les costières<br />
nîmoises (France) dans la même période 310 .<br />
Les pompages dans la nappe phréatique pour l’agriculture et pour<br />
l’approvisionnement en eau potable des zones urbaines, par exemple<br />
dans le Parc National de Donãna au sud-ouest de l’Espagne 357 , à<br />
Malte 182 ou dans le nord-est de l’Algérie 105 , aboutissent à l’assèchement<br />
précoce de ces milieux et mettent donc en péril leurs communautés<br />
d’espèces animales et végétales caractéristiques.<br />
Encadré 35. La route, une barrière infranchissable<br />
La construction d’infrastructures linéaires (routes, autoroutes,<br />
TGV, etc.) entraîne inévitablement la destruction de nombreuses<br />
forêts, prairies et zones humides.<br />
Les routes provoquent une forte mortalité des amphibiens. Elle<br />
a été évaluée entre 34 et 61 % lors de la traversée d’une route<br />
ayant un trafic de 3 200 véhicules par jour et de 89 à 98 % sur<br />
une autoroute (trafic supérieur à 20 000 véhicules par jour) 184 .<br />
Après une nuit d’orage, 456 tritons palmés, 314 rainettes méridionales,<br />
2 crapauds calamites et 2 grenouilles rieuses ont été<br />
trouvés écrasés sur 60 m d’une route à faible trafic, située près<br />
de Montpellier 79 . Une vaste enquête lancée en Catalogne à partir<br />
de 2001 devrait permettre de chiffrer cette mortalité sur l’ensemble<br />
d’une région 239 .<br />
Infranchissables pour bon nombre d’espèces d’amphibiens 36, 231 ,<br />
ces barrières réduisent ou suppriment les possibilités d’échanges<br />
entre les populations situées de part et d’autre des voies 353 . Cet<br />
isolement rend les populations plus vulnérables au risque d’extinction<br />
que ce soit pour des causes génétiques, démographiques<br />
ou d’accidents environnementaux aléatoires 412 . Au cours des<br />
quinze dernières années, 2 des 4 populations de pélobates cultripèdes<br />
connues dans le département du Var se sont ainsi<br />
éteintes sans espoir de recolonisation compte tenu des distances<br />
qui séparent ces sites des populations les plus proches.<br />
En Allemagne, des populations de grenouilles rousses (Rana<br />
temporaria) ont montré un appauvrissement génétique suite à<br />
la création d’une autoroute 320 .<br />
Gauthier P. & M. Cheylan<br />
64<br />
Banalisation de la végétation de la mare de Grammont (Hérault, France)<br />
suite à sa mise en eau permanente<br />
L’extraction de matériaux minéraux pour la construction entraîne<br />
une augmentation de la durée d’inondation et de la turbidité des<br />
mares au Maroc qui s’accompagne de leur appauvrissement en<br />
espèces rares 325 . La création de réservoirs pour l’irrigation ou la<br />
défense contre les incendies (DFCI), par surcreusement ou endiguement,<br />
provoque une mise en eau permanente des milieux <strong>temporaires</strong>.<br />
Plusieurs mares qui abritaient des crustacés rares (Branchipus<br />
cortesi) ont ainsi été surcreusées au Portugal et ont perdu leur caractère<br />
écologique temporaire 244 . La mare de Saint-Estève dans les<br />
Pyrénées-Orientales et la mare de Grammont près de Montpellier<br />
ont aussi été transformées en mares permanentes suite à des modifications<br />
hydrologiques de leur bassin versant 11, 230, 284 . Ces changements<br />
hydrologiques conduisent à la diminution de la richesse<br />
floristique, notamment des Bryophytes (Hugonnot & Hébrard, com.<br />
pers.), à la disparition des espèces rares et à leur remplacement par<br />
une flore aquatique plus expansionniste à base d’hélophytes* (Typha<br />
latifolia, Scirpus maritimus, etc.). Cependant une augmentation de<br />
la durée d’inondation des mares peut s’avérer favorable à la faune<br />
aquatique (amphibiens, insectes, crustacés) en lui permettant d’achever<br />
son cycle de reproduction.<br />
Perturbations par le feu<br />
Le feu constitue une perturbation majeure en région méditerranéenne.<br />
Ses impacts sont peu étudiés mais probablement multiples :<br />
directs sur la faune, la flore et les stocks semenciers et indirects sur<br />
l’hydrologie, la sédimentation et les espèces exotiques, par exemple.<br />
Dans le cas des mares et ruisseaux <strong>temporaires</strong>, l’incendie a des effets<br />
positifs dans le sens où la destruction des ligneux et l’ouverture du<br />
paysage favorisent les espèces méditerranéennes. Il a également<br />
des effets négatifs sur les populations et sur le milieu (comblement<br />
par les cendres et les limons, etc.) pouvant affecter l’ensemble des<br />
espèces.<br />
La biomasse végétale, la date du feu et l’humidité du sol sont des<br />
facteurs susceptibles de faire varier largement la température d’un<br />
feu et ses conséquences sur les espèces et leurs organes de résistance.<br />
Les plantes vivaces possédant des rhizomes ou bulbes souterrains<br />
résistent bien au passage du feu. Ainsi l’Armoise de Molinier<br />
ne semble pas affectée par le brûlis hivernal de ses tiges sèches.<br />
De même, les grands joncs ou les scirpes produisent de nouvelles<br />
feuilles dans les quelques semaines qui suivent un incendie.<br />
Tan Ham L.