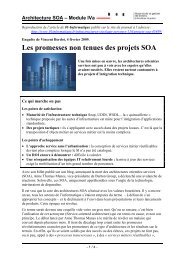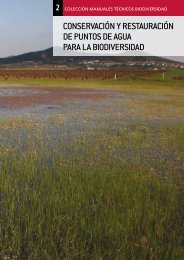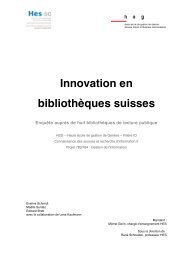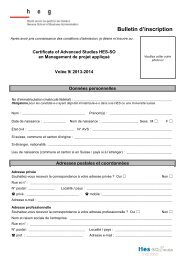Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
changements. La persistance de piquets permanents peut s’avérer<br />
délicate dans les mares <strong>temporaires</strong> où il sont régulièrement déterrés,<br />
en raison de l’inondation hivernale qui ameublit les sols, et de<br />
la curiosité des hommes et des animaux (sanglier, bétail). Le marquage<br />
discret par des plots solidement enterrés et dépassant peu<br />
du sol est préférable bien qu’ils soient plus difficiles à retrouver.<br />
Quelques repères extérieurs à la mare peuvent être judicieusement<br />
placés et permettre de replacer, à chaque relevé, des axes de référence.<br />
Etude de la banque de semences<br />
L’estimation de la banque de semences est nécessaire lorsque l’on<br />
souhaite évaluer la taille d’une population d’annuelles avec des<br />
semences dormantes ou la capacité d’une espèce ou d’un cortège<br />
d’espèces à se régénérer après une perturbation (Chapitre 3c).<br />
Cette mesure n’est généralement pas à la portée du gestionnaire<br />
(coût, infrastructure, etc.). Toutefois, dans le cas d’une espèce à<br />
forte valeur patrimoniale, il pourra souhaiter la mettre en œuvre<br />
en collaboration avec un spécialiste.<br />
L’étude de la banque de semences commence par des prélèvements<br />
standardisés de sédiment (carottages). Le diamètre et la<br />
profondeur de la carotte sont adaptés à la taille des graines, à la<br />
profondeur du substrat et à la problématique : généralement de<br />
2 à 20 cm de diamètre. Rechercher des semences au-delà de 5 cm<br />
de profondeur ne se justifie que dans des cas particuliers comme,<br />
par exemple, l’enfouissement des semences par la sédimentation,<br />
le labour ou les perturbations par les sangliers (Encadrés 38 et 41).<br />
Deux techniques avec des résultats différents peuvent alors être<br />
envisagées selon l’objectif : le comptage direct des semences ou la<br />
mise en conditions de germination des semences des sols. L’une et<br />
l’autre reposent sur des protocoles relativement lourds (en heures<br />
et en précision).<br />
Objectifs Méthodes possibles Temps Coûts autres Niveau de<br />
connaissances<br />
requis<br />
Inventaire Visites répétées sur site * *<br />
Suivi d'une espèce éparse Dénombrement et cartographie fine ** * *<br />
Suivi d'une espèce plus abondante Quadrats permanents ** * **<br />
Suivi d'une communauté Transect permanent continu ** * **<br />
Transect permanent discontinu ** * **<br />
Transect permanent de quadrats<br />
** * **<br />
Etude de la banque de semences<br />
* = faible, ** = modéré, *** = important<br />
Comptage direct<br />
Comptage indirect<br />
Technique mixte<br />
6. Suivi<br />
Le comptage direct des semences est réalisé après leur extraction<br />
par tamisage sur une série de tamis de mailles différentes. La plus<br />
petite maille est généralement de 0,15 à 0,20 mm. Les semences<br />
sont ensuite identifiées sous binoculaire. Cette technique donne<br />
un inventaire et une estimation de l’abondance relative des semences,<br />
mais n’informe pas sur leur viabilité. On obtient, ainsi, une<br />
surestimation des stocks viables que des tests complémentaires<br />
de germination permettent d’évaluer. De tels tests nécessitent de<br />
maîtriser les conditions de germination des espèces recherchées et<br />
peuvent être très compliqués à mettre en œuvre (mares avec plus<br />
de 100 espèces !).<br />
Le comptage indirect des semences viables à partir des plantules<br />
consiste à mettre les échantillons de sol dans des conditions optimales<br />
pour la germination des semences. Cette méthode requiert<br />
une infrastructure suffisante (serre, enceinte climatisée) pour<br />
accueillir les expérimentations de germination et une maîtrise des<br />
conditions de germination des espèces végétales. Elle donne une<br />
estimation des semences viables mais tend à déprécier les stocks<br />
semenciers : toutes les graines viables ne germent probablement<br />
pas. De plus cette méthode nécessite la capacité à reconnaître les<br />
plantes au stade plantule, celles-ci n’atteignant pas forcément le<br />
stade adulte pendant l’expérience.<br />
Pour les Bryophytes, les problématiques du suivi sont sensiblement<br />
les mêmes que pour les plantes vasculaires (Hugonnot & Hebrard,<br />
com. pers.), même si l’utilisation du transect est moins courante 367 .<br />
Par ailleurs, la détermination des espèces sur le terrain est souvent<br />
plus difficile, voire impossible pour certains groupes. Les prélèvements<br />
pour une détermination en laboratoire, qui peuvent perturber<br />
le milieu, s’imposent donc plus fréquemment que pour les<br />
végétaux vasculaires.<br />
Les principales méthodes utilisables en fonction des objectifs<br />
poursuivis sont récapitulées dans le Tableau 20.<br />
*** *** ***<br />
** ** ***<br />
*** *** ***<br />
**<br />
Tableau 20. Evaluation et objectifs des<br />
méthodes de suivi de la végétation<br />
99