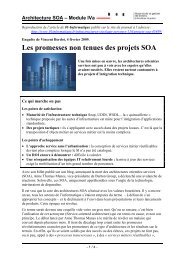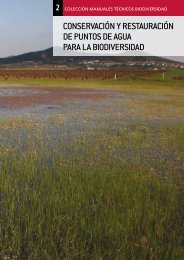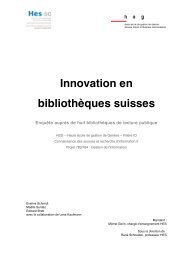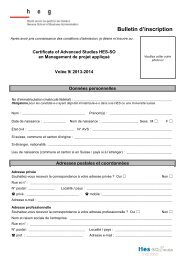Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5. Méthodes de gestion<br />
et restauration<br />
a. Du diagnostic<br />
au plan de gestion<br />
Perennou C., P. Gauthier & P. Grillas<br />
Le diagnostic, une nécessité avant toute gestion<br />
Qu’est-ce que la gestion ?<br />
“Gérer un milieu naturel, c’est agir (ou ne pas agir) pour conserver,<br />
voire augmenter, sa valeur patrimoniale ; cela peut consister à maintenir<br />
des activités traditionnelles, utiliser des techniques modernes ou<br />
simplement surveiller une évolution naturelle, afin d’entretenir ou<br />
de modifier un équilibre écologique, en fonction d’objectifs précis<br />
de conservation” 331 .<br />
Pourquoi une gestion des mares <strong>temporaires</strong> méditerranéenne<br />
est-elle nécessaire ?<br />
Diverses activités humaines et processus naturels agissent directement<br />
ou indirectement sur les mares et sont susceptibles de modifier<br />
leur fonctionnement et d’affecter les espèces qu’elles hébergent<br />
(Chapitre 4). Une gestion active peut être nécessaire pour compenser<br />
ou corriger les processus ayant un impact négatif sur le<br />
fonctionnement ou la richesse biologique des mares. Enfin, la restauration<br />
des sites est nécessaire lorsque les processus de dégradation<br />
sont trop avancés.<br />
Un cadre : le plan de gestion<br />
Avant d’agir (ou ne pas agir) sur les mares <strong>temporaires</strong>, une phase<br />
préalable de réflexion et d’organisation des actions de gestion est<br />
nécessaire. De plus en plus fréquemment, elle se matérialise par un<br />
plan de gestion, outil désormais largement reconnu. Il consiste en :<br />
• Une démarche qui vise à élaborer en commun des projets d’actions<br />
utiles à la conservation du site, reconnus et acceptés par<br />
toutes les parties impliquées : propriétaires, usagers du site, administrations,<br />
associations.<br />
• Un document qui finalise le résultat de cette démarche. Le plan<br />
de gestion ne se résume pas à ce seul document, même approuvé<br />
formellement par toutes les parties concernées : il resterait alors<br />
le plus souvent inappliqué par des acteurs locaux ne se sentant pas<br />
concernés, alors que sa raison d’être est de servir quotidiennement<br />
à la gestion du site.<br />
Un plan de gestion peut se décliner en de multiples variantes et<br />
appellations selon les contextes. En France, les Réserves Naturelles,<br />
les terrains du Conservatoire du Littoral ou de conservatoires<br />
régionaux de sites se dotent de plans de gestion stricto sensu 331 .<br />
Les Documents d’objectifs pour les sites Natura 2000 de France<br />
sont des plans de gestion où les propriétaires et usagers jouent un<br />
rôle important 397 , de même que les Schémas d’Aménagement et de<br />
Gestion des Eaux (ou SAGE) sont équivalents à des plans de gestion<br />
pour de petits bassins versants. La diversité des appellations<br />
ne doit toutefois pas occulter la remarquable constance des<br />
grandes étapes logiques de ces plans de gestion, qui correspond à<br />
un enchaînement de questionnements (voir plus bas, ce chapitre).<br />
Plus largement, en Europe et dans le Bassin méditerranéen, la<br />
même approche méthodologique est également suivie ou préconi-<br />
Encadré 39. Les plans de gestion de sites à mares <strong>temporaires</strong><br />
en France<br />
La Réserve Naturelle Volontaire de la Tour du Valat, suivie de la<br />
Réserve Naturelle de Roque-Haute, ont été les deux premiers<br />
sites de France, riches en mares <strong>temporaires</strong>, à se doter d’un<br />
plan de gestion, respectivement dans les années 1980 et 1990.<br />
Dans le cadre du projet LIFE “<strong>Mares</strong> Temporaires”, trois des sites<br />
concernés ont également développé leur plan de gestion :<br />
Notre-Dame de l’Agenouillade, Valliguières et Padulu. Les Tre<br />
Padule de Suartone ayant été déclarés Réserve Naturelle en<br />
2000, un plan de gestion devrait y être élaboré prochainement.<br />
Enfin, nombre de sites 391 figurant sur la liste proposée par la<br />
France pour intégrer le réseau Natura 2000 ont initié leur Document<br />
d’objectif. Ce document est en cours d’élaboration pour<br />
19 sites.<br />
Perennou C.<br />
sée 135 . Par la suite la notion de plan de gestion sera utilisée dans<br />
un sens très général recouvrant, sauf mention particulière, les différentes<br />
formes qu’il peut prendre.<br />
Diagnostic et plan de gestion<br />
Le diagnostic du site est toujours une phase clé pour établir les<br />
premières hypothèses sur les changements écologiques éventuellement<br />
en cours, afin de proposer les mesures de gestion et de<br />
suivi à engager pour sauvegarder, réhabiliter ou recréer un milieu.<br />
La démarche générale des plans de gestion est présentée ici, appliquée<br />
aux mares <strong>temporaires</strong>, en y incluant la phase de diagnostic.<br />
Etapes du plan de gestion<br />
La structure des plans de gestion (Tab. 14) correspond à un enchaînement<br />
de questions/réponses. Le diagnostic du site correspond<br />
aux étapes 1, 2, 3 et 5. Les différentes étapes sont présentées cidessous,<br />
en insistant sur les aspects spécifiques aux mares <strong>temporaires</strong>,<br />
les aspects plus génériques pouvant être consultés dans<br />
RNF 331 .<br />
1. Le contexte<br />
La zone concernée doit être délimitée au préalable, en distinguant<br />
une zone centrale (la mare ou le ruisseau) et une zone d’influence<br />
correspondant à l’espace de fonctionnalité 356 . Il s’agit de “l’espace<br />
proche de la zone humide, ayant une dépendance directe et des<br />
liens fonctionnels évidents avec la zone humide, à l’intérieur duquel<br />
certaines activités peuvent avoir une incidence directe, forte et<br />
rapide sur le milieu et conditionner sérieusement sa pérennité”.<br />
La zone d’influence est délimitée selon des critères techniques :<br />
alimentation en eaux souterraines ou superficielles, apports d’éléments<br />
polluants, zone de recharge en sédiments, domaines vitaux<br />
des espèces mobiles, etc. 356 Sa dimension est donc variable en<br />
fonction de la taille, du type et de la situation géographique de la<br />
mare, des facteurs impliqués et du domaine vital des espèces que<br />
l’on souhaite conserver. Elle peut être très vaste, pour certains<br />
paramètres. Par exemple, la qualité et la quantité de l’eau dans les<br />
mares en zones karstiques (mare de Valliguières) dépendent d’une<br />
nappe souterraine régionale ; elles pourront être affectées par des<br />
sources de pollution ou de perturbation hydrologique très éloignées.<br />
71