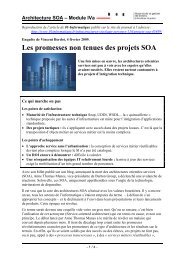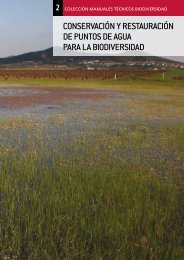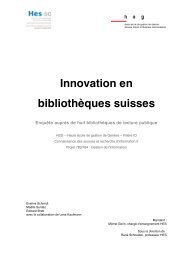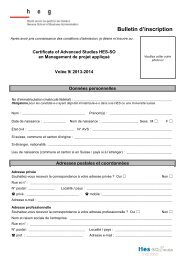Mares temporaires
Mares temporaires
Mares temporaires
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Les mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes<br />
d. Suivi des amphibiens<br />
Jakob C.<br />
Généralités<br />
Un cycle de vie qui conditionne les possibilités de suivis<br />
Les méthodes utilisées pour le suivi des amphibiens portent pour<br />
l’essentiel sur la phase aquatique, lorsque les animaux sont concentrés<br />
dans les mares et, pour plusieurs d’entre elles, sur l’échantillonnage<br />
de nuit. Dans la grande majorité des cas, il faut donc<br />
synchroniser les visites avec les périodes de reproduction, ellesmêmes<br />
souvent liées aux périodes de pluie. L’échantillonnage des<br />
adultes est donc contraignant par rapport à l’échantillonnage<br />
des larves, qui peut se pratiquer de jour comme de nuit et sur des<br />
périodes bien plus longues.<br />
Reproduction<br />
A l’instar d’autres groupes d’animaux des mares <strong>temporaires</strong>, la<br />
reproduction des amphibiens montre de fortes variations d’une<br />
année à l’autre (Encadré 21, Chapitre 3d). Il est donc difficile de<br />
différencier les fluctuations de populations à long terme des variations<br />
observées sur le court terme. Certaines espèces se caractérisent<br />
par une flexibilité importante leur permettant de s’adapter aux<br />
variations interannuelles des précipitations alors que d’autres sont<br />
plus stables (Encadré 22, Chapitre 3d). Pour le suivi des amphibiens<br />
plusieurs paramètres seront importants : le choix de la période des<br />
échantillonnages, la nécessité de visites répétées durant les périodes<br />
favorables, l’intérêt de poursuivre le suivi sur plusieurs années<br />
consécutives et la corrélation des échantillonnages avec les données<br />
d’une station météorologique locale et les données physiques<br />
du milieu, pour en faire une interprétation correcte.<br />
Réglementation et protection<br />
Les amphibiens sont soumis à réglementation dans la plupart des<br />
pays européens. Sur le territoire français, toutes les espèces sont<br />
protégées par la loi (arrêté du 24 avril, J.O. du 12 mai 1979) excepté<br />
Rana esculenta et Rana temporaria qui font l’objet d’une réglementation<br />
particulière. Pour tout projet de suivi impliquant une<br />
manipulation des amphibiens, il faut donc, au préalable, demander<br />
les autorisations. Celles-ci sont délivrées par les préfectures des<br />
départements, en France, et par les Comunidades Autónomas, en<br />
Espagne.<br />
Au-delà de ces démarches administratives, il convient d’être prudent<br />
lors de la manipulation des animaux, adultes ou larves. Ils<br />
possèdent, en effet, une peau fragile, notamment les espèces couvertes<br />
de mucus. Il est donc recommandé de les garder en main un<br />
minimum de temps.<br />
Quelques conseils :<br />
•Variabilité dans le temps : de fortes variations interannuelles dans<br />
la reproduction peuvent apparaître (Fig. 42), il est donc conseillé,<br />
pour tout inventaire complet, de mener les prospections sur au<br />
moins trois ans.<br />
• Les méthodes présentées sont adaptées à la petite surface des<br />
mares <strong>temporaires</strong>.<br />
• La combinaison de plusieurs techniques sur le terrain est très<br />
souhaitable.<br />
• Les techniques présentées tiennent compte de l’expérience<br />
acquise sur les mares <strong>temporaires</strong> du Midi de la France, il existe<br />
bien sûr d’autres méthodes, non abordées ici 121, 187 .<br />
100<br />
Encadré 55. Explorer un nouveau site<br />
Dans un site inconnu (par exemple un plateau, un massif avec<br />
un nombre de mares inconnu), on commencera par un repérage<br />
nocturne après de fortes précipitations et avec une température<br />
de l’air plutôt élevée (pas en-dessous de 13 °C), en automne<br />
(octobre-novembre) ou au printemps (février à avril, pour les<br />
périodes propices pour la reproduction, voir Fig. 42). La localisation<br />
des lieux (mares) occupés se fera alors à l’ouïe, grâce aux<br />
vocalisations de certaines espèces (grenouilles, rainettes essentiellement).<br />
Après cette phase de localisation, les méthodes d’inventaire<br />
habituelles pourront être appliquées.<br />
Jakob C.<br />
Méthodes<br />
Le choix des méthodes dépendra essentiellement de l’objectif recherché<br />
mais devra prendre en compte leurs exigences techniques et<br />
leur coût. Les résultats qui pourront être obtenus sont essentiellement<br />
l’inventaire, l’évaluation de la taille d’une population ou le<br />
suivi démographique.<br />
Inventaire<br />
Il consiste à dresser une simple liste des espèces présentes sur un<br />
site donné. En fonction du temps passé et de la méthode utilisée, cette<br />
liste d’espèces peut varier considérablement. Il faut donc choisir la<br />
période la plus propice à l’observation des amphibiens (Fig. 42) et<br />
éventuellement effectuer quelques observations de vérification en<br />
dehors de cette période. Dans le Midi de la France, les périodes les<br />
plus appropriées sont octobre-novembre pour la période automnale<br />
et février à avril pour la période printanière.<br />
Plusieurs méthodes existent :<br />
• La détection visuelle des adultes se fera de préférence de nuit, à<br />
l’aide d’une torche, à proximité des sites potentiels de reproduction.<br />
Ce protocole est facile à mettre en œuvre. Il nécessite un équipement<br />
minimal et permet des comparaisons entre sites lorsque l’effort<br />
d’observation est standardisé (nombre d’heures-personnes). La<br />
seule contrainte de cette méthode est une bonne capacité d’identification<br />
des espèces. Sous certaines conditions, les prospections de<br />
jour peuvent également donner de bons résultats, principalement au<br />
moment de la sortie des individus récemment métamorphosés (maijuin<br />
surtout dans le Midi de la France). Il s’agit, dans ce cas, de<br />
rechercher les animaux à proximité immédiate de la mare, sous les<br />
pierres ou les objets situés à peu de distance de celle-ci.<br />
• Le comptage auditif (de nuit) consiste en des sorties de nuit pour<br />
identifier les espèces présentes par leur chant caractéristique. Le<br />
protocole est simple, l’équipement minimal et l’effort d’observation<br />
(nombre d’heures/personnes) peut être standardisé entre sites. En<br />
revanche, cette méthode est limitée aux amphibiens chanteurs (certains<br />
anoures uniquement) et son application dépend des conditions<br />
météorologiques (pluie, pas de vent, température élevée pour certaines<br />
espèces, comme le Pélobate cultripède). Pour les grands sites,<br />
elle s’avère plus difficile à mettre en œuvre à cause de la portée<br />
limitée du chant. Dans ce cas, elle peut être combinée avec des transects<br />
(cf. Chapitre 6d). Une bonne connaissance des chants d’anoures<br />
est nécessaire, sauf si des enregistrements sont effectués et soumis<br />
à des spécialistes.<br />
•L’échantillonnage des larves se fait à l’aide d’une épuisette à mailles<br />
assez grosses (2 à 3 mm) plongée de façon régulière à différentes